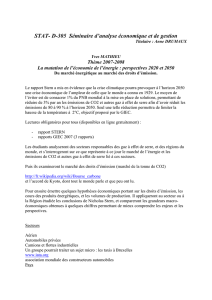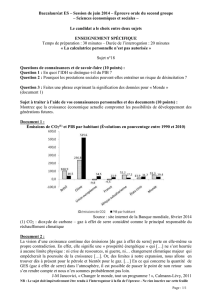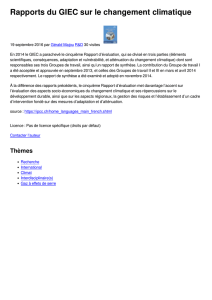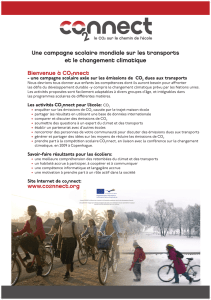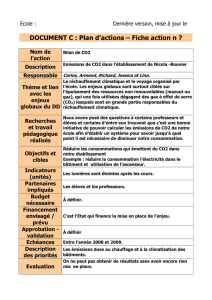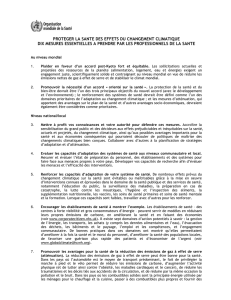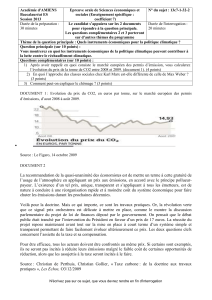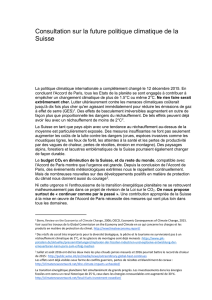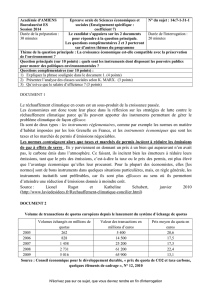Energie et climat : la construction des politiques climatiques

Article : 110
Energie et climat : la
construction des politiques
climatiques
ILASCA Constantin
juin-16
Niveau de lecture : Assez difficile
Rubrique : Environnement
Mots clés : environnement, climat, politique énergétique, coûts de l'énergie, externalités, prix de
l'énergie, gaz à effet de serre, prospective, modélisation

2
ent est basée
externe
compensée financièrement. Cet effet externe (ou externalités dans le jargon des économistes)
représente la différence entre le coût supporté individuellement et le coût supporté collectivement
par la société, dit coût social
1
conséquences des actions réalisées par les agents (des producteurs et des consommateurs) sur
-
on ou quant à sa
publique
2
en compte complète de leur action su
négatifs des activités polluantes. Pour ce faire, il faut confronter les agents à un prix qui reflète la
é.
me intervention au niveau mondial, puisque
atténuation des émissions, sont censées corriger ce que Stern (2006) appelle « la plus grande
défaillance de marché que le monde ait jamais connue
raisonnement économique est la détermination d'un niveau optimum des émissions qui reflète
atmosphère et les coûts de leur réduction
3
.
: le
rapport Stern (2006) et le cinquième rapport du Groupe d'experts Intergouvernemental sur
l'Evolution du Climat - GIEC (2015)
4
pousser conduirait
à les « convertir
pertes sèches qui en découlent. Dans ce contexte, les arbitrages qui se présentent au planificateur
optimale et équitable de ces coûts entre les agents
moyens
immédiate et action différée.
Les principaux paramètres clés qui structurent la notion de coût du changement climatique sont
la taxinomie des coûts et les approches analytiques pour la construction des politiques climatiques.
Après leur passage en revue (points 1 et 2), seront examinées les estimations du rapport Stern (2006)
et du cinquième rapport du GIEC (AR5 2015) puis recensés leurs résultats (points 3 et 4).
1
Un exemple simple pour comprendre cet effet « externe » est celui d’une centrale thermique qui produit de
l’électricité et qui rejette du CO2 dans l’atmosphère. Son coût de production de l’électricité (dit privé) n’intègre
pas la pollution qu’elle génère. Il est donc inférieur au coût subi par la société qui se voit exposée à la pollution
de ses rejets carboniques.
2
Précisons que la référence au marché n’implique pas forcément une institution fonctionnant moyennant les
prix. Il y a marché dès lors que les parties prenantes ont la possibilité de négocier entre elles. Ainsi, les normes
sociales peuvent jouer le rôle de contrats dont le respect repose sur le comportement et l’entente réciproque entre
ceux qui participent à la gestion d’une ressource (Bontems et Rotillon 1998).
3
Il s’agit d’égaliser les dommages marginaux (la détérioration causée par une tonne de CO2 supplémentaire
émise dans l’atmosphère) avec les coûts marginaux d’atténuation (l’effort de réduire d’une tonne de CO2 les
émissions).
4
Voir références Stern (2006) et GIEC (2015) in fine.

3
1. Coût sectoriel, macroéconomique et du bien-être
Les indicateurs (i.e
sont exprimés le plus souvent en termes de perte de bien-être, variation de Pib ou variations de
consommation finale des ménages. Parmi ces mesures, la variation en bien-être demeure
utilisées. En général, les estimations données par les modèles intégrés, particulièrement, ceux
employés dans le cinquième rapport du GIEC
5
, sont faites par rapport à la variation de la
consommation des ménages. La précision des indicateurs utilisés est importante, car il y a un risque
de confusion dû au fait que tous ces coûts sont exprimés souvent en points de Pib. Par exemple, un
exprimés en points de Pib alors qu'ils recouvrent des réalités bien différentes. Pour ces raisons, il
convient de définir ces notions afin de préciser ce que reflètent ces mesures.
1.1. Le coût technique
u coût
total de fonctionnement des systèmes techniques, dans un scénario « avec politique climatique » par
rapport à un scénario « référence
ensemble de secteurs (pour un pays). La réduction des émissions de GES passe nécessairement par
démarche consiste donc à identifier les options de réduction les plus pertinentes et à estimer pour
chaque option la quantité de réduction et le coût unitaire de réduction correspondant. Ensuite, les
options techniques sont empilées par ordre de coût croissant pour construire une courbe de coût
et pour une année
donnée, le coût marginal de réduction ainsi que le coût total des options techniques qui permettent
figure1).
Fig. 1 : Courbe de coût marginal de réduction - Source : AETIC 2013.
5
e.g. A.II.3.2, WG III, AR5 2014. Le rapport note également que la variation du Pib est « moins satisfaisante »,
du moment où elle inclut les investissements, les importations et les exportations, ainsi que les dépenses
gouvernementales.

4
-dessus, on retrouve en ordonnées les quantités de réduction
-Q4) ainsi que la quantité cumulée au niveau du
secteur (Q) et en abscisse, le coût moyen de réduction de chaque option. La courbe indique le
qui vise l-efficace. La courbe indique également le coût total des
Q1-Q4.
Les coûts techniques sont composés, avant tout, des coûts directs industriels et financiers induits
solutions technologiques et des dépenses afférentes à celles-ci (e.g. coûts de fonctionnement
annuels). De manière générale, on retrouve sur le marché plusieurs solutions techniques qui sont soit
qui dé
ie
6
.
Ce qui est particulièrement important dans les modèles qui calculent ce type de coût, ce sont les
ailleurs, il faut noter que ces coûts peuvent être négatifs, par exemple, lorsque les économies
1.2. Le coût macroéconomique
Le coût macroéconomique, à la différence du coût technique, prend en considération les
tous les éléments (et leurs interactions)
entre la
facture énergétique des ménages et les autres consommations), ou encore les effets rebond, entre
-delà du secteur dans
modèles macroéconomiques prennent en compte ces interactions et permettent de voir comment se
reflètent les changements induits sur un marché sur les autres marchés et quel impact cela peut
avoir sur le niveau et la composition du Pib national. Les modèles qui estiment ces coûts permettent
une éventuelle taxe sur les émissions. Les coûts macroéconomiques sont ainsi présentés sous forme
de variations de Pib ou des coûts en bien-être des consommateurs.
Les analyses en équilibre général ne présupposent pas nécessai
l'utilisation idéale des ressources dans une situation où tous les marchés sont équilibrés à travers les
6
Ces coûts sont l’apanage des modèles dit bottom-up (sectoriels) et reposent sur la représentation détaillée du
système de production de l’énergie. Ces modèles sont assortis des hypothèses exogènes sur la croissance, la
demande ou encore sur la disponibilité des ressources. Les modèles fonctionnant en équilibre partiel construisent
des scénarios à partir des comportements d’acteurs et des grandes variables économiques et énergétiques.

5
prix. Cette acception de l'équilibre s'oppose le plus souvent à celle des modélisations en « équilibre
partiel
1.3. Le coût en bien-être
Le coût en bien-être renvoie à une évaluation quantitative des valeurs en termes pécuniaires.
-être établit les concepts de disposition à payer et de
disposition à accepter une compensation, ce dernier concept représentant le dédommagement que
les gens accepteraient pour vivre dans un monde sans politique climatique. Le consentement à payer
reflète le surplus du consommateur, le prix que les gens seraient prêts à payer pour vivre dans un
monde avec une politique climatique donnée plutôt que sans. Le surplus du consommateur est une
notion liée à la courbe de demande qui peut être interprétée comme la disposition marginale à payer
supplémentaire. Le surplus du consommateur, explique Alain Quinet « est la mesure la plus
pertinente du coût de bien-
»
7
.
Si le surplus des consommateurs est égal à la somme des surplus individuels, alors se pose la
question de la répartition de ce coût entre les diverses catégories de ménages, qui ont des niveaux
une taxe carbone, cette augmentation pénalise davantage les ménages à revenus
modestes que les ménages à revenus élevés. La mesure du surplus des consommateurs en tant
- t des
informations précises sur le consommateur et sur la variation de la structure de ses dépenses en
fonction de ses revenus.
2. L’évaluation du changement climatique : analyse coût-bénéfice et
coût-efficacité
, le plus souvent, sur des travaux de modélisation
8
. Il
privilégiant une approche prospective, par opposition aux approches prévisionnistes ou encore
prédictives, et en procédant à la comparaison de scénarios
9
ction des émissions,
doit être précédée d'une définition de la démarche prospective qui est essentielle dans la
modélisation des évolutions socio-économiques.
7
Voir référence in fine, 2009 : 147.
8
Les modélisations s’appuient, généralement, sur quelques fondamentaux des émissions : population, Pib et
consommation d’énergie, éléments qu’on retrouve communément dans l’identité Kaya (ou encore IPAT pour
Impacts Proportionnels à la Population, l’Aisance et la Technologie [Nakicenovic et al. 2006]).
9
« Les scénarios sont des images diverses du déroulement possible du futur et ils constituent un outil approprié
pour analyser comment des forces motrices peuvent influer sur les émissions futures et pour évaluer les
incertitudes connexes. Ils aident à analyser l’évolution du climat, notamment sa modélisation et l’évaluation des
impacts, l’adaptation et l’atténuation » (Nakicenovic et al. 2000 : 3).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%