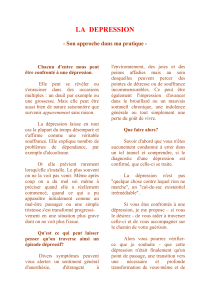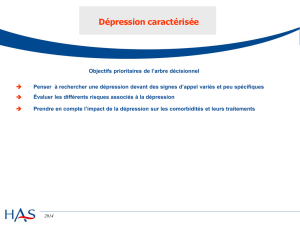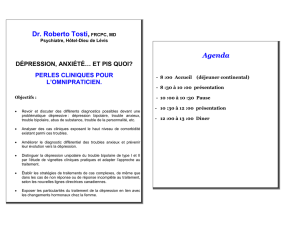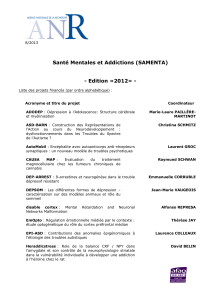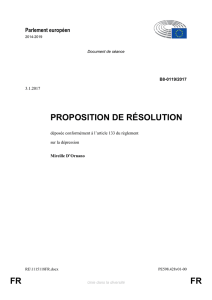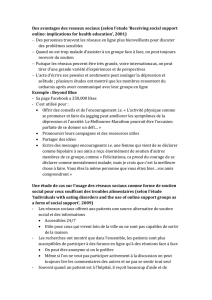Le diagnostic d`une dépression chez la

La Revue de Gériatrie, T
ome 28, N°10
DÉCEMBRE 2003
837
Service de Psychiatrie du Sujet Agé, Hôpital Charles Foix, Ivry-sur
-Seine,
France.
Auteur corr
espondant :
Clément Pinquier
paris.fr
Article r
eçu le 04.05.2003 - Accepté le 29.07.2003.
ENSEIGNEMENT
Le diagnostic d’une dépr
ession
chez la personne âgée
Diagnosis of a depr
ession in elderly
Clément PINQUIER, Natacha WEIMANN, Jérôme PELLERIN
De plus, la que stion de la présence ou non d’une
pathologie démentielle associée demeure en filigrane
lorsqu’on abor
de les tr
oubles de l’humeur de survenue
tar
dive et ajoute donc un degré de complexité dans leur
appr
oche clinique et leur prise en char
ge.
La survenue d’une dépr
ession chez le vieillar
d n’est pas
sans conséquence sur sa qualité de vie et son pr
onostic
vit
a
l. En outre, le risque suicidaire
e
st important et
donc à r
echer
cher
. D’autr
es facteurs de morbidité inter
-
viennent notam
m
ent par le biais d’interactions réci-
pr
oques avec d’autr
e(s) maladie(s) inter
curr
ente(s).
Parallèlem
e
nt à cette compl
e
xité diagnostique et pro-
nostique, la dépr
ession du sujet âgé est potentiellement
à l’origine de souf
france et de déstabilisation dans un
équilibr
e familial appar
ent, et elle peut tout autant per
-
turber un fonctionnement institutionnel voir
e une r
ela-
tion thérapeutique.
ÉPIDÉMIOLOGIE
_______________________________
Les données de la littérature sont assez variables sui-
vant la population étudiée et les critèr
es diagnostiques
ou instruments utilisés. Néanmoins, il en r
essort que la
fréquence des états dépr
essifs du sujet âgé est suf
fisam-
ment importante pour êtr
e préoccupante. En popula
-
tion générale, la prévalenc
e
de l’épisode dépressif sévère
(défini par des critèr
es DSM IV) après 65 ans est de 2-
L
a dépr
ession du sujet âgé constitue un pr
oblè-
me majeur de santé publique dont l’importance
c roît parallèlement au vieillisse
m
ent démogra-
phique de la population, bien que l’âge
per se
ne soit
pas un facteur de risque. Cette pathologie fréquente est
caractérisée par
une évolution chronique,
une
m
orbidité
et une
m
ortalité
non négligeables, alors même que des
p r
ogrès notables ont été ré
a
lisés en ce qui concer
n e
son traitement.
En fait, un des traits essentiels de la dépr
ession du sujet
âgé est la dif
ficulté que r
encontr
ent les médecins pour
la r
e c o n n a î t r
e. De plus, les contours des troubles de
l’humeur survenant tardivement restent i
m
précis : la
s
uccession des concepts nosographiques, ancien
s
ou
plus récents, en témoigne (mélancolie d’involution, dys
-
thy
m
ie, dépression mine ure ou incomplète
)
, alors
m
ême que le diagnostic "épisode dépressif sévèr
e " ,
défini dans le
m
anuel diagnostique et statistique des
t r
oubles
m
entaux
(
DSM) ( 4 ) par des critères établis à
partir de données statistiques r
ecueillies sur une popu
-
lation générale tout âge confondue, est utilisé tel quel
en gériatrie.
Il serait plus adapté de parler de dépr
essions du sujet
âgé tant les modes d’expr
ession sont divers et intime
-
ment liés à une histoir
e individuelle. La séméiologie est
complexe, hétér
ogène et souvent tr
ompeuse. Poser le
diagnostic n’est donc pas chose facile. La dépr
e s s i o n
du sujet âgé est par conséquent insuf
fisamment dépis
-
tée, sous diagnostiquée et non ou mal traitée.

Le diagnostic d’une dépr
ession chez la personne âgée
3% et celle des sy
m
ptômes dépressifs varie entre 1
0
% et
50%
( 1 1 )
. En cor
o l l a i r
e de ce qui a été abordé dans l’intro-
duction, il faut souligner la grande proportion de dépre s-
sions
m
éconnues, évaluée à plus de 40% des cas ( 6 ).
Concer
nant les populations âgées hospitalisées ou en
institution, la prévalence des symptômes dépr
essifs est
évaluée autour de 20%
(13)
, celle de l’épisode dépr
essif
sévèr
e à 13%
(12)
et dans la pr
emièr
e année d’une insti
-
tutionnalisation 10 à 1
5
% des résidents développent
une dépr
ession
(1).
F
ACTEURS DE RISQUE ET DÉPRESSIONS
SECONDAIRES
_________________________________
Facteurs de risque
Ce n’est pas l’âge qui est un facteur de risque de
dépr
ession mais plutôt certains paramètr
es qui accom
-
pagnent le vieillisse
m
ent. Les car
a
ctéristique s socio-
démographiques classique
m
en
t
en lien avec la surve-
nue d’une dépr
ession sont bien identifiées : celle-ci est
plus fréquente chez
les fem
m
es notam
m
ent chez les
veuves et chez les personnes ayant subi la perte d’un
pr
oche, chez celles qui ne bénéficient pas d’un entou
-
rage suf
fisamment présent et qui vivent dans une situa
-
tion d’isolement social. Elle es
t
également plus fréquente
chez les patients souffrant d’affections somatiques grave
s
et chroniques qui en aggravent aussi la durée, la
sévérité
et le pr
onostic. Dans ce cadr
e, la perte d’autonomie et
le handicap auraient davantage un rôle prédisposant
que la pathologie elle-même.
La présence d’antécédents dépressifs personn
e
ls ou
familiaux constitue un terrain vulnérable à l’apparition
ou à la re chute d
’
une sy
m
ptoma tologi
e
dépr
e s s i v e .
Cependant, 75% des épisodes dé pressifs sévères du
vieillar
d sont des for
mes tar
dives, caractérisées par une
m
orbidité e t une
m
orta lité plus i
m
portantes et une
moins bonne réponse thérapeutique
(5).
Dépr
essions secondair
es
C
ertaines for
m
es de dé pression sont qualifié es de
s e c o n d a i r
es car un lien chronologique est r
e t r
o u v é
e n t r
e la survenue d’une dépression et une pathologie
somatique (mala die de Parkinson, lésions cérébrales
d’origine vasculair
e à prédominance fr
ontale, hydr
océ
-
phalie à pression nor
m
ale, dysthyroïdie, diabète,…
)
.
En dehors des corticostér
oïdes et de l’inter
fér
on, l’im
-
plication de certains médicaments classiquement décrits
dans la survenue d
’
une dépression
(
bêta-bloquants,
anti-hypertenseurs centraux, neuroleptiques, cimé
t
i-
d i n e , …
) serait exagérée
(3).
Dépr
ession vasculair
e
Le concept de dépr
ession vasculair
e a été récemment
développé sur les bases des liens existant entr
e patho
-
logie cérébrale d’origine va
s
culaire et dépression. Le
diagnostic r
epose sur l’association de facteurs de risque
v a s c u l a i r
e, d’un
e
clinique particulière
m
arquée p
a
r un
ralentissement psycho
m
oteur important, une aboulie,
une pauvreté idéique, une introspection limitée, une
réduction voir
e une absence d’af
fects dépr
essifs et d’i
-
dées de culpabilité, et une perturbation co gnitive
importante principalement des fonctions exécutives. La
présence de signes neur
oradiologiques en faveur d’une
atteinte vasculaire
(
signaux hyperintenses à l’IRM) est
un ar
gument supplémentair
e. Enfin, la réponse théra
-
peutique serait également moins bonne. Aucun de ces
critèr
es n’a fait pour l’instant l’objet d’un consensus (5).
CLINIQUE
______________________________________
Stigmates et préjugés
La séméiologie des dépr
essions du sujet âgé est certes
hétér
ogène mais d’autr
es obstacles concour
ent à r
end
-
r
e leur dépistage ar
du. Entr
e autr
es, ce que nous pour
-
rions appeler le "filtr
e du vieillissement" vient br
ouiller
l’expr
ession et la per
ception par le patient de sa pr
op
-
r
e souf
france morale.
Le sujet
â
gé met sur le compte du vieilliss
e
ment son
expérience dépressive, plus ou moins inhibé par un
sentiment de honte vis-à-vis de ce qu’il perçoit comme
un laisser aller
(14)
. Il n’ira donc pas for
cément consulter
et en tout cas pas pour ce motif. Une étude nor
d amé
-
ricaine
( 1 5 )
portant sur une population âgée r
e t r
o u v e
ainsi que 58% d’entr
e eux pensent que la dépr
ession
est une composante nor
m
ale de la vieillesse et 49 %
estiment que c’est un signe de faiblesse. Ce vécu de la
d é p r
ession exp lique e n partie pourquoi les patients
âgés déprimés sollicitent plus souvent les
m
édecin
s
généralistes que les psychiatr
es, même si le motif de la
consultation n’a pas de lien appar
ent avec leur état thy
-
mique.
La réflexion clinique du médecin peut également êtr
e
t r
oublée par sa pr
o p r
e conception du vieillissement,
infiltrée de préjugés, défor
mée par des stéréotypes par
-
fois dif
ficilement révisables. L’idée que la tristesse va de
pair avec le vieillissement est aussi parta gée par de
nombr
eux praticiens. De plus, certains signes cliniques
de la dépr
ession du sujet âgé ne sont pas spécifiques
mais communs (asthénie, apathie, tr
oubles du sommeil,
de l’appétit,…) à d’autres pathologies soma tiques
contemporaines du vieillissement et d’ailleurs volontiers
attribués à ces der
nièr
es. La r
econnaissance de la natu
-
La Revue de Gériatrie, T
ome 28, N°10
DÉCEMRE 2003
838

Le diagnostic d’une dépr
ession chez la personne âgée
r
e dépr
essive du tr
ouble tout comme la réponse théra
-
peutique apportée en sont donc dir
ectement af
fectées.
Une clinique autr
e
Parallèlement à ces ambiguïtés d’
"
expression" et de
"co
m
préhension", la sémiologie pr
o p r
e de la dépr
e s s i o n
du sujet âgé participe à la compl
e
xité du diagnos
tic. La
clinique n’est pas classique, c’est-à-dir
e qu’elle est éloi
-
gnée de ce qui se r
encontr
e dans une population adulte
"
jeune". L’absence d’affects dépressifs e st fréquente
d’où le développement du concept de dépr
ession sans
tristesse.
I
l faut alors plutôt r
e c h e r
cher la présence
d’une perte de goût, d’un sentiment doulour
eux de vide
ou d’une indif
fér
ence af
fective accompagnée d’apathie,
qui devr
ont fair
e penser au diagnostic d’autant plus que
ces symptômes s’associent à une asthénie, des pertur
-
bations de l’appétit ou du sommeil .
La coloration af
fective est donc moins appar
ente tandis
que d’autres signe s d’app el p euvent occuper tout
l’espace clinique et conduire vers de fausses pistes.
Ainsi nous pouvons distinguer de façon sché
m
atique
plusieurs modalités expr
essives qui viennent dominer le
tableau clinique :
• une
anxiété
d’intensité et de for
me diverses, accom
-
pagnée ou non de conduites addictives, par exemple
sous la for
me d’une consommation abusive d’alcool ou
de benzodiazépines ;
•
un mal être physique se traduisant par des douleurs,
des plaintes concernant le fonctionne
m
ent corporel et,
en cor
o l l a i r
e, une quête médicale et une insatisfaction vis
à vis des examens réalisés et des
m
édicaments pr
e s c r i t s ,
tableau qui peut pr
e n d r
e une intensité hypochondriaque ;
• une
symptomatologie délirante
le plus souvent peu
élaborée et composée principalement d’idées de spolia
-
tion ou de vols, impliquant les proches, famille, amis
ou voisins. L’association d
’
idées d’incurabilité, d’indi-
gnité voir
e de culpabilité doit orienter vers un diagnos
-
tic de mélancolie ;
• un co
m
porte
m
en
t
carac
t
ériel, une irritabilité, des
traits de personnalité qui n’étaient pas présents anté-
rieur
ement, mar
quant une ruptur
e dans un mode de vie
et facteur potentiel de dissolution des liens sociaux par
réaction d’évitement ou de r
ejet des pr
oches ;
• un déclin cogn iti
f
modé ré , caractérisé principale-
ment par une perturbation des fonctions exécutives, de
la concentration et de la mémoir
e à court ter
me, et qui
peut faire l’objet de plaintes de la part du sujet dépri
m
é.
Le concept de dépr
ession pseudodémentielle a été éla
-
boré pour décrir
e ces tableaux de dépr
ession compr
e-
nant une atteinte cognitive transitoire et réversible
puisque corrigée par le traitement antidépr
e s s e u r
.
Cependant, comme nous le verr
ons dans le pr
onostic,
la pertinence de ce concept est actuellement débattue.
Ces dif
fér
entes modalités cliniques participent à occul
-
ter la toil
e
de fond dépressive avec certes de s ar
g u
-
ments de poids et suffisam
m
ent préoccupants pour
m o n o p o l i s e r
l’attention et influencer l’investigation
m
édicale. Qu’il s’agisse d
’
une anxiété invalidante, de
signes d’appel d’une maladie organique, de douleurs
handicapantes, inexpliquées et résistantes, ou encore
d’une démence débutante, tout concour
e à déplacer le
pôle de gravité et ainsi de passer à côté d’une dépr
es-
sion sévèr
e, voir
e le cas échéant d’un risque suicidair
e.
Dépr
ession et dépr
essions
Les épisodes mélancoliques sont a ussi préoccupants
que ceux r
encontrés chez les sujets plus jeunes et sont
de réels ur
gences thérapeutiques du fait de la mise en
jeu du pronostic vital. Ce diagnostic doit être évoqué
devant la conviction d’idées d’indignit
é
, d’incurabilité
ou de ruine, associées à une pr
ostration, un mutisme
ou au contrair
e, une grande agitation et une irascibilité.
Les états d’opposition massive r
eprésentent aussi une
for
me grave de la dépr
ession du vieillar
d et s’accompa
-
gnent également d’un comportement régr
essif et d’un
r
efus alimentair
e absolu, sans que des af
fects dépr
essifs
soient exprimés, tableau pr
oche en cela des syndr
omes
de glissement.
Les concepts de dépression mineure (ou
"
subsyndro-
mique
"
) e t de dysthymie ont été dévelop pés p our
dénommer les situations où les critèr
es ne sont pas suf
-
fisants pour répondr
e à la définition DSM de l’épisode
d é p r
e
s
sif sévère ( 4 ). Dans la dépression mineure le
tableau clinique est incomplet
e
t ne dure pas assez
longtemps, tandis que la dysthymie r
eprésente plus une
for
me chr
onique de dépr
ession incomplète. Cependant
la présence d
’
une d
é
pression mineure serait sour
c e
d
’
un handicap
fonctionnel, entraînerait une consom-
mation médical importante et aurait un risque d’évolu
-
tion vers un épisode dépr
essif sévèr
e
(18).
DÉPIST
AGE ET OUTILS D’ÉV
ALUA
TION
_______
L’i
m
portante proportion des épisodes dépressifs non
traités a soulevé la question de l’intérêt de réaliser un
dépistage systématique nota
m
ment en
m
édecine de
ville.
Les critèr
es du DSM-IV pourraient êtr
e plus développés
pour porter le diagnostic dans le cadr
e des dépr
essions
gériatriques. L
e
s variabilités de prévalence suiv
a
nt les
études et les particularités cliniques de cette pathologie
sont autant d’ar
gument en faveur d’une autr
e appr
oche
que l’on pourrait qualifier de gériatrique, en évitant
toute vision adultomorphiste.
La Revue de Gériatrie, T
ome 28, N°10
DÉCEMRE 2003
839

évolution torpide ne doit pas être
m
éconnue car
e
lle
est bien souvent responsable
d’un rejet prématuré du
traite
m
ent donnant lieu à des prescriptions nouvelles
tout aussi inefficaces car poursuivies insuf
f i s a m m e n t
longtemps ou inadaptées. La quête médicale excessive
et l
’
abus de substances psychoanaleptiques
(
anxioly-
tiques, hypnotiques, alcool) illustrent encore les dif
f i c u l t é s
de l’approche diagnostique et thérapeutique de cette
pathologie.
Certaines réper
cussions de l’état dépr
essif chez le sujet
âgé rappellent les situations qui peuvent l’avoir favori
-
sé, r
endant par
fois dif
ficile la distinction entr
e causes et
conséquences. L’isolement, la perte des liens sociaux,
la dégradation de la qualité de vie, le handicap, l’inca
-
pacité fonctionnelle, l
’
institutionnalisation et la dégra-
dation de l’état de santé sont ainsi décrits dans l’évolu
-
tion d
e
s épisodes dépressifs ( 1 6 ) . Une autre co
m
plica-
tion majeur
e r
etr
ouvée dans cette population
de sujets
âgés et dép ri
m
és est une i
m
po rtan te
m
or talité.
L’augmentation de la mortalité car
diovasculair
e et céré
-
br
ovasculair
e mais aussi pr
obablement le suicide parti
-
cipent à cet excès de mortalité.
Risque suicidair
e
Le passage à l’acte suicidair
e demeur
e le risque évolutif
m a j e u r
, soit dans le cadre d’un raptus anxieux, soit
com
m
e issue incontrôlable d
’
un syndro
m
e dé pr
e s s i f
notamment accompagné d’un vécu délirant ou mélan
-
colique. La pathologie thymique est l’étiologie la plus
souvent r
etr
ouvée dans les cas de suicide des sujet âgés
(9).
Dans cette population, le taux de suicide est pratique
-
ment le double de celui de la population générale et il
s’agit le plus souvent d’hommes. Les vieillar
ds réalisent
m
oins de tentatives de suicide que les sujets plus jeu-
nes, mais parviennent plus fréquemment à leurs fins. Ils
font appel plutôt à des méthodes violentes (ar
me à feu,
pendaison, noyade) et potentiellement létales (sur
dosa
-
ge en médicament car
diotoxique)
(10)
. Les idées suicidai
-
r
es précèdent habituellement le passage à l’acte et une
étude rapporte que 75% des sujets âgés qui s’étaient
suicidés avaient consulté un médecin dans le mois pré
-
cédent
(2).
La difficulté consiste donc à apprécier le risque suicidair
e .
Des antécédents de conduite suicidair
e, une symptoma
-
tologie mélancolique, l’expr
ession de pr
opos suicidair
es
(
ruminations ou menaces
)
, un co
m
portement i
m
pulsif
ou une consommation excessive d’alcool, le sexe mas
-
culin sont aut
a
nt de facteurs majorant le risque. La
r
echer
che systématique d’une idéation morbide et suici
-
dair
e est donc primor
dial et même obligatoir
e chez tout
sujet âgé dépri
m
é, en
s
achant que cett
e
investigation
n’augmente pas le risque
(3).
Le diagnostic d’une dépr
ession chez la personne âgée
L’utilisation d’échelles peut apporter une aide dans la
d é m a r
che dia gnostique e t dans l’éva luation de la
d é p r
ession du sujet âgé. D
a
ns ce cadre, la Geriatric
D e p r
ession Scale (GDS
)
est l’échelle de référ
e n c e .
V
alidée, fiable et facile d’utilisation, il s’agit d’un auto-
questionnair
e de 30 questions qui peuvent êtr
e lues au
patient. D’autr
es versions plus courtes ont été validées
notamment les mini GDS à 5 items et la version fran
-
çaise à 4 items
(7)
(cf. tableau mini GDS).
Les échelles ne permettent pa
s
cependant de distin-
guer la dépression sévère d’autres for
m
es de dépr
e s
-
sion comme la dysthymie, la dépr
ession mineur
e ou la
dépr
ession en rémission partielle ou encor
e débutante.
De plus, le choix du seuil de positivité partielle modifie
les degrés de sensibilité et spécificité et par suite les
risques de poser le diagnostic de dépr
ession par excès,
ou a u contraire de passer à côté d’une dépr
e s s i o n
authentique.
ÉVOLUTION ET PRONOSTIC
___________________
Evolution
L’évolution pr
opr
e de la dépr
ession du sujet âgé se fait
vers la chr
onicité ou la récidive dans plus de la moitié
des cas (8).Le patient est donc confiné dans une souf
-
france par
fois intense et durable, concourrant à l’épui
-
sement de la famille comme du médecin traitant. Cette
La Revue de Gériatrie, T
ome 28, N°10
DÉCEMRE 2003
840
T
ableau mini GDS (Clément et al., 1997)
Poser les questions au patient en lui précisant que, pour répondr
e, il doit
se r
esituer dans le temps qui précède, au mieux une semaine, et non pas
dans la vie passée ou dans l’instant présent.
1.
V
ous sentez-vous découragé(e) et triste ?
oui
non
2.
A
vez-vous le sentiment que votr
e vie est vide ?
oui
non
3.
Etes-vous heur
eux(se) la plupart du temps ?
oui
non
4.
Avez-vous l’impr
ession que votr
e situation est désespérée ?
oui
non
Cotation :
Question 1 : oui :1, non :0
Question 2 : oui :1, non : 0
Question 3 : oui :0, non : 1
Question 4 : oui :1, non : 0
Si le scor
e est supérieur ou égale à 1 : forte pr
obabilité de dépr
ession
Si le scor
e est égale à 0 : forte pr
obabilité d’absence de dépr
ession.

Le diagnostic d’une dépr
ession chez la personne âgée
Dépr
ession et déclin cognitif
Le déficit cognitif est également décrit comme un des
risque s é volutifs de la dé pression du suje t âgé .
Actuelle
m
ent, les liens e ntre dépression et démence
restent obscurs. Cependant plusieurs arguments plai-
dent en faveur de l’hypothèse suivante : la dépr
ession
t a r
dive serait un facteur de risque d
’
évolution vers un
syndr
ome démentiel, ou du moins un pr
odr
ome ou la
pr
emièr
e manifestation d’un pr
ocessus neur
odégénéra
-
tif. Co
m
me il a été signalé plus haut, des signes de
déficit cognitif peuvent être r
e t r
ouvés dans le tableau
clinique de la dépr
ession du sujet âgé, et ce, plus sou
-
vent dans les premiers épisodes (sans aucun antécédent
thy
m
ique
)
( 1 6 )
.
Par ailleurs les résultats d
’
études pro-
spectives récentes sont assez tr
oublants. D’une part la
d é p r
ession pseudo d
é
mentielle s’acco
m
pagne d’un
risque d’évolution vers un tableau de démence consti
-
tué même si la réponse thérapeutique initiale avait été
satisfaisante ( 3 ), d
’
autre part l’existence de symptô
m
es
d é p r
essifs est prédictif de l’app arition d’un dé ficit
cognitif voir
e d’une maladie d’Alzheimer
(17,19)
.
CONCLUSION
__________________________________
La dépr
ession et ses dif
fér
ents modes d’expr
ession r
en-
contrés dans la population âgée
est une pathologie
grave avec des réper
cussions dir
ectes sur la qualité de
vie e t un pronostic péjoratif. En dehors des tableaux
symptomatiques classiques, elle devrait êtr
e systémati
-
quement évoquée devant toute clinique bâtar
de qui ne
fait pas la pr
euve de son origine or
ganique, surtout s’il
existe une perturbation de l’ali
m
entation ou du
so
m
-
meil.
Une détection précoce est souhaitable afin de
m
ettre
en place une prise en char
ge rapide et adaptée, et pré
-
venir ainsi la survenue de risques éventuels notamment
s u i c i d a i r
es. Les échelles peuvent être utiles dans la
démar
che diagnostique mais demeur
ent un outil et non
un référ
entiel. Leur utilisation peut néanmoins appor
-
ter une ouvertur
e dans l’échange avec le patient sur la
question de sa souf
france morale et guider l’investiga
-
tion clinique.
L ’ a p p r
oche diagnostique doit être raisonnée et arg u-
men tée, pour pe r
m e t t r
e la r eco nna issan ce de la
dépr
ession, d’évaluer les risques éventuels et d’agir en
conséquence. Il ne s
’
agit pas non plus de poser par
exc
è
s le diagnostic de dépression dont le traite
m
ent
n’est pas anodin, de passer à côté d’une pathologi
e
so
m
atique, ni de négliger une dépression associée à
une pathologie démentielle par exemple.
■
La Revue de Gériatrie, T
ome 28, N°10
DÉCEMRE 2003
841
RÉFÉRENCES
__________________________________
1.
Addonizio G, Alexopoulos GS.
Af
fective disor
ders in the elderly.
Int J
Geriatr Psychiatry,
1993;8:44-47.
2.
Alexopoulos GS.
Geriatric depr
ession r
eaches maturity (editorial).
Int J
Geriatr Psychiatr
1992;7:305-306.
3.
Alexopoulos GS, Borson S, Cuthbert BN, Devanand DP
, Mulsant
BH. et al.
Assessment of late life depr
ession.
Biological Psychiatry
2002;52:164-174.
4.
American Psychiatric Association, Manuel diagnostique et statistique des
tr
oubles mentaux, 4ème édition (V
ersion Inter
nationale, W
ashington DC,
1995). T
raduction française par Guelfi J.D. et al. Masson ; Paris, 1996.
5.
Baldwinn RC. O’Brien J.
V
ascular basis of late-onset depr
essive disor -
der
.
Br J Psychiatry
2002;180:157-60.
6.
Clément JPK, Léger JM.
Clinique et épidémiologie de la dépr
ession du
sujet âgée. In : Les dépr
essions du sujet âgé. Paris. Acanthe, Masson, 1996
: 19-26.
7.
Clément JP
, Nassif R, Léger JM, Mar
chan F
.
Mise au point et contri
-
bution à la validation d’une version française brève de la Geriatric
Depr
ession Scale de Y
esavage. L’Encéphale 1997;23:91-99.
8.
Cole MG, Bellavance F
, Mansour A.
Pr
ognosis of depr
ession in elder
-
ly community and primary car
e populations : a systematic r
ewiew and
meta-analysis.
Am J Psychiatry
1999;156:1182-89.
9.
Conwell Y
, Olsen K, Caine ED, Flannery C.
Suicide in later life :
Psychological autopsy findings
. Int Psychogeriatrics
1991;3:56-59.
10.
Conwell Y
, Duberstein PR, Caine ED.
Factors for suicide in later life.
Biological Psychiatry
2002;52:193-204.
11.
Judd LL, Rapaport MH, Paulus MP
, et al.
Subsyndr
omal symptoma
-
tic depr
ession : a new mood disor
der
.
J Clin Psychiatry,
1994;55S:18-28.
12.
Koenig HG, Meador KG, Shelp, Goli, Cohen HJ, Blazer DJ.
Major
depr
essive disor
der in hospitalized medically ill patients : an examination of
young and elderly veterans.
J Am Geriatr Soc,
1991;39:881-89.
13.
Kukull W
A, Koepsell TD, Inui TS, Borson S, Okimoto J, Raskind
MA, et al.
Depr
ession and physical illnesss among elderly general medi
-
cal clinic patients.
J Af
fect Dis,
1986;10:153-62.
14.
Léger JM, Paulin S.
La prévalence de la dépr
ession augmente considé
-
rablement après 65 ans.
Revue Prat (Méd Gén),
1998;12(405):13-16.
15.
National Mental Health Association.
American Attitudes about clinical
d e p r
ession and its traitemen t :
survey imp lica
t
io ns for older
americans.Alexandria, 1996, V
A.
16.
Pallsson S, Skoog I.
The epidemiology of af
fective disor
ders in the
elderly : a r
eview.
Inter
national Clinical Psychophar
macology
1997;12,
(suppl 7) : 3-13.
17.
Pater
niti SS, V
erdier-T
aillefer MH, Dufouil C, Alpér
ovitch A.
Depr
essive symptoms and cognitive decline in elderly people.
Br J
Psychiatry
2002;181:406-10.
18.
Rapaport M, Judd LL, Schettler PJ, Y
onkers KA, Thase ME,
Kupfer DJ. et al.
A descriptive analysis of minor depr
ession?
Am J
Psychiatry
2002;159:637-43.
19.
W
ilson RS, Bar
nes LL, Mendes de Leon C, Aggarwal NT
,
Schneider JS. et al.
Depr
essive symptoms, cognitive decline, and risk of
AD in older persons.
Neur
ology
2002;59:364-70.
V
oir QCM page suivante
 6
6
1
/
6
100%