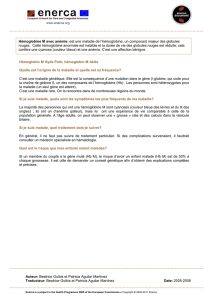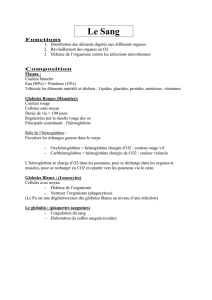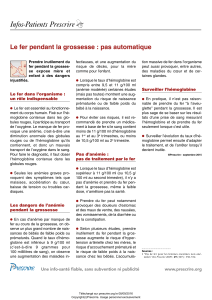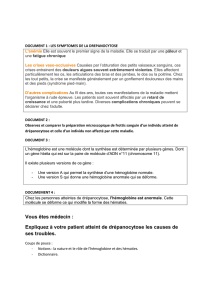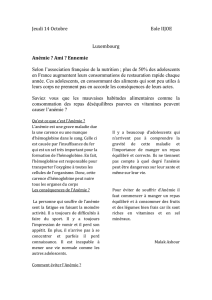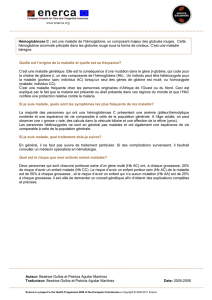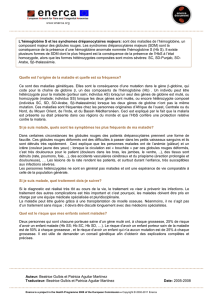anemie - Lyon Sud

-
122
-
ANEMIE
L'anémie est définie par la diminution de la masse totale d'hémoglobine intra-érythrocytaire
circulante. Les paramètres érythrocytaires ne permettent donc ni de définir, ni même de
diagnostiquer avec certitude l'état d'anémie. En effet, ils ne donnent que des valeurs
relatives, rapportées à un certain volume de sang. Leurs variations, en plus ou en moins
peuvent être liées à des modifications de la masse érythrocytaire totale, ou de la volémie
plasmatique.
Pour le diagnostic positif d'anémie, ces paramètres peuvent être en défaut dans plusieurs
circonstances :
Ø Lors d'une hémorragie aiguë, la perte simultanée de plasma et de globules rouges crée
un retard dans la baisse des paramètres érythrocytaires : l'hémoglobine et l'hématocrite ne
s'abaisseront que lorsque l'organisme compensera l'hypovolémie sanguine par une
augmentation du volume plasmatique.
Ø Lors des états d'hémodilution (grossesse, splénomégalies volumineuses,
gammapathies monoclonales), la baisse parfois notable de l'hématocrite et de
l'hémoglobine ne correspond pas à une diminution de la masse érythrocytaire.
Nous envisagerons ici les anémies en dehors des anémies aiguës hémorragiques.
I - DIAGNOSTIC POSITIF
A - LE SYNDROME ANEMIQUE :
L'anémie peut être suspectée sur les éléments cliniques du syndrome anémique : pâleur
cutanéo-muqueuse, dyspnée d'effort, hypotension, tachycardie.
En situation aiguë (hémorragie, hémolyse intra-vasculaire), ce syndrome permet à lui seul
de poser le diagnostic d'anémie. Les paramètres cliniques : pression artérielle, fréquence
cardiaque, diurèse donneront des critères de gravité guidant la réanimation.
En situation chronique, par contre, les éléments du syndrome anémique peuvent être
dissociés, voir absents en raison de l'adaptation de l'organisme à l'état d'anémie. Dans ce
cas, les paramètres biologiques permettront le diagnostic d'anémie et en apprécieront la
gravité.
B - LE DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE D'ANEMIE :
Les 2 paramètres essentiels pour poser le diagnostic d'anémie sont le taux d'hémoglobine et
l'hématocrite. On parlera d'anémie pour :
Ø Un taux d'hémoglobine inférieur à 13 g/dl chez l'homme
Ø Un taux d'hémoglobine inférieur à 11,5 g/dl chez la femme
Pour l'hématocrite, on peut retenir : 0,40 chez l'homme et 0,37 chez la femme
II - DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL
Ils on été envisagés dans l'introduction. Les paramètres biologiques sont un bon reflet de
l'anémie sauf :

-
123
-
Ø En situation aiguë : l'hémoglobine et l'hématocrite sous la quantité réelle d'hémoglobine
fonctionnelle circulante.
Ø Lors des états d'hémodilution: grossesse, splénomégalies, gammapathies, insuffisance
rénale. Dans ces cas au contraire, l'anémie est surestimée voire créée par les variations
plasmatiques ("fausse anémie par hémodilution").
Ø Lors des états d'hémoconcentration (déshydratation, diurétiques), l'anémie peut au
contraire être masquée ou sous-estimée.
III - DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE
Le diagnostic étiologique est guidé par un paramètre essentiel : le Volume Globulaire Moyen
( VGM) :
Ø VGM inférieur à 80 fl : anémies microcytaires
Ø VGM entre 80 et 100 fl : anémies normocytaires
Ø VGM supérieur à 100 fl : anémies macrocytaires
A - ANEMIE MICROCYTAIRE : Etat des réserves en fer ?
La cause principale d'anémie microcytaire est la carence martiale. L'appréciation des
réserves en fer est donc la première étape diagnostique des anémies microcytaires :
1 - Ferritine basse (ou fer sérique bas + transferrine élevée) = carence martiale :
Le myélogramme est inutile. Il ne montrerait que l'absence de fer dans les érythroblastes et
les macrophages.
La suite du bilan devra chercher la cause de la carence martiale. Par argument de
fréquence : hémorragies chronique ( causes gynécologiques chez la femme, sinon,
pratiquement toujours digestives)
2 - Ferritine normale ou élevée = maladie de l'hémoglobine ou syndrome
inflammatoire :
Une anémie microcytaire avec ferritine normale doit évoquer une thalassémie. Il existe
souvent, dans ce cas une pseudopolyglobulie. L'examen à faire est une électrophorèse de
l'hémoglobine.
Certaines anémies inflammatoires sont microcytaires. Il faut donc penser à rechercher un
syndrome inflammatoire (VS, CRP) devant une anémie microcytaire à ferritine normale ou
élevée (la ferritine est aussi une protéine inflammatoire).
3 - Causes rares :
Devant une anémie microcytaire sans carence martiale, ni syndrome inflammatoire ni
anomalie électrophorétique de l'hémoglobine, il faut envisager certaines causes rares :
Ø Alpha thalassémies : diagnostic par biologie moléculaire
Ø Dysérythropoïèses congénitales ou acquises: anémies sidéroblastiques, saturnisme. Le
diagnostic repose sur le myélogramme.

-
124
-
B - ANEMIE NORMOCYTAIRE : Régénératives ?
Les globules rouges ont un aspect normal. La question est de savoir s'ils sont fabriqués en
quantité suffisantes et détruits ou perdus trop vite (hyperhémolyse ou hémorragie) ou si la
production médullaire est insuffisante. Un paramètre répond en général à cette question : le
taux des RETICULOCYTES.
Ø Réticulocytes > 140 x 109/l = anémie régénérative : pas de myélogramme
Ø Réticulocytes normaux (40 à 140 x 109/l), hémoglobine basse = anémie non
régénérative : myélogramme
1 - Anémie normocytaire non régénérative :
La moelle est incapable de répondre aux besoins de production érythrocytaire. Il sera donc
nécessaire de l'examiner pour connaître la cause de cette anémie centrale.
Toutes les pathologies médullaires sont possibles. On pourra, de façon schématique,
trouver :
Ø Un myélogramme riche, mais pathologique : leucémie, lymphome, cancer,
myélodysplasie...
Ø Un myélogramme pauvre, nécessitant le recours à la biopsie médullaire pour
différencier les aplasies médullaires et les myélofibroses.
2 - Anémie normocytaire régénérative :
La moelle répond normalement à une demande d'augmentation de production
érythrocytaire. Celle-ci peut-être due à :
Ø Une hémorragie aiguë récente : l'hémorragie importante ayant le plus de risque d'avoir
été méconnue par le patient est le melaena. La notion d'hémorragie digestive récente doit
donc être cherchée en priorité par un interrogatoire précis.
D'autres hémorragies aiguës peuvent avoir été méconnues, dans des contextes cliniques
particuliers : hémorragies rétro ou intra-péritonéales, intra-pleurale.
Ø Une hyperhémolyse : l'hémolyse est le processus physiologique de destruction
érythrocytaire. Les anémies hémolytiques résultent de l'exagération pathologique de ce
processus, dépassant les capacités de régénération médullaire.
La démarche diagnostique vise tout d'abord à mettre en évidence le processus
d'hyperhémolyse. La triade pâleur, ictère, splénomégalie peut orienter vers ce mécanisme.
Ø Hémolyse aiguë intra-vasculaire avec hémoglobinémie plasmatique et hémoglobinurie.
Ø Hémolyse chronique avec hyperbilirubinémie (libre) et baisse de l'haptoglobine.
Une fois affirmée l'hyperhémolyse, il est nécessaire d'en identifier la cause. Celle-ci est
souvent trouvée grâce à des examens simples : examen attentif des frottis érythrocytaires,
électrophorèse de l'hémoglobine et test de Coombs.
Ainsi pourront être reconnues :
Ø Les anémies hémolytiques d'origine corpusculaire, habituellement congénitales :
- Maladies membranaires : Minkowski-Chauffard, acanthocytoses...
- Maladies de l'hémoglobine : hémoglobinoses S, C, D, E, thalassémies
- Maladies enzymatiques : déficit G6PD, pyruvate kinase

-
125
-
Ø Les anémies hémolytiques extra-corpusculaire, habituellement acquises :
- Anémies hémolytiques auto-immunes
- Allo et iso-immunisations
- Anémies par fragmentation : syndromes hémolytique et urémique, CIVD,
fragmentation sur valves.
- Anémies toxiques, infectieuses.
C - ANEMIE MACROCYTAIRES NON REGENERATIVE : carentielle?
Avant d'envisager le diagnostic étiologique d'une anémie macrocytaire, il faut s'assurer qu'il
ne s'agit pas d'une fausse macrocytose induite par une hyper-réticulocytose. La constatation
d'une hyper-réticulocytose doit amener à raisonner comme s'il s'agissait d'une anémie
normocytaire régénérative.
La macrocytose témoigne habituellement d'une dysérythropoïèse. Dans certains cas, cette
dysérythropoïèse a des caractères cytologiques particuliers regroupés sous le nom de
mégaloblastose.
La mégaloblastose se caractérise dans le sang par la présence de gros globules rouges
avec quelques anomalies qualitatives (corps de Jolly, anneaux de Cabot), de polynucléaires
dits hypersegmentés et parfois de plaquettes géantes. Elle est surtout caractéristique au
niveau de la moelle osseuse : métamyélocytes géants, éléments érythroblastiques très
nombreux, de grande taille avec asynchronisme de maturation nucléo-cytoplasmique,
chromatine perlée, et présence parfois d'anomalies mégacaryocytaire, moins spécifiques.
C'est la raison pour laquelle un myélogramme est souvent l'examen pratiqué en premier
devant une macrocytose inexpliquée. Il doit être fait avant toute transfusion ou avant toute
prise médicamenteuse.
1 - Moelle mégaloblastique : Vitamine B12, folates, médicaments ?
Les principales étiologies des mégaloblastoses sont :
Ø Les carences en vitamine B12, dont les étiologies principales sont la maladie de
Biermer à rechercher par un test de Schilling, les gastrectomies ou résections iléales non
supplémentées en B12, et certaines maladies iléales.
Ø Les carences en folates : il est nécessaire de doser les folates sériques et les folates
intra-érythrocytaires. La cause principale est la carence d'apport (vieillard, femme
enceinte), plus rarement les malabsorptions digestives.
Ø Les médicaments : antifoliques, certains antiépileptiques.
2 - Moelle non mégaloblastique : alcool, médicaments, hémopathie ?
Les macrocytoses sans mégaloblastose peuvent se voir dans les étiologies précédentes
lorsqu'un traitement ou une transfusion ont été mis en place avant le myélogramme
("mégaloblastose décapitée").
Sinon, les étiologies à envisager sont :
Ø L'alcool, sachant que la macrocytose est fréquente, mais l'anémie rare du moins en
l'absence d'autre cause d'anémie.
Ø Les médicaments : antimitotiques, sulfamides, antirétroviraux.
Ø Les hémopathies : le myélogramme en fait le diagnostic. La plupart des hémopathies
peuvent donner une anémie macrocytaire. Ce sont principalement :
Ø Les myélodysplasies : anémie sidéroblastique, anémie réfractaire avec excès de
blastes, anémie réfractaire pure, syndrome myélomonocytaire.

-
126
-
Ø Les hypoplasies médullaires
Ø La splénectomie
Ø Les insuffisances thyroïdiennes ou anté-hypophysaires.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
1
/
25
100%