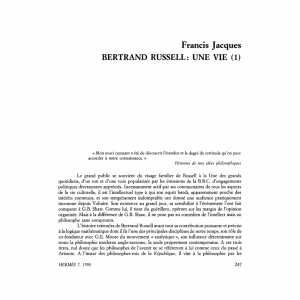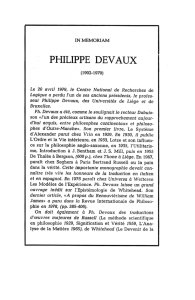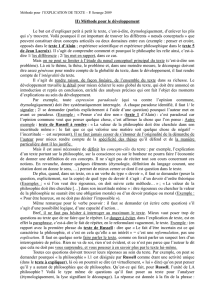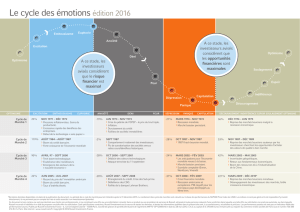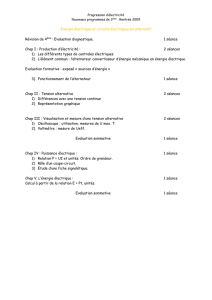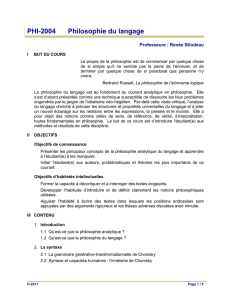Présentation - Université Grenoble Alpes

PRÉSENTATION
Publié en décembre 1917, Mysticisme et logique se présente comme un
recueil de dix articles écrits entre 1901 et 1915. Comme l’indique Russell
dans sa Préface, certains de ces articles sont « populaires » et d’autres
« techniques ». De fait, une première lecture ne peut manquer de faire
apparaître une double disparité : de style et de contenu.
Les articles populaires sont écrits en un style fleuri qui recourt quasi
systématiquement à de multiples métaphores souvent longuement et
parfois laborieusement filées. On en trouvera deux exemples patents tout
au long du troisième article « La profession de foi d’un homme libre » qui
décrit avec des accents tragiques la lutte contre les puissances des Ténèbres
et la « religion de Moloch » comme au début du quatrième article « L’étude
des mathématiques » où sont dépeintes avec emphase les conditions
d’accès au Temple de la connaissance. Toujours dans sa Préface, Russell
justifie l’emploi de ce style ampoulé dans le cinquième article « Les
mathématiques et les métaphysiciens », écrit en 1901 un an plus tôt que le
précédent, par le fait que l’éditeur lui demanda de rendre l’article « aussi
romantique que possible » ! Les lecteurs des Principes de la mathématique,
de l’article fameux « De la dénotation », ou même des Problèmes de
philosophie ne manqueront pas d’être étonnés par une écriture qui pourtant,
de façon plus ou moins accentuée, caractérise toute l’œuvre « populaire »
du philosophe. Mais ils pourront retrouver le style précis et lumineux,
simple et subtil qui déploie toute sa puissance analytique dans les articles
« techniques ». C’est par exemple le cas des pages consacrées au principe
de compréhension des propositions, à l’analyse des notions de réalité, de
cause, de matière, au processus de construction de l’espace, des objets, etc.
Par-delà cette disparité stylistique, frappe, surtout, l’apparente hétéro-
généité des thèmes. Sont abordées les questions du statut de la philosophie
et de sa méthode, du rôle et de la valeur de l’éducation scientifique, de la
construction de la connaissance physique, de la définition de la matière, de
la causalité, de la fonction gnoséologique des descriptions, enfin et surtout

8DENIS VERNANT
du « mysticisme » ! Si l’ouvrage n’était paru en 1917 à une époque cruciale
dans le développement de la pensée de Russell, on pourrait croire qu’il
s’agit d’un recueil mineur dans lequel l’auteur recycle des « fonds de
tiroir ». Il suffirait alors d’aller chercher quelques perles dans ce fatras. Une
telle appréciation justifierait le fait qu’en 1922 le traducteur français se soit
arrogé le droit d’opérer une sélection ne retenant que quatre articles 1.
En fait, l’organisation de l’ouvrage est parfaitement maîtrisée et
l’association d’articles de styles et de contenus différents délibérée. Lire de
façon pertinente ce recueil requiert donc de poser la question de l’unité de
l’ouvrage et, par-delà, de toute l’œuvre de Russell et, in fine, de sa vie
même. À cet égard, il convient de prendre au sérieux son titre qui pose
frontalement la question des relations entre mysticisme et logique.
LOGIQUE
À l’aube du XX e siècle, la logique moderne fut inventée deux fois.
D’abord par le philosophe et mathématicien d’Iéna Gottlob Frege à partir
d’une genèse mathématique procédant à une extension et à une généralisa-
tion du concept de fonction 2. Ensuite par Bertrand Russell, philosophe et
mathématicien de Cambridge, à partir d’une genèse grammaticale exploi-
tant l’analyse de la proposition issue de la grammaire philosophique 3.
Chez Russell, complètement symbolique et formalisée, cette logique
comporte d’abord un calcul dit des « propositions », système formel qui, à
partir de propositions primitives présentant les axiomes et les règles
d’inférence, régit la déduction des théorèmes. Viennent ensuite les calculs
fonctionnels à une ou à deux variables. Le premier, recourant au schéma
fonctionnel F(x), correspond au calcul des prédicats monadiques. Le
second, usant de la fonction F(x, y) (ou même F(x, y, z), etc.), constitue le
calcul des relations dyadiques (triadiques, etc.).
1. Parue chez Payot, cette traduction de Jean de Menasce ne comportait que : « Le
mysticisme et la logique », « L’étude des mathématiques », « La méthode scientifique en
philosophie » et « De l’idée de cause ».
2. Cf. Idéographie (1879), trad. C. Besson, postface de J. Barnes, Paris, Vrin, 1999.
3. Cf. Les Principes de la mathématique (1903), traduit partiellement par J.-M. Roy dans
Écrits de logique philosophique, Paris, P.U.F., 1989. Son Appendice A comportait une étude
sur Frege que Russell avait découvert après la rédaction de l’ouvrage. Nous ne pouvons ici
revenir sur cette genèse capitale pour comprendre les relations entre philosophie, logique et
mathématiques chez Russell, cf. notre Philosophie mathématique de Bertrand Russell, Paris,
Vrin, 1993.

PRÉSENTATION 9
Même dans les articles « techniques », Russell ne revient pas explici-
tement sur cette logique. Mais bien souvent il en rappelle l’importance et
constamment il la présuppose. À l’époque, la logique frégéo-russellienne
a d’abord constitué le modèle des sciences a priori, déductives et
formelles. Elle a participé au mouvement qui, de Peano à Hilbert, contribua
à élaborer le concept de système formel qui, fondé sur une axiomatique
explicite, procède par démonstrations en excluant tout recours à une
quelconque intuition. Elle a fourni ensuite des outils précis et féconds
d’analyse et de déduction. Chez Russell, elle donna naissance au projet
grandiose d’une réduction logiciste de toutes les mathématiques (géo-
métrie comprise à la différence de Frege). Esquissé informellement dès
1903 dans les Principes de la mathématique, ce projet fut réalisé formel-
lement dans les trois volumes des Principia Mathematica avec l’aide de
Whitehead 1. Ainsi que le rappelle Russell en maints endroits de Mysticisme
et logique, même si ce projet grandiose échoua de peu, il n’en contribua
pas moins à clarifier et à épurer la pratique comme l’enseignement des
mathématiques modernes.
Logique & analyse
Mais le rôle de la logique nouvelle fut encore plus déterminant en
philosophie. En fournissant une méthode d’analyse des notions, de défini-
tion formelle des concepts et de résolution (ou de dissolution) des problè-
mes, la logique formelle donna naissance à ce qui fut appelé par la suite la
« philosophie analytique » et que Russell préfère qualifier de « méthode
scientifique en philosophie » 2 ou même « philosophie scientifique » 3. Sans
pouvoir entrer dans les détails, rappelons seulement deux exemples signifi-
catifs de cet apport crucial de la logique en philosophie : le principe des
relations externes et la méthode de définition contextuelle 4.
1. Les trois chapitres du premier volume sont traduits partiellement dans les Écrits de
logique philosophique.
2. C’est précisément le titre de l’article composant ici le chapitre 6 où Russell insiste sur
le fait que l’adoption de la méthode scientifique en philosophie autorise un progrès des
connaissance en ce domaine, p. 115 sq. C’est aussi une partie du titre de Our Knowledge of the
External World as a Field for Scientific Method in Philosophy publié en 1914 (qui deviendra
le titre lors de la réédition en 1926).
3. Cf. par exemple, ici « Mysticisme et logique », p. 54.
4. Dans notre Bertrand Russell, Paris, Garnier-Flammarion, 2003, nous examinons
comment l’usage de l’outil logique a déterminé l’élaboration et l’évolution de toute sa pensée
philosophique.

10 DENIS VERNANT
La logique moderne doit la plus grande part de sa fécondité analytique à
l’invention du calcul des relations 1. D’Aristote à Leibniz 2, la tradition
syllogistique réduisait l’analyse de toute proposition au schéma devenu
classique : sujet/copule/prédicat. Cela conduisait à n’admettre pour seul
lien que celui d’inhérence du prédicat dans le sujet et à réduire, nolens
volens, les relations à des prédicats et donc à interpréter la proposition
« Georges aime Marie » en termes de : « Georges est amoureux de Marie ».
À ce postulat des relations internes, Russell oppose son principe des rela-
tions externes selon lequel les relations constituent d’authentiques concepts
qui relient deux individus indépendants. Dès lors, la proposition « Georges
aime Marie » exprime un fait qui relie Georges à Marie au moyen de la
relation relatante : aime 3. La force analytique du concept nouveau de
fonction propositionnelle réside en ce qu’il peut aussi bien s’appliquer aux
prédicats d’individu selon le schéma F(x) qu’aux relations reliant deux
individus selon l’autre schéma F(x,y). Techniquement, on disposait enfin
du moyen de rendre compte du raisonnement suivant : « Si Olivier est le fils
de Jacques alors Jacques est le père d’Olivier », question qui était restée
pendante depuis Galien ! Mais aussi et surtout Russell disposa du moyen
d’opérer une critique logique du monisme idéaliste d’inspiration hégé-
lienne qui dominait à son époque l’enseignement de Cambridge avec
Francis Bradley, John McTaggart, Harold Joachim, etc. Dans Appearance
and Reality, ouvrage paru en 1893 et qui eut une grande influence, Bradley
prétendit que les relations n’ont pas de réalité propre, que la pluralité est
contradictoire et qu’au terme n’existe que la Réalité qui, en toute rigueur,
ne peut s’appréhender conceptuellement : « Même la vérité absolue semble
ainsi, à la fin, se révéler erronée. Et il faut admettre qu’à la fin aucune vérité
possible n’est entièrement vraie » 4. Pour Russell, ce genre de conception ne
repose que sur le refus traditionnel des relations externes. Admettre les
relations comme d’authentiques concepts conduit au contraire à un « ato-
misme logique » qui rend compte de la pluralité des choses et autorise une
connaissance partielle et provisoire du monde. Lorsque Russell fait al-
1. Cf. ici « Les mathématiques et les métaphysiciens », chap. 5, p. 89. Pour ne prendre
qu’un exemple du rôle de la logique des relations, dans « Sur la notion de cause » Russell
recourt à la différence entre relations plusieurs-un et un-un pour lever les confusions sur les
rapports entre esprit et matière, chap. 9, p. 181.
2. Cf. B. Russell, La Philosophie de Leibniz (1900), trad. J. et R. Ray, Paris ; réimp.,
Gordon & Breach, 1970.
3. Assumant la fonction d’assertion, la relation effectivement relatante assure l’unité de
la proposition, cf. notre Philosophie mathématique de Russell, § 7, p. 43-53.
4. Appearance and Reality, A Metaphysical Essay, London, Sonnenschein, p. 544.

PRÉSENTATION 11
lusion aux arguments logiques contre le mysticisme philosophique, il
pense avant tout à cette argumentation qu’il reprend sur tous les tons 1.
Le second exemple de l’apport de la logique à la philosophie relève de
sa théorie des descriptions définies exposée en 1905 dans son célèbre
article « De la dénotation ». Apparemment, l’enjeu est purement techni-
que : il s’agit de recourir à la nouvelle logique (et en particulier à la quantifi-
cation) pour rendre compte formellement de l’usage des expressions
dénotantes telles « L’actuel Roi de France », « Le cercle carré », etc. Russell
résout définitivement la question en recourant aux définitions contex-
tuelles. Sans reprendre la formalisation qui est maintenant bien connue,
rappelons simplement que dans le jugement « L’actuel Roi de France est
chauve » l’expression « L’actuel Roi de France » fonctionne comme une
description définie qui décrit conceptuellement un individu supposé
unique et existant. Le jugement en question s’analyse alors en « Il existe un
et un seul individu qui est actuellement Roi de France et chauve ». Dès lors,
la description « L’actuel Roi de France » ne fait que « contribuer à la signi-
fication » du jugement complet en fournissant deux conditions d’unicité et
d’existence et une qualification contextuelle 2.
Techniquement, cette analyse s’avéra déterminante dans la mesure où
elle introduisait un nouvel opérateur de singularité – ©x – permettant
de désigner conceptuellement un individu déterminé. Mais ses consé-
quences philosophiques furent tout aussi importantes. Sémantiquement,
elle introduisait une distinction marquée entre les noms propres logiques
qui fonctionnent comme d’authentiques symboles signifiant directement
(meaning) des individus effectivement donnés et les descriptions définies,
conçues désormais comme des symboles incomplets, ne faisant que
décrire conceptuellement des individus dont ni l’existence ni l’unicité ne
sont garanties (denoting). Gnoséologiquement, la distinction symbolique
précédente se double d’une distinction cruciale entre l’accointance comme
mode d’appréhension directe des objets des sens comme des universaux et
la connaissance par description qui relève de l’usage discursif des descrip-
tions définies. L’article « Connaissance par accointance/ connaissance par
description » (chap. 10) est précisément consacré à un examen fouillé de
cette question. Dès lors, la compréhension d’une proposition repose sur la
réduction des éléments descriptifs à ceux, irréductibles, accessibles par
1. Cf. ici même, chap. 1, p. 44. On pourra trouver un exemple de l’argumentation de
Russell sur ce point dans le chapitre 5, intitulé : « Révolte contre l’idéalisme et pluralisme »,
de son autobiographie intellectuelle Histoire de mes idées philosophiques, trad. G. Auclair,
Paris, Gallimard, 1959, p. 67-80.
2. Cf. notre Philosophie mathématique de Russell, § 44-46, p. 306-318.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%