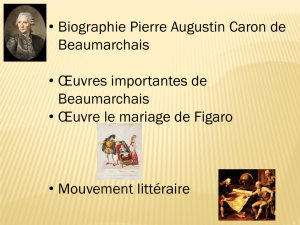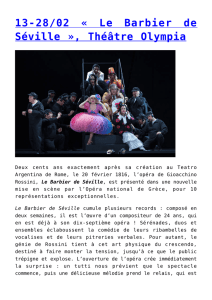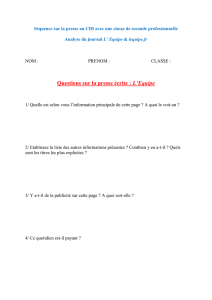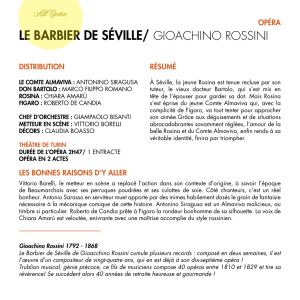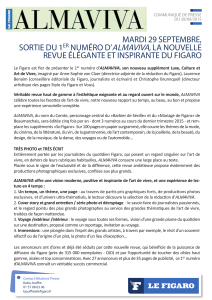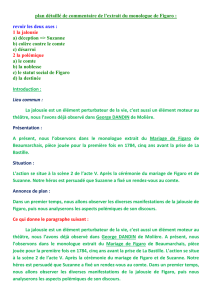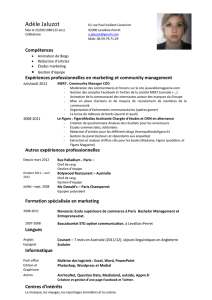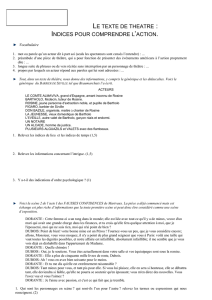ACTE I : Scène 1. Dans la rue, devant la maison du docteur Bartolo

ACTE I :
Scène 1. Dans la rue, devant la maison du docteur Bartolo. Le
Comte Almaviva, grand d’Espage, est amoureux de Rosine, la pupille de
Bartolo. Avec son valet Fiorello et quelques musiciens, il lui offre une sé-
rénade sous son balcon : Ecco ridente in cielo. Le paiement des musiciens
entraîne un remue-ménage, pendant lequel arrive Figaro, qui entonne son
fameux air : Largo al factotum de la città. Figaro est le barbier de Bartolo
et il se propose pour introduire d’une façon ou d’une autre le Comte auprès
de Rosine. Mais le tuteur veille car il a bien l’intention de la prendre pour
femme. Basilio, le maître de musique, va dans son sens. Malgré la surveil-
lance étroite, Rosine réussit à laisser tomber de son balcon une lettre dans
laquelle elle demande son nom au soupirant… Il lui répond, dans une aria,
qu’il se nomme Lindoro. La scène se termine par un duo Almaviva/Figaro
en deux parties, célébrant l’Amour puis Figaro lui-même..
Scène 2. Dans la maison de Bartolo. Rosine chante le brillant
Una voce poco fa, suivi de Io sono docile. Bartolo soupçonne Almaviva
d’être présent en ville et de convoiter Rosine. Basilio lui conseille de faire
éclater un scandale, dans une aria qui est un morceau de bravoure tout en
crescendo La calumnia. Figaro annonce à Rosine que Lindoro est son cou-
sin et Rosine lui remet un billet : duo Dunque io son, tu non m’ingani ?
Bartolo qui a aperçu le manège du billet prévient qu’on ne peut le tromper
A un dottor de la mia sorte. Suivant le conseil de Figaro, le Comte entre
en force, déguisé en soldat ivre qui doit être hébergé. Le gardien de Rosine
veut faire arrêter le prétendu soldat, mais le Comte se fait connaître discrè-
tement à l’officier de police et la scène se termine dans une apparente
confusion qui est un sextuor parfaitement mené Fredda e immobile.
ACTE II :
Le Comte ressurgit dans la maison de Bartolo, déguisé cette
fois en professeur de musique, qui vient remplacer Basilio souffrant. Il ga-
gne la confiance de Bartolo en lui donnant la lettre de Rosine, mais il l’at-
tribue à une maîtresse du Comte. S’en suit la leçon de musique, sous sur-
veillance, mais pendant laquelle les amoureux réussissent à s’approcher.
Figaro obtient par ruse la clef nécessaire à une évasion de Rosine, prévue
pour minuit. Mais Basilio réapparaît ! Il faut toute l’énergie des amoureux
et surtout une bourse du Comte pour le persuader qu’il est malade. Il part
après le quintette Buona sera, mio Signore. Figaro commence à raser Bar-
tolo, mais celui-ci reste méfiant et surprend une conversation compromet-
tante. Resté seul avec Rosine, Bartolo montre la lettre, qui excite la jalou-
sie de sa pupille. En colère, elle avoue son projet d’évasion et accepte
d’épouser son tuteur. Figaro et le Comte font alors leur entrée, sous
l’orage, et un trio burlesque les réunit Zitti, zitti, piano (humour musi-
cal dans le style de Haydn). Le notaire que Bartolo avait requis en ur-
gence déclare leur union et quand le tuteur survient avec la police,
c’est trop tard : toute précaution était inutile.
« Almaviva, ossia l’Inutile Precauzione » était le titre officiel de l’opéra
lors de sa création, car il existait déjà un opéra italien d’un autre au-
teur intitulé «Le barbier de Séville ». Inutile précaution : les admira-
teurs de l’œuvre antérieure vinrent siffler la première représentation.
Mais dès la suivante et partout depuis, le succès est unanime.
Gioacchino Rossini (1792-1868) est
né à Pesaro un 29 février et mort à
Paris un vendredi 13…
Il a composé trente quatre opéras,
parmi lesquels Tancrède, l’Italienne à
Alger, Cendrillon, la Pie voleuse, Moï-
se en Egypte, Guillaume Tell…
Le fait marquant de sa biographie
tient en ce que, ayant connu tôt la
gloire et ayant accédé jeune à des
postes de responsabilité, d’abord en
Italie, puis à Paris à partir de 1824 (il
devient directeur du Théâtre Italien,
puis Premier Compositeur du Roi
Charles X), il choisit en 1836 de ces-
ser de composer ! Jusqu’en 1855 il
retourne vivre à Bologne, puis à Florence. Pendant ces années, il ne
compose que (si l’on ose dire) le splendide Stabat Mater...qui sera
chanté à Paris lors de ses grandioses funérailles. Pendant les douze
dernières années, installé rue de la Chaussée d’Antin et à Passy, il
donnait des dîners somptueux. Rossini était apprécié du Tout-Paris
pour ses traits d’esprit, et visité par tous les musiciens, chanteurs et
compositeurs venant rendre hommage à sa musique, jamais en-
nuyeuse, modèle d’invention et d’équilibre entre les composantes
rythmique et mélodique, au service de la bonne humeur générale.
« La musique de Rossini donne de l’espérance aux cœurs les plus
endormis » (Balzac)
1
/
1
100%