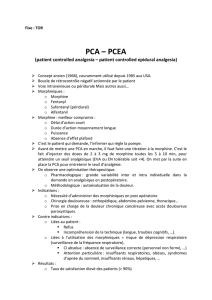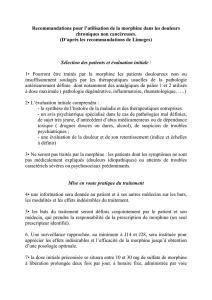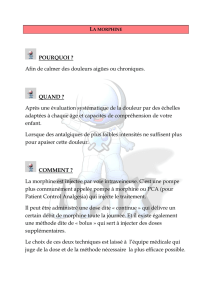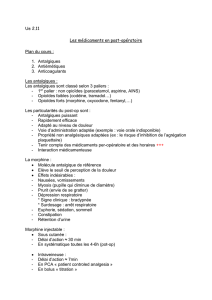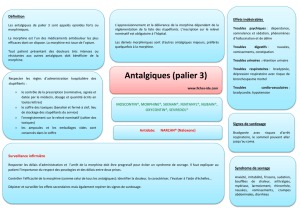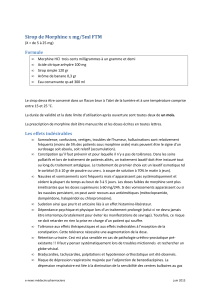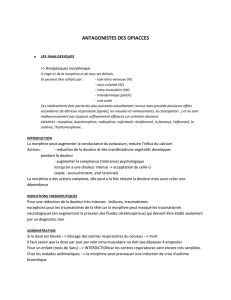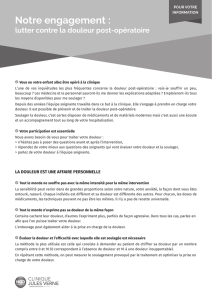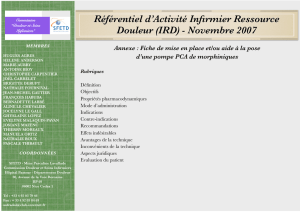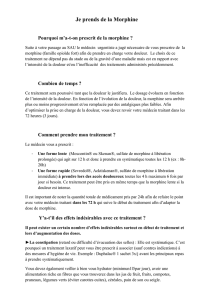Quelles indications pour l`analgésie par voie orale

16 • L’essentiel de l’anesthésie-réanimation #07 • Septembre 2016 L’essentiel de l’anesthésie-réanimation #07 • Septembre 2016 • 17
Monitoring
Quelles indications
pour l’analgésie par voie orale ?
Le 3 juin 2016, à l’occasion du congrès MAPAR, le Dr Valeria
Martinez du service d’anesthésie de L’hôpital Raymond Poincaré
à Garches, animait la conférence «Analgésie par voie orale post-
opératoire, incluant les morphiniques », au sein du Centre des
Congrès de la Villette.
L
a morphine est une référence
antalgique en post-opératoire.
Son administration par voie
intraveineuse, autocontrôlée
par le patient, est la méthode de
référence la plus adaptée pour une
analgésie optimale. Bien que sa
prescription ait explosé, la voie
d’administration la plus fréquente
reste la voie sous-cutanée, la mor-
phine orale n’étant prescrite que
dans 5,6 % des cas en France.
L’essor de la chirurgie ambulatoire
laisse présager de modifications de
pratiques pour la prise en charge
de patients qui auront subi des
chirurgies douloureuses. L’utilisation
d’analgésie puissante par voie orale
pourrait donc être indiquée.
Morphine à libération
immédiate ou prolongée ?
Pour des patients opérés de pro-
thèse de hanche, l’utilisation de la
morphine orale versus injectable a
montré que l’efficacité de l’analgésie
avec ces deux modes d’adminis-
tration était comparable pour la
morphine à libération immédiate.
D’autres études ont montré une effi-
cacité similaire de la morphine par
voie orale et par voie veineuse mais
suggèrent que la biodisponibilité de
la morphine par voie orale est plus
faible, avec une consommation cinq
fois plus importante pour une même
efficacité analgésique.
L’utilisation de la morphine à
libération prolongée par voie
orale montre, quant à elle, une
efficacité comparable à celle des
autres méthodes, mais avec une
incidence non négligeable de séda-
tion et un risque de surdosage.
« L’analyse d’études utilisant les
formes à libération immédiate et à
libération prolongée, montre une
efficacité similaire entre ces deux
formes d’administration. Mais les
effets secondaires graves de type
surdosage et détresse respiratoire
ont été plus fréquemment observés
«Avec l’essor de l’ambulatoire, l’utilisation d’analgésie
puissante par voie orale pourrait être indiquée pour
les patients ayant subi des chirurgies douloureuses. »
avec la forme à libération prolongée.
En post-opératoire, c’est donc la
forme à libération immédiate qui
est la plus sécuritaire », précise
Valeria Martinez.
Quels opioïdes utiliser,
autres que la morphine ?
L’oxycodone : indiquée pour les dou-
leurs chroniques, intenses, ou non
atténuées par des antalgiques plus
faibles. Son efficacité et sa tolérance
sont comparables à la morphine.
Sur le plan pharmacocinétique,
l’oxycodone par voie orale présente
une meilleure biodisponibilité. Son
utilisation pour traiter la douleur
aiguë en post-opératoire est une
possibilité.
Le tramadol : deuxième opioïde
utilisé en France en post-opératoire
après la morphine. Il peut être utilisé
pour l’analgésie des douleurs aiguës
et chroniques.
La codéine : cinquième morphinique
utilisé en post-opératoire en France,
sa valeur analgésique est sûre,
qu’elle soit administrée seule ou
en association avec du paracétamol.
Le sufentanil sublingual : disponible
depuis avril 2016, son efficacité est
comparable voire supérieure à la
pompe à morphine par voie intra-
veineuse. Il est facile d’utilisation et
est utilisé en auto-administration.
Son effet est très rapide et son
administration sublinguale via un
dispositif adapté apporte sécurité
et autonomie au patient.
Analgésie multimodale
Avec l’essor de l’ambulatoire, la
tendance serait à l’utilisation de
morphiniques par voie orale en
association avec des antalgiques non
morphiniques. Toutefois, l’utilisation
de la morphine va de pair avec
certains problèmes : « son admi-
nistration ne suit pas toujours les
prescriptions qui sont faites, ce qui
fait qu’elle est souvent sous dosée,
soit pour cause de doses plus basses
que celles prescrites, soit pour cause
d’intervalle d’administration trop
long », indique Valeria Martinez.
Aussi, sa biodisponibilité digestive
est très faible (30 %) et elle a des
effets secondaires gênants, qui
sont les nausées/vomissements
post-opératoires et la dépression
respiratoire. L’analgésie multimo-
dale est une stratégie qui permet
de réduire ces effets secondaires,
via l’association de différentes
molécules aux mécanismes d’ac-
tions distincts, dont le but sera
de renforcer l’analgésie, tout en
diminuant les effets secondaires de
la morphine. « L’objectif étant d’op-
timiser l’épargne morphinique et de
réduire les effets secondaires liés à la
morphine », détaille l’anesthésiste.
Quel analgésique non
morphinique associer à la
morphine ?
La combinaison AINS/opioïdes est
la plus efficace en cas de douleur
importante. Il s’agit de l’antalgique
non morphinique à utiliser priori-
tairement avec les opioïdes.
Le paracétamol a peu d’utilité en
cas de douleur sévère, mais son
association avec la codéine ou le
tramadol reste efficace en cas de
douleur modérée en post-opératoire.
L’association tramadol/morphine se
révèle sans bénéfice selon une étude.
Finalement, l’essor de la chirurgie
ambulatoire laissant présager une
utilisation de plus en plus fréquente
des opioïdes oraux, la morphine
orale à libération immédiate doit
être privilégiée. L’oxycodone qui
présente une biodisponibilité plus
élevée peut être une alternative
thérapeutique. Le sufantanil sublin-
gual permet une analgésie opioïde
compatible avec une mobilisation
rapide en hospitalisation et le tra-
madol est recommandé seul ou en
association avec des antalgiques
non morphiniques en cas de douleur
modérée. ■
Yasmine Ziat
YZ
YZ
L’analgésie multimodale est une stratégie qui permet de réduire les effets secondaires de la morphine,
via l’association de différentes molécules aux mécanismes d’actions distincts.
L’analyse d’études utilisant de la morphine à libération immédiate et
à libération prolongée, montre une efficacité similaire entre ces deux
formes d’administration. Mais les effets secondaires graves sont plus
fréquents avec la forme à libération prolongée.
1
/
1
100%