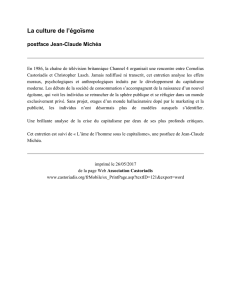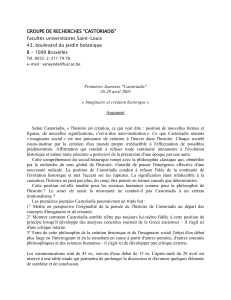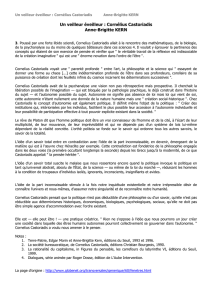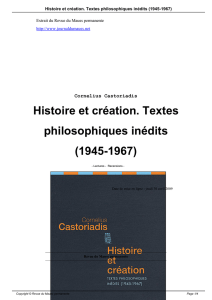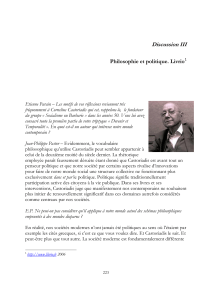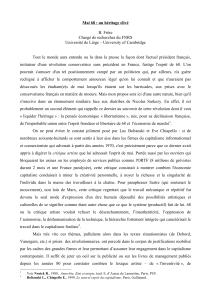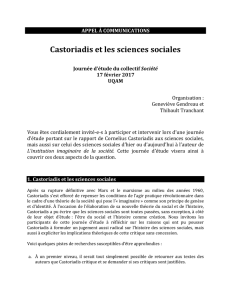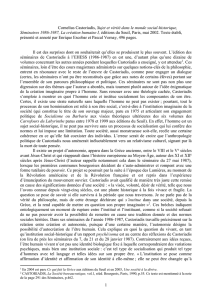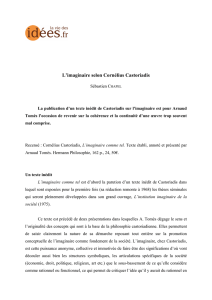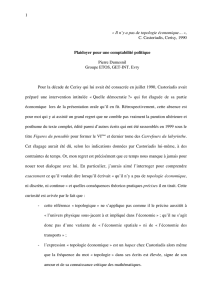II n`y a pas d`acte sexuel unissant deux jouis¬sances en - E

UNIVERSITE PARIS 8 – VINCENNES-SAINT-DENIS
U.F.R. de philosophie
N° attribué par la bibliothèque
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
de Paris VIII
THÈSE
pour obtenir le grade de
DOCTEUR DE L'UNIVERSITE PARIS 8
Discipline : philosophie
présentée et soutenue publiquement
par
Philippe Caumières
le 16 Février 2007
Titre :
Le projet d’autonomie selon
Cornelius Castoriadis
Directeur de thèse :
M. Alain Brossat
Jury :
M. Alain Brossat
M. Vincent Descombes
M. Eugène Enriquez
M. Laurent Van Eynde
M. Jean-Marie Vaysse

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Ce qui frappe immédiatement à la lecture de l’œuvre de Castoriadis, c’est le style qui s’y
manifeste, fait de « juxtaposition de notations fiévreuses, de raccourcis abrupts qui font parfois
sursauter le lecteur, de pistes à peine ébauchées — et de développement d’une rigueur
analytique et d’une densité inouïe parsemés çà et là de formules fulgurantes », comme le
soulignent Enrique Escobar et Pascal Vernay1. Très vite toutefois, le lecteur prend conscience
que ce style déroutant ne peut qu’être l’expression d’un penseur d’une rare exigence qui
rappelle irrésistiblement une note du jeune Hegel : « Tu ne seras pas mieux que ton temps, mais
ton temps tu le seras au mieux »2. C’est là une maxime que Castoriadis ne mentionne jamais,
pourtant tout se passe comme s’il n’avait cessé de s’y conformer.
Qu’il ait eu pleinement conscience d’être fils de son temps, l’atteste le fait qu’il n’a jamais
cessé d’insister sur la finitude de la pensée, de rappeler qu’elle est toujours située. C’est bien
cette reconnaissance qui spécifie la pensée du XXe siècle : se savoir historique et faire ainsi le
deuil du Savoir Absolu. « Penser n’est pas sortir de la caverne, assure Castoriadis, ni remplacer
l’incertitude des ombres par les contours tranchés des choses mêmes, la lueur vacillante d’une
flamme par la lumière du vrai Soleil. C’est entrer dans le labyrinthe, plus exactement faire être
et apparaître un Labyrinthe alors qu’on aurait pu rester “étendu parmi les fleurs, faisant face au
ciel” »3. Se voulant clairement comme une reprise inversée de l’allégorie platonicienne
présentant la philosophie comme la voie permettant d’accéder à une contemplation salvatrice4,
ce passage rend bien compte du sens du titre donné à la série de publications : Les carrefours du
labyrinthe5 ; textes qui représentent, avec L’institution imaginaire de la société, l’essentiel de
ses productions depuis l’arrêt de la parution de la revue militante où il a commencé à faire part
de ses idées.
« Rendre la lumière suppose d’ombre une morne moitié », disait Valéry6. Mais ici, il n’est
1. Postface au premier volume de l’édition des séminaires qu’il a donnés à l’École des hautes études en sciences sociales à partir du début des années
80 (SV, 475). Voir les références en bibliographie. Rappelons que c’est en 1979 que Castoriadis a été élu à l’EHESS.
2. Hegel, Notes et fragments, traduction et commentaire sous la direction de P.J. Labarrière, Paris, Aubier, 1991, p. 194, note 275.
3. CL 1, 7-8. La citation est de Rilke : « immer wieder gehn wir zu zweien hinaus unter die alten Bäume, lagern uns immer wieder zwischen die
Blumen, gegenüber dem Himmel ».
4. Platon, République, livre VII. « La Caverne est le tableau le plus optimiste jamais tracé par Platon du pouvoir libérateur et éclairant de la
philosophie. La pensée abstraite, qui conduit au discernement philosophique, y est hardiment dépeinte comme libératrice. L’homme qui se met à penser
y apparaît comme rompant avec les liens de la conformité à l’expérience ordinaire et aux opinions reçues ; la progression vers l’état éclairé y est décrite
comme un voyage de l’obscurité vers la lumière. À la différence de la majorité passive, ceux qui se mettent à faire usage de leur esprit font quelque
chose pour eux-mêmes. Après avoir été initialement (et mystérieusement) délivré de ses liens, celui qui remonte péniblement de la Caverne vers la
surface doit fournir un effort personnel maximal. Rares sont les penseurs qui aient tracé, que ce soit dans la philosophie ou dans la littérature, un tableau
plus saisissant ou plus émouvant de la pensée philosophique, comme délivrance de soi par rapport au conformisme indifférencié et comme lutte
enrichissante pour l’accès à la vérité » (J. Annas, Introduction à la République de Platon, trad. B. Han, Paris, PUF, 1994, p. 139).
5. Six volumes sont parus regroupant différents textes. Voir la bibliographie.
6. Le cimetière marin, in Charmes, Œuvres, Paris, Gallimard, La pléiade, tome 1, 1980, p. 148.
- 3 -

même plus question d’aller vers la lumière ; Castoriadis assure en effet que dès que nous posons
la question du sens, « la contrée change » : « la lumière de la plaine a disparu, les montagnes qui
la délimitaient ne sont plus là, le rire innombrable de la mer grecque est désormais inaudible »7.
Dès que nous commençons à penser, « rien n’est simplement juxtaposé, le plus proche est le
plus lointain, les bifurcations ne sont pas successives, elles sont simultanées et
s’interpénètrent » ; et une fois dans le labyrinthe, « de tous côtés, les galeries obscures filent,
elles s’enchevêtrent avec d’autres venant d’on ne sait d’où, n’allant peut-être nulle part ».
Castoriadis sait bien qu’il vit une période post-métaphysique et n’attend nul Salut.
Mais, fils de son temps et conscient de l’être, Castoriadis a aussi toujours cherché à l’être au
mieux. Son parcours parle pour lui. Son engagement d’abord qui, loin de se limiter à la
résistance à l’occupation allemande de la Grèce et à la dictature de Metaxas, s’inscrit dans une
approche du monde fort sensible aux exigences de justice sociale exprimées par le marxisme.
Comment comprendre sinon cette longue période rythmée par les activités du groupe
Socialisme ou Barbarie et la publication de la revue éponyme8 ? Celle-ci terminée, il ne s’est
nullement tenu à l’écart de la vie sociale, prenant position à chaque fois qu’il le jugeait
nécessaire, le plus souvent par le biais d’articles9. Sa pensée ensuite. Jamais totalement coupé
d’une pratique concrète10, Castoriadis s’est toujours tenu informé des avancées de la
connaissance dans un grand nombre de domaines. Il a ainsi acquis un savoir quasi
encyclopédique, maîtrisant notamment l’économie, la psychanalyse, les mathématiques,
l’histoire (et pas seulement l’histoire ancienne), l’anthropologie, l’épistémologie, la linguistique,
devenant parfois l’interlocuteur des meilleurs chercheurs de leur discipline11.
Il ne faut voir là aucune volonté d’érudition en tant que telle, mais plutôt l’expression d’une
exigence de cohérence. Si penser c’est entrer dans le labyrinthe et « se perdre dans des galeries
qui n’existent que parce que nous les creusons inlassablement, tourner au fond d’un cul-de-sac
dont l’accès s’est refermé sous nos pas », il ne faut pas désespérer « que cette rotation ouvre
inexplicablement des fissures praticables dans la paroi »12. Le travail de la pensée n’est donc pas
vain, même si, n’étant sous-tendu par nulle nécessité, sa réussite reste inexplicable. Mais c’est
un fait : l’homme a partiellement prise sur l’être. Se savoir d’un temps post-métaphysique
conduit certes à mettre en cause « l’être comme continuité » pour reprendre une expression de
7. CL 1, 7. Castoriadis reprend ici un vers d’Eschyle : « Ô divin Éther, vents à l’aile rapide, sources des fleuves, sourire innombrable des flots
marins… » (Prométhée enchaîné, v. 80-90, trad. É. Chambry, Paris, Flammarion, GF, 1984, p. 104).
8. Voir : P. Gottraux, « Socialisme ou Barbarie ». Un engagement politique et intellectuel dans la France de l’après-guerre, Lausane, Payot
Lausane, 1997.
9. Il suffit de se reporter à la table des matières de ses divers ouvrages. Voir la bibliographie.
10. Outre son militantisme politique, Castoriadis fut employé à l’OCDE. Il fût par ailleurs psychanalyste jusqu’à la fin de sa vie.
11. Qu’on pense, par exemple, à Pierre Vidal-Naquet pour l’histoire de la Grèce, Alain Connes pour les mathématiques, ou Francisco Varela pour la
connaissance du vivant.
12. CL 1, 8.
- 4 -

Maurice Blanchot, mais ne signifie pas qu’il faille renoncer à toute ontologie comme celui-ci
semblait le croire13. Il est vrai que la question de l’être invite à une reprise à chaque fois
nouvelle : « les formes, les types, les figures/ schèmes/ significations sont autres ; de même que
sont autres les “problèmes”, ce qui fait et ne fait pas problème »14, note Castoriadis, explicitant
par là son usage de l’image d’un labyrinthe aux voies multiples et désordonnées que fait surgir
la pensée en acte15.
Il ne peut toutefois s’agir de n’importe quelle pensée, mais seulement d’une « grande
pensée » à même « d’ébranler l’institution perceptive dans laquelle tout lieu a son lieu et tout
moment a son heure », ainsi que « l’institution donnée du monde et de la société, les
significations imaginaires sociales que cette institution porte »16. C’est un des objectifs de ce
travail que de tâcher d’éclairer le sens d’un tel propos. Il importe seulement ici de souligner
l’ambition qui le sous-tend. Pour Castoriadis, être son temps au mieux, comme dit Hegel, c’est
ouvrir un nouvel horizon, plus exactement créer ce dernier : « ce n’est jamais qu’en pensant/
posant/ créant un type d’étant que les philosophes ont, chaque fois pensé quelque chose de
l’être »17. Cette création, déplore-t-il, n’a pourtant jamais été reconnue comme telle18. « Par quoi
et en quoi un philosophe est-il grand ? » : Kant a donné la réponse, « mais, par les nécessités de
sa philosophie, il la restreignait à l’œuvre d’art, et en excluait explicitement la pensée », assure
Castoriadis, qui cite le paragraphe 46 de la Critique de la faculté de juger : « le génie (…)
consiste à produire ce dont on ne saurait donner aucune règle déterminée (…), l’originalité doit
être sa première propriété (…), ses produits doivent en même temps être des modèles, c’est-à-
dire exemplaires (…) ils doivent servir aux autres de mesure ou de règle de jugement (…) il ne
peut décrire lui-même ou exposer scientifiquement comment il réalise son produit (…) c’est en
tant que nature qu’il donne la règle ». Castoriadis note alors que « Kant parle de production,
pour ne pas parler de création ; de nature pour désigner une émergence radicale »19. Ces termes,
13. « Par l’homme, c’est-à-dire non par lui, mais le savoir qu’il porte et d’abord par l’exigence de la parole toujours déjà préalablement écrite, il se
pourrait que s’annonce un rapport tout autre qui mette en cause l’être comme continuité, unité ou rassemblement de l’être, soit un rapport qui
s’excepterait de la problématique de l’être et poserait une question qui ne soit pas question de l’être. Ainsi, nous interrogeant là-dessus, sortirions-nous
de la dialectique, mais aussi de l’ontologie » (M. Blanchot, L’entretien infini, Paris, Gallimard, 1969, p. 11).
14. CL 1, 19.
15. L’analogie avec l’image des Holzwege, les chemins forestiers « n’allant nulle part », dont use Heidegger semble s’imposer. Castoriadis la refuse
pourtant ; rappelant les avancées scientifiques du début du XX° siècle, il assure : « Mais le philosophe — ce philosophe — a déjà rationalisé sa surdité.
Tout cela c’est de l’ontique. Cela concerne les étants — et lui, il ne pense que l’Être. Et quand donc a-t-on vu la philosophie pouvoir parler de l’Être
absolument à part des étants ? » (CL 1, 14).
16. CL 1, 21.
17. CL 1, 22.
18. Un grand philosophe crée « des figures autres du pensable », mais « humilité ou arrogance extrême, les deux à la fois : il ne se pense jamais ainsi,
il croit que ces figures, il les a découvertes » (CL 1, 17).
19. Critique de la faculté de juger, citée par Castoriadis (CL 1, 16) d’après la traduction d’A. Philonenko (Paris, Vrin, 1986, p. 138). « Man sieht
hieraus, daß Genie 1) ein Talent sei, dasjenige, wozu sich keine bestimmte Regel geben läßt, hervorzubringen : nicht Geschicklichkeitsanlage zu dem,
- 5 -
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
 215
215
 216
216
 217
217
 218
218
 219
219
 220
220
 221
221
 222
222
 223
223
 224
224
 225
225
 226
226
 227
227
 228
228
 229
229
 230
230
 231
231
 232
232
 233
233
 234
234
 235
235
 236
236
 237
237
 238
238
 239
239
 240
240
 241
241
 242
242
 243
243
 244
244
 245
245
 246
246
 247
247
 248
248
 249
249
 250
250
 251
251
 252
252
 253
253
 254
254
 255
255
 256
256
 257
257
 258
258
 259
259
 260
260
 261
261
 262
262
 263
263
 264
264
 265
265
 266
266
 267
267
 268
268
 269
269
 270
270
 271
271
 272
272
 273
273
 274
274
 275
275
 276
276
 277
277
 278
278
 279
279
 280
280
 281
281
 282
282
 283
283
 284
284
 285
285
 286
286
 287
287
 288
288
 289
289
 290
290
 291
291
 292
292
 293
293
 294
294
 295
295
 296
296
 297
297
 298
298
 299
299
 300
300
 301
301
 302
302
 303
303
 304
304
 305
305
 306
306
 307
307
 308
308
 309
309
 310
310
 311
311
 312
312
 313
313
 314
314
 315
315
 316
316
 317
317
 318
318
 319
319
 320
320
 321
321
 322
322
 323
323
 324
324
 325
325
 326
326
 327
327
 328
328
 329
329
 330
330
 331
331
 332
332
 333
333
 334
334
 335
335
 336
336
 337
337
 338
338
 339
339
 340
340
 341
341
 342
342
 343
343
 344
344
 345
345
 346
346
 347
347
 348
348
 349
349
 350
350
 351
351
 352
352
 353
353
 354
354
 355
355
 356
356
 357
357
 358
358
 359
359
 360
360
 361
361
 362
362
 363
363
 364
364
 365
365
 366
366
 367
367
 368
368
 369
369
 370
370
 371
371
 372
372
 373
373
 374
374
 375
375
 376
376
 377
377
 378
378
 379
379
 380
380
 381
381
1
/
381
100%