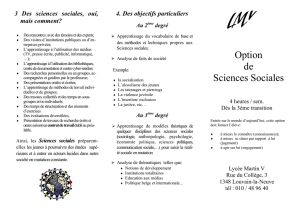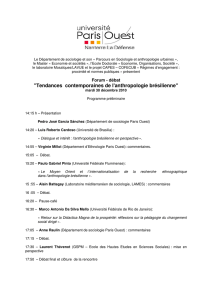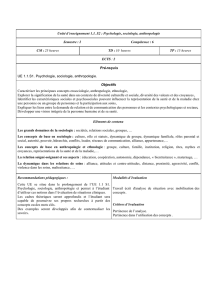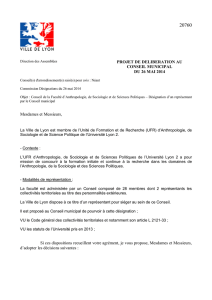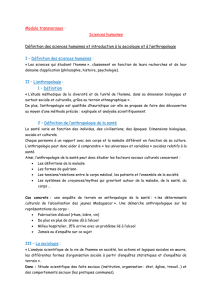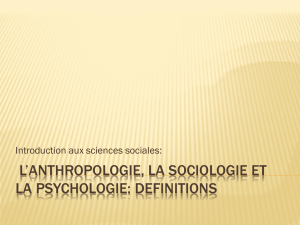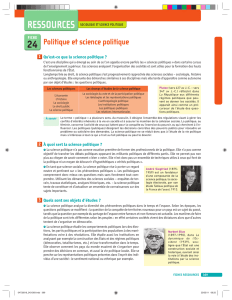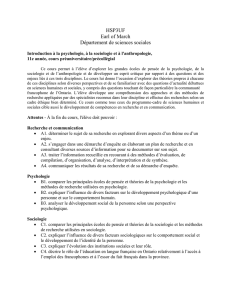Résumé S`il y a un rapport interdisciplinaire qui s - pug

Annales de l’Université Omar Bongo, n° 11, 2005, pp. 23-49
DU SYSTEME DE FILIATION ENTRE
L’ANTHROPOLOGIE ET LA SOCIOLOGIE
Bernardin MINKO MVE
Université Omar Bongo,
Libreville (Gabon)
Résumé
S’il y a un rapport interdisciplinaire qui s’apparente à un véritable
système de filiation, c’est bien celui de l’anthropologie et de la sociologie. On
peut le situer dès la constitution des deux disciplines. Autant la sociologie est
née au XIXème siècle à l’issue d’un besoin de réorganisation sociale
conséquence des révolutions politiques et industrielles ; autant l’anthropologie
s’est vue reconnaître ses lettres de noblesse par l’intérêt romantique qu’elle
porte pour l’exotisme avec le souhait de créer une discipline à orientation
philosophique et avec le projet colonial dans la fondation de l’ethnologie.
En s’affirmant relativement différentes par leur champ et leur
méthode, l’anthropologie et la sociologie cheminent largement de pair dans la
voie des grandes fresques historiques et de la patiente accumulation de
documents. On voudrait attirer l’attention sur certains aspects de la situation
de l’obsolescence de la frontière entre l’anthropologie et la sociologie car, elle
nous semble souvent méconnue et parfois déformée par certaines recherches
actuelles. Et pourtant, c’est ce que nous tentons de démontrer, les deux
disciplines sont liées aux mêmes théories ; elles trouvent souvent des
perspectives communes (organisation, institution, intégration, adaptation) et
se construisent parfois des démarches assez semblables.
Mots clés
Anthropologie, sociologie, interdisciplinarité, socio-anthropologie,
socio-ethnologie.
Abstract
If there is a report interdisciplinarity which is connected with a true system of
filiation, it is well that anthropology and sociology. One can locate it as of the
constitution of the two disciplines. As much sociology was born at the XIXème century
with exit need for social reorganization consequence of the political and industrial

Du système de filiation entre l’anthropologie et la sociologie
24
revolutions; as much anthropology is recognizing its letters of nobility by romantic
interest it carries for exoticism with the wish to create a discipline with philosophical
orientation and with the colonial project in the foundation of ethnology.
In affirming relatively different by their field and their method, anthropology
and sociology walk on largely together in the way of the large historical frescos and the
patient accumulation of documents. We would like to attract the attention on certain
aspects of the situation of obsolescence of the border between anthropology and sociology
because, it seems to us often ignored and sometimes deformed by certain current research.
And yet, it is what we try to show, the two disciplines are related to the same theories;
they often find prospects common (organization, institution, integration, adaptation)
and build sometimes rather similar steps.
Key words
Anthropology, sociology, interdisciplinarity, socio-anthropology, socio-
ethnology.
Introduction
L’avènement du troisième millénaire interroge les divisions
disciplinaires telles qu’elles s’étaient établies au cours des vingt dernières
années. Depuis que le terrain ethnologique s’est rebellé1, nous nous posons
régulièrement la question de la réinterpellation des scolastiques antérieures.
Face aux nouvelles situations rencontrées sur le terrain, trois problèmes se
posent désormais : l’intertextualité généralisée des cultures, l’interpellation
systématique des ethnologues par les populations sur lesquelles ils travaillent,
et l’inconfort moral du chercheur dans la relation à l’autre. Témoin des
changements sociaux, nous ne manquons pas d’observer des conditions
particulières dans lesquelles se développent aujourd’hui l’anthropologie et la
sociologie.
Sœurs quasi jumelles, anthropologie et sociologie mettent en lumière,
selon l’expression d’Alfred Krœber, une distinction des deux disciplines qui
n’a jamais été bien nette. Elle l’est moins que jamais aujourd’hui. Prétendre
tracer entre les deux disciplines une frontière, établir un bornage, y voir deux
1 Les communautés observées par les ethnologues ne peuvent plus être seulement considérées
comme des objets d’étude. Intéressées par des motivations identitaires, leurs stratégies
demandent l’établissement d’un nouveau type de rapports.

Du système de filiation entre l’anthropologie et la sociologie
25
projets scientifiques différents, deux activités séparées d’étude du monde
social, serait tout à fait vain – et même, désormais, fallacieux. À leur
différenciation – toute relative, et qui n’a jamais empêché une large
communication – il n’y a, à la vérité, aucun fondement épistémologique
sérieux. C’est leur histoire seulement – et celle, générale, des deux derniers
siècles – qui permet d’en rendre compte.
L’obsolescence d’une frontière entre l’anthropologie et la sociologie,
tient d’une réflexion axée tant sur la crise sociétale que sur les potentialités de
l’interdisciplinarité. L’émergence et la justification de l’analyse s’expliquent
d’abord par les transformations qui affectent les sociétés contemporaines. La
dualisation du corps social, la brisure des solidarités organiques et la montée
non seulement du chômage mais également de l’exclusion qui concourent au
scepticisme ambiant. Le frottement entre anthropologie et sociologie ne
s’inscrit pas inopinément dans cette fin du XXe siècle. Les traits
caractéristiques de cet espace temporel concourent à son apparition. C’est une
émergence qui était peu probable et n’avait effectivement pas eu lieu
précédemment ou ne s’en était tenue qu’à des bribes de propositions. Dans la
présente réflexion nous voulons reconstituer les traces de cette dynamique
interdisciplinaire dont l’importance s’inscrit largement dans des contextes
épistémologiques et sociaux.
Après avoir présenté la constitution des deux disciplines, nous
montrerons leur rapprochement par l’objet qui rend caduque la division
actuelle. Cela permet de comprendre enfin comment les faits sociaux
contemporains peuvent bénéficier d'une approche à résonance socio-
anthropologique ou socio-ethnologique.
I. La constitution de la sociologie et de l’anthropologie
I.1. La sociologie
La sociologie s’est constituée au XIXe siècle comme science générale
des sociétés, du social en général, mais en se situant dans la perspective,
principalement, des sociétés modernes – ces sociétés occidentales en voie
d’industrialisation et d’urbanisation, en même temps que de laïcisation et de
rationalisation, de démocratisation et de nationalisation, de bureaucratisation
et de « scientification »..., de tous ces processus, générateurs de changements
permanents, constitutifs de ce qu’il est convenu d’appeler la modernité. Des

Du système de filiation entre l’anthropologie et la sociologie
26
sociétés qui ont été perçues, dans la rupture introduite dans la chaîne des
temps par la Révolution française et par la révolution industrielle, comme des
formes nouvelles (et encore très indécises) de l’organisation économique,
sociale, politique, des modalités inédites du lien social, et par là de la vie
humaine en général – ces formes nouvelles étant appelées à se généraliser à
l’humanité entière, de telle sorte que les nations modernes, les sociétés
civilisées d’Occident, placées à l’avant-garde de l’histoire, montraient à toutes
les autres, exotiques, archaïques, traditionnelles, en arrière sur le chemin de
l’évolution, en retard dans la voie du progrès, l’image (à plus ou moins long
terme) de leur avenir obligé. Dans cette perspective, le recours aux autres
sociétés, extérieures et perçues comme antécédentes (et en tant que telles
inéluctablement périmées), et notamment, dans la tradition française, aux
sociétés "primitives" et par là aux formes considérées comme les plus simples,
élémentaires, des phénomènes sociaux, ne fut généralement pour les
sociologues que le moyen d’expliquer les sociétés modernes. Ce sont celles-ci,
dit explicitement Durkheim (pourtant avec Mauss l’un des plus ethnologues
de tous les sociologues), c’est la réalité actuelle qui nous intéresse surtout de
connaître. L’évolution ultérieure de la discipline n’a fait que confirmer cette
tendance lourde de la sociologie à se préoccuper avant tout de la modernité –
et, ce faisant, des sociologues (qui demeurent dans leur grande majorité des
Occidentaux) à s’intéresser au premier chef à leur propre société, à leur
propre univers social, culturel, historique, et à référer à lui tous les autres.
I.2. L’anthropologie
L’anthropologie – selon le terme qui en définitive s’est imposé – ou
ethnologie – comme on a dit longtemps, surtout dans la tradition française –
a, chez beaucoup, manifesté de non moins vastes ambitions à être la science
générale de la société, voire la science globale de l’homme, mais sa perspective
a été, au départ, dès ses origines, peut-on dire, différente, et même, d’une
certaine manière, à l’opposé : ce fut, accompagnant depuis la Renaissance la
découverte par les Européens de leurs mondes extérieurs (plus ou moins vite
suivie de leur colonisation), la perspective de la diversité – perçue dans
l’expérience (répulsion et fascination mêlées) de l’étrangeté, de l’altérité, de la
différence – des sociétés et des cultures humaines. Et parmi celles-ci son
intérêt s’est fixé de manière privilégiée sur les plus exotiques (occidentalement
parlant), les plus lointaines géographiquement, historiquement et

Du système de filiation entre l’anthropologie et la sociologie
27
culturellement, les plus "dépaysantes", et elle s’est en fait constituée comme la
science des sociétés restées les plus traditionnelles et plus précisément, sous le
signe de l’évolution où s’affirme sa spécificité et son autonomie dans les années
1860-1880, comme la science sociale des sociétés primitives.
Sa dénomination, cependant, on vient de le voir, a été assez fluctuante
et elle n’est pas, du reste, encore aujourd’hui parfaitement établie. Trois
termes ont été en usage, qui ont connu de nombreux avatars .
Très ancien, le mot anthropologie eut d’abord un sens théologique :
« action de parler humainement des choses divines », selon le Vocabulaire de la
philosophie de Lalande. Il conserve un sens philosophique2, qui désigne la
connaissance globale de l’homme – distinguant l’anthropologie théorique qui
est « la connaissance de l’homme en général et de ses facultés ». L’anthropologie
pragmatique est « la connaissance de l’homme tournée vers ce qui peut assurer et
accroître l’habileté humaine » et l’anthropologie morale est la connaissance de
l’homme tournée vers ce qui doit produire la sagesse dans la vie,
conformément aux principes de la métaphysique des mœurs.
Mais le terme d’anthropologie a pris surtout, dès la fin du XVIIIème
siècle, un sens naturaliste, comme équivalent de l’histoire naturelle de
l’homme que Linné et Buffon avaient rendu possible, en réintroduisant,
contre la théologie régnante et les préjugés métaphysiques traditionnels, et
même si c’était à la première place, l’espèce humaine parmi les autres dans le
règne animal. Ce sens qui lui est donné pour la première fois, semble-t-il, par
Blumenbach en 1795, s’est imposé au XIXème siècle, l’anthropologie étant
alors considérée comme l’une des branches des sciences naturelles, celle qui
constitue pour ainsi dire la zoologie de l’espèce humaine. De fait, comme la
zoologie étudie les animaux du point de vue de leur morphologie et de leur
mode de vie, l’anthropologie porte tout en même temps sur les traits
physiques et la biologie, et sur les mœurs et les coutumes des êtres humains.
Elle a été définie par Broca comme « l’étude du groupe humain, envisagé dans son
ensemble, dans ses détails et dans ses rapports avec le reste de la nature. L’Anthropologie3,
dit-il, est la biologie du genre humain. Étude globale, elle comprend l’anatomie et la
physiologie humaines, la préhistoire, l’archéologie, l’ethnographie et l’ethnologie, le
2 Emmanuel KANT, Anthropologie du point de vue pragmatique, Paris, 1798.
3 Elle a été particulièrement active en France avec la Société d’Anthropologie (fondée en
1859) de Paul Broca, Paul Topinard et Armand de Quatrefages.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
1
/
27
100%