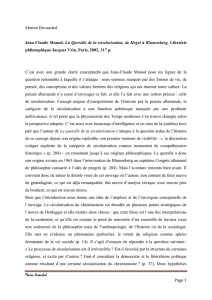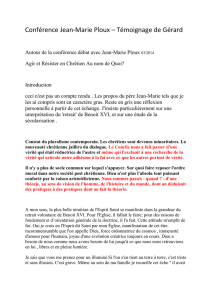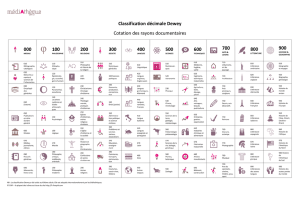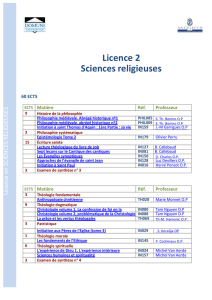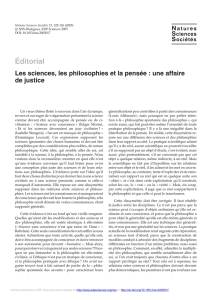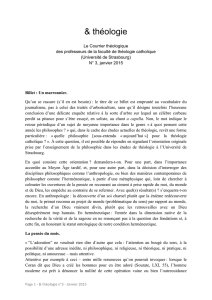trois objections a karl löwith. à propos d`histoire et salut 1

TROIS OBJECTIONS A KARL LÖWITH.
À PROPOS D’HISTOIRE ET SALUT!1
C’est avec un retard en lui-même énigmatique que la «!querelle de la sécularisation!»!2 aura
franchi le Rhin. La place manque ici pour qu’il soit possible de s’arrêter à ce fait en lui-même
certainement significatif de ce que la Geschichtsphilosophie n’a jamais cessé d’être présente
en Allemagne, tandis qu’en France, depuis le refoulement du positivisme comtien, on lui
préféra de tout autres discours. En revanche, on n’échappera pas à la nécessité de bien
distinguer les trois prismes à partir desquels peut s’opérer aujourd’hui la rencontre avec le
célèbre ouvrage de Löwith. Ce peut être par intérêt pour la philosophie allemande du siècle
dernier!3. Ce peut être parce que l’on s’interroge sur la «!sécularisation!» elle-même, c’est-à-
dire parce que l’on tente de mesurer la réalité de la puissance formatrice du christianisme sur
notre monde contemporain!4. Ce peut être enfin dans la mesure où l’on entend étudier
l’histoire des philosophies de l’histoire: tel est ici le cas. Or, dans cette perspective, l’analyse
de Löwith apparaît comme un obstacle qu’il importe d’autant plus de lever qu’elle est à
l’origine d’innombrables et fastidieux topoï en référence auxquels on se croit autorisé à
disqualifier les «!philosophies de l’histoire!» ou l’«!historicisme!» sous prétexte qu’il n’y
aurait là que «!laïcisation!»!: n’est-il pas bien entendu, par exemple, que l’inusable « ruse de la
raison» ne fait que transcrire en termes mondains la providence divine!? Là contre, il convient
de formuler trois griefs tout à fait décisifs: l’argumentation de Löwith est axiologiquement
indécise, heuristiquement insuffisante et performativement contradictoire.
1.!Rappelons que cet ouvrage fut publié par l’Université de Chicago en 1949 sous le titre Meaning and History et traduit
en allemand par H.!Kesting sous le titre Weltgeschichte und Heilsgeschehen, Stuttgart, Kohlhammer, 1953!; je traduis ici en
renvoyant à la réédition chez le même éditeur, en 1979, de cette version corrigée par l’auteur. Par commodité, j’indique en
même temps la pagination dans la traduction française, parue sous le titre Histoire et Salut, que nous devons à J.-F.
Kervégan, M.-C. Challiol-Gillet et S.!Hurstel, Paris, Gallimard, 2002. L’argumentaire qui suit reprend, sous une forme
considérablement modifiée, celui figurant dans «!L’anti-historicisme et ses mythes!», in La Pensée Politique, n°!1, 1993,
p.!182-186.
2.!Ainsi que s’intitule l’utile thèse de J.-C. Monod parue chez Vrin en 2002.
3.!Voir J.!A. Barash, «!K. Löwith et la politique de la sécularisation!» in Critique, n°!607, décembre 1997. Et aussi, du
même, «!Mythologies du politique au XXe siècle dans la perspective de H.!Heller, E.!Cassirer et K. Löwith!», in Bulletin du
Centre de Recherches Français de Jérusalem, n°!6, printemps 2000.
4.!Voir P.!Manent, «!Quelques remarques sur la notion de sécularisation!», in F.!Furet et M.!Ozouf (éd.), The
Transformation of Political Culture, 1789-1848, 3, Pergamon Press, 1989, p.!351!: «!Plus l’homme est athée, plus l’historien
est croyant, plus il croit du moins au pouvoir formateur de la religion. [...] La “sécularisation du christianisme”!: telle est
l’éponge de toutes les difficultés, telle est la ressource toujours prête de l’historien occupé à reconstituer la généalogie du
monde moderne!».

I) UNE AXIOLOGIE FLOTTANTE
Si on lit de près le résumé qui est donné de l’ouvrage au début de la conclusion (p.!175-
176/237-238), on constate que le processus décrit est finalement plus ambigu qu’il n’y paraît
de prime abord et il n’est peut-être pas inutile de le reprendre rapidement. Son point de départ
se trouve dans le dualisme judaïque qui oppose le peuple élu aux païens et dont l’écart avec la
sagesse grecque est béant: tandis qu’Hérodote rapporte des faits à seule fin qu’ils demeurent
dans la mémoire des hommes, le second Isaïe, au même moment, est tout entier tourné vers
l’avenir!1. En reconduisant cette scission entre le mondain et le supra-mondain, le
christianisme, d’une part, ôte à l’histoire terrestre comme telle toute signification intrinsèque
et, d’autre part, universalise le salut. C’est pourquoi s’il peut y avoir une théologie juive de
l’histoire, en toute rigueur, il ne peut y en avoir de chrétienne (p.!179/242)!: pour le chrétien,
entre la venue du Christ et le Jugement dernier, il s’agit seulement d’un intérim durant lequel
rien de crucial ne peut se produire. La «!sécularisation!» se définit alors par la réduction de ce
dualisme et l’immersion de ce salut universalisé dans l’histoire!: l’histoire profane –!que le
christianisme lui-même avait contribué à séculariser dans la mesure où il l’avait coupée du
sacré!– s’approprie et réfracte l’orientation eschatologique. Le premier, Joachim de Flore
(1131-1202), tend à «!mondaniser!» la Jérusalem céleste, geste de bien lourdes conséquences:
«!Le Troisième Testament des joachimites apparaît comme la “Troisième Internationale” ou
le “Troisième Reich”, annoncé par un Dux ou un Führer qui triomphe comme Rédempteur et
se voit salué par les “Heil” de millions de gens!» (p.!146-147/198). S’il faut « mettre à part
[ausnehmen]» Joachim dans ledit résumé, c’est parce qu’il anticipe ainsi l’opération
qu’effectuera en son temps la philosophie séculière de l’histoire. Pour en arriver là, c’est-à-
dire finalement à Staline et Hitler, il faudra, primo, annexer sans retour l’histoire sacrée à
l’histoire profane et, secundo, appuyer la réalisation, désormais terrestre, du salut sur le
formidable potentiel démiurgique libéré par la Révolution politique française et la Révolution
industrielle anglaise (p.!177/240).
En ce sens, le dualisme a fait « boule de neige». Alors, à qui la faute _ car c’est bien la
question qu’il faut poser, on y reviendra. Au prophétisme juif!? À l’eschatologie chrétienne!?
À Joachim qui devance le messianisme moderne!? À Vico qui se tient à la frontière de la
sécularisation (p.!128/173)!? A Voltaire, le premier philosophe de l’histoire proprement dit
(p.!11/21 et 99/136)!? À Hegel qui en est le dernier (p.!59/85). En réalité, à la totalité même
du processus!: de l’Ancien Testament à Mein Kampf se dessine une filiation paradoxale et
catastrophique dont chaque maillon est, à vrai dire, décisif.
Et, pourtant, on peut dire aussi: en radicalisant jusqu’au bout cette même « sécularisation»,
on doit en venir, comme Burckhardt, à réduire l’histoire à une pure continuité dépourvue de
1.!Voir p.!15/27. Dans une étude résolument «!anti-sécularisation!» de la théologie augustinienne de l’histoire, H.!Günther
dénonce le caractère simplificateur de cette opposition en même temps qu’il souligne l’héritage grec d’Augustin –!mais il faut
reconnaître que ses arguments ne sont pas d’une parfaite clarté!: voir Le Temps de l’histoire (1993), trad. O.!Mannoni, Paris,
Maison des Sciences de l’Homme, 1995, p.!35-36, 65-70 et 247-248.

sens. S’affranchissant ainsi du préjugé moderne du progrès, on se trouve conduit à un
scepticisme vis-à-vis de l’histoire des hommes bien proche de celui qui accompagnait
originellement la foi en la providence (p.!165/223 et 182/245-246) _ mais justement sans foi
en la providence... En ce sens, Burkhardt paraît bien se tenir «!aussi près que possible de la
nature de l’histoire!» (p.!32/50). Et tout se passe alors comme si la sécularisation avait deux
devenirs possibles diamétralement opposés, l’un dans lequel les masses se seraient trouvé
prises pour le pire, l’autre conduisant à un moindre mal, une sorte de résignation ésotérique où
Löwith lui-même serait tenté de se reconnaître.
Or, si l’on y regarde de plus près, cette hésitation participe de l’instabilité générale d’un
dispositif dont l’axiologie ne s’avère pas assez ferme pour que cela ne soit pas un embarras.
Mieux!: le jeu des valorisations impliqué par Histoire et Salut est structurellement aporétique.
Si, en effet, le désastre est imputable à la totalité du processus, comment ne serait-on pas
réactionnaire, c’est-à-dire tenté de revenir en deçà du processus lui-même!? Puisque, comme
le note Marquard, «!pour Löwith, la théologie de l’histoire était déjà mauvaise!»!1, il est
impossible de songer sans nostalgie à une perception de l’histoire incommensurable avec la
nôtre!: mais si la nostalgie est patente dès lors qu’il est question de la sagesse grecque, il n’est
pas pour autant question de faire retour à celle-ci comme Strauss s’y essaie vainement: sans
doute l’irréversibilité historiciste a-t-elle du vrai!2.
D’un autre côté, ledit processus étant négativement cumulatif, il en résulte inévitablement
que plus on remonte à son origine, plus on s’éloigne du désastre qui le consomme. Cela
signifie qu’en régressant au christianisme qui avait dépouillé l’histoire profane de tout sens
progressif, on rencontre une foi au fond analogue à la sagesse hellénistique et c’est alors à
toutes deux qu’il faut opposer les philosophies de l’histoire!: «!La surestimation moderne de
l’Histoire, du “monde” comme “Histoire”, résulte de notre éloignement par rapport à la
théologie naturelle des anciens et à la théologie surnaturelle du christianisme. Elle est
étrangère à la sagesse comme à la foi» (p.!177/239). C’est pourquoi on ne peut suivre le
chemin parcouru par Löwith sans avoir le sentiment de redécouvrir une lucidité perdue en
s’émancipant des illusions du progrès. De ce point de vue, dire, par exemple, de la position de
Vico qu’elle est «!encore théologique!» (p.!127/173), c’est la faire bénéficier d’une proximité
valorisante à l’origine.
Mais, le ver étant dans le fruit, on ne peut pas s’en tirer ainsi. De fait, dire de Comte qu’il
fut chrétien par là où il pensait ne plus l’être car son idée de progrès était «!encore
théologique!» (p.81/115), c’est, au contraire, l’accuser d’une naïveté typiquement moderne
dont il s’agit justement de se défaire. De ce point de vue, il s’agit bien de n’être plus pieux.
Löwith voit alors se retourner contre lui-même sa propre machinerie!: comment donc
satisfaire une telle exigence!? Si l’on se tourne vers Burckhardt, il faut bien reconnaître qu’il
1.!Des Difficultés avec la philosophie de l’histoire (1973), trad. O. Mannoni, Paris, Maison des Sciences de l’Homme,
2002, p.!6.
2.!Voir la lettre à Strauss du 8 janvier 1933, citée par J.!A. Barash, «!K. Löwith et la politique de la sécularisation!»,
p.!892.

croit encore à la continuité. Si l’on se tourne vers Nietzsche, il faut dire que son prétendu
paganisme est encore chrétien, précisément parce qu’antichrétien (p.!203/270). Si l’on se
tourne vers Heidegger, il faut dire que sa pensée demeure encore prisonnière de la tradition
qu’elle met en cause!1. Et où que l’on se tourne, il est clair qu’il faudra toujours se découvrir
encore ce que l’on ne peut que s’épuiser vainement à ne plus être. Derechef, puisqu’on ne
peut pas ne plus l’être, il est tentant de ne pas l’être encore, c’est-à-dire d’en revenir aux
Anciens. Mais alors on tourne en rond. En vérité, si l’on ne peut pas revenir en deçà de la
sécularisation, on ne peut pas non plus s’aventurer au-delà et il ne reste plus qu’à se rêver à
côté, en sortant de l’«!Europe!» et en se perdant dans l’altérité absolue de l’Orient.
II) UNE HEURISTIQUE INSUFFISANTE
La nature foncièrement téléologique de l’argumentaire d’Histoire et Salut contraint encore
à une méconnaissance de l’histoire réelle des «!philosophies de l’histoire!». Toute théologie
de l’histoire y est perçue comme une philosophie sécularisée potentielle de l’histoire et,
inversement, toute philosophie sécularisée de l’histoire y apparaît comme, encore, une
théologie de l’histoire!: pour Löwith, les chrétiens sont toujours déjà laïcs et les laï cs toujours
encore chrétiens. C’est pourquoi tout discours sur l’histoire se trouve irrémédiablement
équivoque ou ambigu (doppeldeutig, zweideutig), à commencer par celui de Vico dont la
science nouvelle, en se tenant sur l’arête difficile de la théologie et de la philosophie, se
trouve «!très profondément équivoque [zutiefst doppeldeutig]!»!2. C’est à partir de ce fragile
point d’équilibre que s’inverse le rapport entre l’avant et l’après: dorénavant, on n’aura plus
affaire à des philosophies de l’histoire en puissance, mais à des théologies de l’histoire
sécularisées. L’ambivalence des discours considérés n’est donc autre, en dernier ressort, que
celle de la finalité elle-même, de l’origine qui est en puissance le terme et du terme qui est
encore l’origine.
Or aligner de la sorte les philosophies de l’histoire dans le droit fil de leurs esquisses
théologiques n’est pas sans inconvénient. Cela contraint à éjecter, de facto, hors du champ
«!philosophies de l’histoire!», tout discours philosophique sur l’histoire réfractaire à ce
traitement finaliste. Et une telle démarche repose sur une pétition de principe!: si, en effet, à
titre de simple définition nominale, j’appelle «!philosophie de l’histoire!» tout discours
philosophique sur l’histoire susceptible d’être interprété comme sécularisation de la théologie
de l’histoire, je n’aurai guère de mal à démontrer, cette fois à titre de thèse, le même énoncé!!
Mais c’est précisément ce que fait Löwith, en déclarant d’entrée de jeu que, « dans la
recherche qui suit, l’expression “philosophie de l’histoire” désigne l’interprétation
systématique de l’histoire universelle par le fil conducteur d’un principe au moyen duquel les
événements historiques et leurs conséquences sont connectés et rapportés à un sens ultime!»
(p.!11/21). Ce faisant, non seulement on se donne ce qu’il s’agit d’établir, mais on se rendra
incompréhensible la singularité des philosophies de l’histoire considérées qui ne sont
1.!Voir la fin de l’appendice sur «!Le sens de l’histoire!» (1961) inclus dans la traduction française, p.!285.
2.!P.!128/173!; de même, l’idée de « progrès!» est dite zweideutig (p.63/90); de même, Hegel n’a pas été conscient de la
Zweideutigkeit de son entreprise (p.!60/86).

intelligibles que par comparaison avec toutes celles que l’on a tacitement éliminées comme
non significatives!: où trouver l’eschatologie sécularisée chez Montesquieu, ou chez
Ferguson, ou chez Schlözer!? Les décréter hors-jeu n’est pas très satisfaisant. Reste alors à
répliquer que, justement, l’absence manifeste de tout messianisme chez ces auteurs est par
elle-même significative!: leur silence est antichrétien et ce qui est antichrétien est encore
chrétien!1. Au fond, ils sont ce qu’ils prétendent ne pas être en ne le prétendant pas puisqu’ils
n’en disent rien! A ce jeu-là, naturellement, on gagne toujours.
On rétorquera peut-être qu’il est déloyal de reprocher à un historien de n’avoir pas parlé
de tout, ou de tous, et de lui opposer des seconds couteaux. Après tout, Löwith légitime
expressément dans son introduction le caractère téléologique de sa démarche et il justifie donc
indirectement la sélectivité qui en résulte. Mais cette justification tacite est en fait
inconsistante. Pour s’en convaincre, il n’est pas inutile de revenir un instant, et a contrario, à
la légitimation, elle, tout à fait explicite que Fichte donnait de sa méthode en 1806 dans Le
Caractère de l’époque actuelle!:
«![...] le philosophe n’utilise l’histoire, à la vérité, que dans la mesure où elle
sert ses fins, et ignore tout ce qui ne les sert pas; et je l’annonce ouvertement:
c’est ainsi que je me servirai d’elle dans les recherches qui vont suivre. Ce
procédé, parfaitement blâmable dans la simple histoire empirique, et qui détruirait
l’essence de cette science, ne l’est pas dans le cas du philosophe _ si et dans la
mesure où il a déjà au préalable démontré, indépendamment de l’histoire, la fin à
laquelle il soumet l’histoire!» (éd. citées, p.!141/151).
La clause finale est très claire!: la sélection inhérente à l’histoire téléologique (ou
philosophique), qui fait par hypothèse abstraction de tout ce qui ne concourt pas à la
réalisation du télos, est acceptable si et seulement si la nature de ce dernier a été établie
auparavant et sans en appeler à l’histoire elle-même –!sans quoi il y a pétition de principe. La
définition liminaire que donne Löwith de la «!philosophie de l’histoire!» devait donc être une
définition réelle, justifée en bonne et due forme sans aucun recours à la généalogie de la
sécularisation, pour pouvoir ensuite, en tant que fin de celle-ci, jouer la fonction discriminante
qui lui serait alors revenue à bon droit. Mais tel n’est pas le cas.
Dira-t-on ces considérations bien formelles, et plus fastidieuses encore? On arguera alors
de la légitimité pragmatique dont jouit ladite généalogie!: l’essentiel, c’est, en fin de compte,
la formidable lisibilité qu’acquièrent, ainsi mis en perspective, les grands auteurs passés en
revue –!et qui sont tout de même, soit dit en passant, les principaux philosophes ayant tenté de
penser l’histoire. La sécularisation trouve son bon droit dans ce fait, c’est-à-dire dans cette
fécondité exégétique qui est incontestable, et qui lui suffit.
Malheureusement, elle n’est pas incontestable. La même contrainte qui force à rejeter hors
du champ de l’enquête les «!philosophies de l’histoire!» non susceptibles d’être interprétées
comme théologies sécularisées autrement que par pure négation (chrétiennes parce que
1.!L’antichrétien est chrétien!: voir p.!63/90 et 203/270.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%