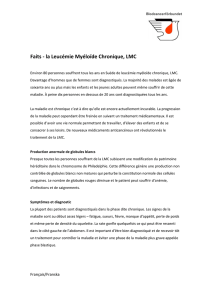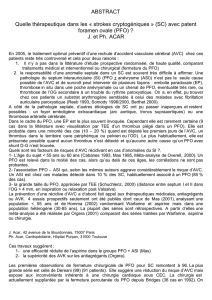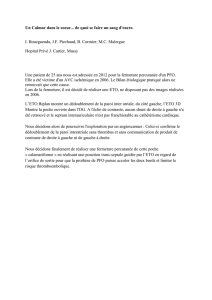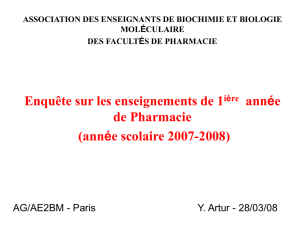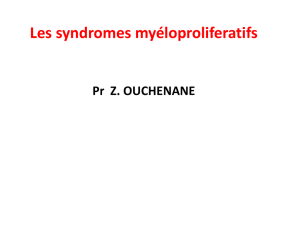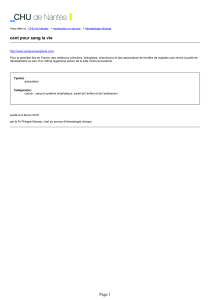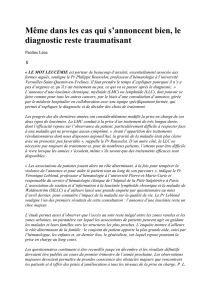Leucémie myéloïde chronique

Hématologie biologique (Pr Marc Zandecki) Faculté de Médecine – CHU 49000 Angers France
__________________________________________________________________________________________
MAJ : janvier 2007 Page 1 sur 10
Leucémie myéloïde chronique
Sommaire :
- Définition, étiologie et signes cliniques
- hémogramme
- myélogramme
- caryotype
- biologie moléculaire
- autres examens parfois réalisés
- diagnostic différentiel
- évolution : la phase blastique de la LMC :
- la phase accélérée
- la phase blastique (lymphoïde, myéloïde)
- Aspects thérapeutiques généraux
1. Définition, épidémiologie et aspects cliniques
Définition.
Il s’agit d’une prolifération maligne et systématisée de la lignée granulocytaire sans blocage
de maturation.
C’est un syndrome myéloprolifératif chronique prédominant sur la lignée granuleuse, lié à
un processus monoclonal affectant une cellule souche très primitive. Une anomalie
cytogénétique est constamment associée à la prolifération : le chromosome Philadelphie
(Ph1).
Le diagnostic nécessite : hémogramme, myélogramme, caryotype et étude en biologie
moléculaire
L'évolution se fait en 3 phases :
1ère phase : chronicité
2ème phase : accélération (10% des pts se présentent d’emblée à ce stade)
3ème phase : transformation aiguë, ou acutisation ou phase blastique
Epidémiologie
Maladie rare : 600 – 1000 nouveaux cas / an en France (incidence = 1-2 nouveaux cas / 100
000 H/an)
Survient surtout entre 30 à 50 ans mais peut se rencontrer à tous les âges (rare chez
l'enfant)
Discrète prédominance masculine : sex ratio = 1,1 à 1,2.
Etiologie inconnue, mais dans 5% des cas elle est secondaire à une exposition chronique au
benzène ou aux radiations ionisantes.
Aspects cliniques généraux
Dans 50% des cas : découverte fortuite sur un hémogramme anormal.
Sinon :
Symptomatologie liée à la splénomégalie (asthénie, sueurs nocturnes, perte de poids),
quasi constante, de volume modéré à très important, indolore, mobile avec la respiration et
isolée (l’échographie abdominale peut être utile).

Hématologie biologique (Pr Marc Zandecki) Faculté de Médecine – CHU 49000 Angers France
__________________________________________________________________________________________
MAJ : janvier 2007 Page 2 sur 10
Le volume de la rate est proportionnel à l’hyperleucocytose
Absence d'adénopathies.
Plus rarement : complications initiales thrombotiques
2. Hémogramme
Anémie modérée : 11-13 g/dl, mais varie en relation inverse de la leucocytose
< 10 g/dl chez 15% des pts
Origine centrale par insuffisance de production ou périphérique par hypersplénisme
La morphologie des hématies est normale sur frottis. Présence d’hématies en larme
(dacryocytes) quand la splénomégalie est volumineuse.
Le nombre d’érythroblastes circulants est < 2%
Hyperleucocytose franche > 50 G/L pouvant dépasser 200 G/L
Au diagnostic : > 100 G/L dans 50% des cas
Polynucléose neutrophile : 40 -60%
Forte myélémie sans hiatus de maturation : 30 -60%
Les métamyélocytes et myélocytes sont majoritaires (25-40%), avec peu de promyélocytes
(< 5%) et pas ou peu de blastes (<2%)
Absence de dysgranulopoïèse.
Petit excès d’éosinophiles : > 0,5 G/l mais pouvant dépasser 10 G/L (= 5 à 20% du total
leucocytaire)
Excès quasi constant de basophiles (> 0.2 G/L), pouvant représenter 10-15% du total des
leucocytes (augmentation très précoce).
Lymphocytes et monocytes : nombre normal (sauf très rares cas d’hypermonocytose
associée à un transcrit particulier)
Aspect du frottis sanguin au diagnostic L’importance de la myélémie augmente avec
la leucocytose
Plaquettes : augmentées dans 50% des cas (parfois > 1000 G/L) (problème possible de
diagnostic différentiel avec une TE, mais il n’y a pas de Ph1 dans la TE)
Présence de quelques noyaux nus de mégacaryocytes sur frottis sanguin dans 25% des cas

Hématologie biologique (Pr Marc Zandecki) Faculté de Médecine – CHU 49000 Angers France
__________________________________________________________________________________________
MAJ : janvier 2007 Page 3 sur 10
3. Myélogramme
Indispensable, au moins pour définir le % blastes (début d'acutisation?)
Ponction médullaire facile à réaliser, avec un os de dureté normale (à l’opposé de la
splénomégalie myéloïde)
Frottis très riche.
Nombreux mégacaryocytes, de taille souvent réduite.
Hyperplasie de la lignée granuleuse où tous les stades de maturation.
Blastose < 5% (mais 5 – 19% dans les cas de diagnostic en phase accélérée)
Erythroblastopénie : classiquement < 10%
Excès d’éosinophiles et de basophiles, en parallèle de l’excès sanguin.
Présence d’histiocytes surchargés de lipofuchsines, qui ont parfois une coloration bleue
(histiocytes bleu-de-mer, appelés à tort de type Gaucher) dans > 30% des cas
Biopsie ostéo-médullaire : moelle très riche avec disparition des adipocytes et absence de
myélofibrose (à l’inverse de la splénomégalie myéloïde)
Hyperplasie granulocytaire: rapport G/E = 10 – 30 (normale = 2-5)
Etalement médullaire richement
cellulaire, avec nombreux
mégacaryocytes (de taille normale ou
réduite)
4. Caryotype
Sur prélèvement de sang si myélémie nette, sinon sur prélèvement médullaire.
Dans 95% des cas : présence du chromosome Philadelphie ou Ph1 qui correspond à un
chromosome 22 raccourci, résultat de la translocation réciproque et équilibrée entre les bras
longs des chr 9 et 22 : t(9;22)(q34;q11).

Hématologie biologique (Pr Marc Zandecki) Faculté de Médecine – CHU 49000 Angers France
__________________________________________________________________________________________
MAJ : janvier 2007 Page 4 sur 10
Caryotype médullaire montrant un chromosome 22 raccourci correspondant au chromosome
Philadelphie (image : F Brizard, Poitiers)
Sur le bras long du chromosome 9 la région ABL (abelson) se coupe (souvent entre les
régions Ib et a2) et sa partie télomérique (a2 …e19…) vient se localiser à la place de la
partie télomérique du bras long du chromosome 22, après b2,b3,…, dans une région
appelée BCR (breakpoint cluster region)
Cette translocation aboutit à un chromosome 22 très court (= Ph1) sur lequel se trouve le
gène chimérique BCR-ABL, formé du début de BCR et le la fin d’ABL
Dans 5 – 10% des cas le Ph1 n’est pas retrouvé tel quel, mais impliqué dans des
translocations complexes (= Ph1 masqué)
En général le Ph1 est isolé (= pas d’autre anomalie), mais parfois on retrouve déjà une ou
quelques unes des anomalies apparaissant au cours de l’évolution = trisomie 8 ou 19,
duplication du Ph1, anomalies du 17.

Hématologie biologique (Pr Marc Zandecki) Faculté de Médecine – CHU 49000 Angers France
__________________________________________________________________________________________
MAJ : janvier 2007 Page 5 sur 10
Remarques : - Le Ph1 est présent dans toutes les lignées cellulaires issues du clone malin
(toutes lignées myéloïdes et lymphocytaire B, rarement les lymphocytes T)
- Il existe un chromosome Ph1 dans un tiers des LAL de l’adulte (mais le transcrit de
fusion est différent)
5. Biologie moléculaire
La translocation juxtapose une partie du gène bcr (breakpoint cluster région) du chr 22 e
l'oncogène Abelson (c-abl) situé sur le chr 9
La conservation du cadre de lecture permet la synthèse d'ARN messagers hybrides dits
chimériques comportant des séquences bcr en 5' et c-abl en 3'.
Les points de cassure sont regroupés entre Ib et Ia sur abl, alors qu’il existe plusieurs
régions de cassure sur bcr :
- La région M bcr est majoritairement impliquée dans la LMC: le transcrit est b3a2 (60%
des cas) ou b2a2 (35% des cas) (on parle de transcrits M bcr pour Major bcr)
Remarque : on peut retrouver les 2 transcrits chez 5 à 10% des pts
L'ARN chimérique bcr/abl est traduit en une protéine de fusion p210 bcr/abl ayant un
pouvoir oncogénique avec très forte activité tyrosine kinase.
- La région m bcr (minor bcr) est impliquée dans 0.4 % des LMC: le transcrit est e1a2, qui
produit la protéine p190 (ce transcrit est fréquemment associé à l’existence d’une
monocytose, une absence de basophilie, et une absence de splénomégalie; par ailleurs il est
celui retrouvé dans environ 2/3 des LAL Ph+)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%