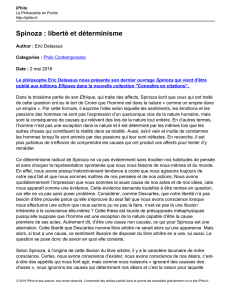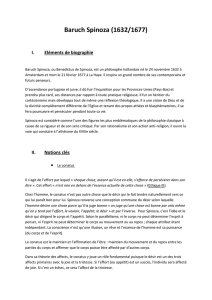impuissance relative et puissance absolue de la raison chez spinoza

1
Comptes Rendus : http://www.erudit.org/revue/philoso/2001/v28/n2/005682ar.pdf ;
Paru in Spinoza, puissance et impuissance de la raison, Coordonné par Christian LAZZERI, Paris : PUF (collection « Débats
Philosophiques »), 1999, pp. 63-91.
IMPUISSANCE RELATIVE
ET PUISSANCE ABSOLUE DE LA RAISON
CHEZ SPINOZA
Charles RAMOND
Université Michel de Montaigne
Bordeaux III
Bien que « puissance » et « raison » ne fassent pas toujours bon ménage,
le spinozisme a pu légitimement être considéré, par les meilleurs de ses
interprètes, aussi bien comme un « rationalisme absolu »
1
que comme une
philosophie de la « puissance »
2
. Une des originalités du système, en effet, est la
constante liaison de la « puissance » à la « raison », dans le refus simultané de
toute dimension irrationnelle de la puissance, et de toute dimension limitative ou
restrictive de la raison. La cinquième partie de l’Éthique, ainsi, identifie
d’emblée « liberté des hommes » et « puissance de l’entendement »
3
; et, plus
explicitement encore, les premières lignes de la Préface de cette même partie
concluent de la « puissance de la raison » à la « puissance » tout court : « je
traiterai ici de la puissance de la raison, montrant ce que la raison elle-même
peut sur les affects, et ensuite ce qu’est la liberté de l’âme ou béatitude, et par là
nous verrons à quel point le sage est plus puissant que l’ignorant »
4
. La
« puissance de la raison », comme on voit, n’est pas pour Spinoza une puissance
abstraite : elle se manifeste, s’exprime, s’exerce, dans l’individu pourvu de
1
Par exemple, par Gueroult.
2
Par exemple, par Deleuze.
3
E V titre : De Potentiâ Intellectus, seu de Libertate Humanâ.
4
E V Préf : In hâc ergo de potentiâ rationis agam, ostendens, quid ipsa ratio in
affectûs possit, et deinde, quid mentis libertas seu beatitudo sit, ex quibus videbimus, quantum
sapiens potior sit ignaro. G (=Gebhardt) II 277 9-12.

IMPUISSANCE RELATIVE ET PUISSANCE ABSOLUE DE LA RAISON CHEZ
S
PINOZA
2
raison, et vivant sous la conduite de la raison. Inversement, parler d’une
puissance de l’homme sera toujours, chez Spinoza, parler indirectement de la
puissance de la raison : car il n’y a puissance de l’homme que par la supériorité
de la puissance de la raison sur la puissance des affects.
Si le « sage » est « plus puissant » que « l’ignorant », l’ignorant sera
nécessairement « moins puissant » que le sage. Pour autant, la puissance de
l’ignorant n’est pas nulle, elle est seulement inférieure : c’est une impuissance
relative. Et inversement, le sage n’est pas déclaré par Spinoza « tout puissant »,
mais seulement « plus puissant » que l’ignorant : rien n’empêcherait donc
d’envisager des puissances encore supérieures à celle même du sage ; et, de ce
fait, vis à vis de telles puissances, la puissance même du sage pourrait à bon
droit, semble-t-il, être considérée, puisqu’inférieure, elle aussi comme une
« impuissance relative ». Si bien que, de ce point de vue, nous pourrions lire le
spinozisme tout aussi bien comme une doctrine de l’impuissance humaine et de
ses divers degrés (jusqu’à l’impuissance du sage, plus bas degré de
l’impuissance de la raison chez l’homme), que comme une doctrine de la
puissance.
On pensera sans doute qu’il y a là un simple jeu rhétorique, et que la
doctrine n’est modifiée en rien, qu’elle soit considérée comme une doctrine de
l’impuissance ou comme une doctrine de la puissance ; que, de toute manière,
les concepts de « puissance » et « d’impuissance », dans la mesure où ils sont
relatifs l’un à l’autre, sont réciprocables, puisque toute « puissance », envisagée
par rapport à une puissance supérieure, est en réalité une « impuissance », et
puisqu’inversement toute « impuissance », considérée par rapport à une
impuissance supérieure (c’est-à-dire plus impuissante ou moins puissante), est
une « puissance ». Et de fait (ce sera la première partie de notre propos), le souci
spinozien constant de hiérarchiser les puissances légitimerait une telle lecture,
c’est-à-dire autoriserait à lire « l’impuissance de la raison », dans le système,
comme l’exact pendant, mieux, comme l’exact équivalent des divers degrés de
la « puissance de la raison », dans la stricte équivalence de toute « puissance »
relative avec une « impuissance » relative.
Le spinozisme, cependant, ne s’accorderait pas nécessairement dans son
ensemble avec un tel type de jeux logiques ou verbaux, par lesquels il serait au
fond équivalent de parler de « puissance » et « d’impuissance » de la raison. Il
n’est pas toujours indifférent, aux yeux de Spinoza, de considérer les choses
sous l’angle de leur puissance ou selon l’angle de leur impuissance : comme s’il
récusait la neutralité et l’équivalence des termes « puissance » et
« impuissance » ; comme si, au fond, il y avait dans la « puissance » quelque
chose d’irréductible à une « impuissance », et, inversement, dans
« l’impuissance » quelque chose d’irréductible à la « puissance » : en un mot,
comme s’il y avait des déterminations absolues, et non pas relatives, de la
puissance -comme s’il pouvait exister une essence de la puissance distincte
d’une essence de l’impuissance. Nous voudrions en effet montrer ici que la

IMPUISSANCE RELATIVE ET PUISSANCE ABSOLUE DE LA RAISON CHEZ
S
PINOZA
3
lecture indifférentiste ou relativiste de la doctrine spinozienne de la puissance ne
peut être poussée à son terme sans rencontrer, ou susciter, dans le système, des
objections ou des apories insurmontables, qui entraînent en retour et
nécessairement une lecture différenciante ou absolutisante de la puissance et de
l’impuissance –avant de tenter, pour finir, de dégager les raisons de cette
présence simultanée et paradoxale, chez Spinoza, d’une impuissance relative et
d’une puissance absolue de la raison.
L’équivalence entre un degré quelconque de puissance et un degré
quelconque d’impuissance (c’est-à-dire, la possibilité d’interpréter toujours un
degré de puissance comme un degré d’impuissance) suppose une hiérarchisation
des puissances : car une puissance donnée n’est impuissance que relativement à
une puissance supérieure. La hiérarchisation des puissances est d’ailleurs au
cœur de la doctrine de la « Nature naturée », ou des « choses singulières » : « Il
n’est donné aucune chose singulière dans la nature, qu’il n’en soit donné une
autre plus puissante et plus forte. Mais pour chaque chose donnée il en est donné
une autre plus puissante, par laquelle la première peut être détruite »
5
. Dans la
mesure où, en l’homme, l’impuissance de la raison varie en proportion de la
puissance des affects
6
, on ne s’étonne donc pas de voir Spinoza se soucier
d’établir avec la plus grande minutie les puissances respectives des affects entre
eux, et de la raison par rapport aux affects
Une telle comparaison n’est elle-même possible que si les affects entre
eux, et les affects et la raison sont rendus comparables par rapprochement de
leurs natures : et de fait, le souci spinoziste de hiérarchiser les puissances
entraîne l’homogénéisation progressive, d’œuvre en œuvre, des champs de
l’affectivité et de la raison. Dans le Court Traité, Spinoza définissait les
« passions » par petits groupes hétérogènes, introduisant sans cesse de nouveaux
critères de définition sans jamais les harmoniser, et sans donner de loi de
passage d’une passion à l’autre, ou d’un groupe de passions à un autre groupe.
Dans l’Éthique au contraire, les critères de définition des « affects » sont réduits
au minimum, et les affects appartiennent tous à un même champ homogénéisé
selon la hiérarchie quantitative des puissances respectives. Une combinatoire ou
arithmétique des passions peut alors se développer, selon une manière
d’additions et de soustractions, par « augmentations » ou « diminutions » de
notre « puissance d’agir », les affects étant finalement définis comme « les
affections du corps, par lesquelles la puissance d’agir de ce corps est accrue ou
diminuée, secondée ou réduite, et en même temps les idées de ces affections »
7
.
5
E IV préf : nulla res singularis in rerum naturâ datur, quâ pententior et fortior non
detur alia. Sed quâcuncuqe datâ datur alia potentior, à quâ illa data potest destrui.
6
À l’exception notable des « affects nés de la raison », que nous analysons un peu
plus loin.
7
E III déf 3 : Per affectum intelligo corporis affectiones, quibus ipsius corporis

IMPUISSANCE RELATIVE ET PUISSANCE ABSOLUE DE LA RAISON CHEZ
S
PINOZA
4
La « joie » <laetitia> sera alors « une passion par laquelle l’âme passe à une
perfection plus grande » <passio, qua mens ad majorem perfectionem transit>,
et la tristesse, inversement, « une passion, par laquelle l’âme passe à une
perfection moindre » <ad minorem perfectionem>. Nous avons cité Éthique III
11 scolie, et non pas, comme on le fait plus usuellement, III définitions des
affects 2 et 3, pour faire remarquer que, du moins en cet endroit, Spinoza associe
« joie » et « tristesse » sous le nom commun de « passion » : or, la communauté
de nature de la « joie » et de la « tristesse » sous le nom de « passions » est-elle
autre chose en cet endroit qu’une expression de la communauté de nature entre
« puissance » et « impuissance » ?
L’homogénéisation quantitative du champ des affects, sous les catégories
de « l’augmentation » et de la « diminution » de la « puissance d’agir » est
d’ailleurs poussée à un point tel qu’elle conduit Spinoza à ramener le désir et les
affections du désir à celles de la joie et de la tristesse. Le statut du désir est en
effet difficile à concevoir dans une conception homogène et quantifiée des
puissances des affections : le désir <cupiditas> se définit en effet comme
« appétit » <appetitus>, c’est-à-dire comme « effort » <conatus>, cet « effort
lui-même n’étant autre chose (III 7 dém) que la « puissance » par laquelle
chaque chose s’efforce de persévérer dans son être <potentia, sive conatus, quo
in suo esse perseverare conatur>. De ce fait, le désir, comme la joie et la
tristesse, affecte la puissance de l’individu. Comment concevoir, cependant, une
« troisième voie » entre une « augmentation » et une « diminution » de la
puissance d’agir ? À moins de faire l’hypothèse que le « désir » serait le nom
d’un type d’affects qui n’augmenteraient ni ne diminueraient la puissance d’agir,
la laissant stable, identique à ce qu’elle était auparavant ? Mais, outre que cette
hypothèse est en contradiction avec l’idée intuitive et immédiate que chacun se
fait du « désir », comme modification bien réelle de notre affectivité, elle est en
elle-même contradictoire avec la définition spinoziste des affects : un affect qui
n’augmenterait ni ne diminuerait la puissance d’agir ne serait, en effet,
précisément pas un affect.
Spinoza reste très cohérent sur ce point : on imaginerait à tort qu’il
conçoit le désir comme premier, vide, affect indéterminé en quelque sorte, qui,
« ensuite », prendrait la direction d’une « augmentation » ou d’une
« diminution » de la puissance d’agir. En réalité, le désir est toujours déjà
affecté, toujours déjà une joie ou une tristesse : « le désir est l’essence de
l’homme en tant qu’elle est conçue comme déterminée à faire quelque chose par
une affection quelconque donnée en elle » (déf aff 1). Il n’y a donc pas de « désir
indéterminé » : tout désir est une joie ou une tristesse, ou peut s’y ramener ; sans
doute, Spinoza déclare (III déf aff 31 expl) avoir regroupé, d’un côté, les affects
de joie et de tristesse, et, de l’autre, les « affects qui se ramènent au désir »
(comme s’il y avait chez lui, contrairement à ce que nous soutenons, trois types
agendi potentia augetur, vel minuitur, juvatur, vel coërcetur, et simul harum affectionum
ideas.

IMPUISSANCE RELATIVE ET PUISSANCE ABSOLUE DE LA RAISON CHEZ
S
PINOZA
5
d’affections et non deux) ; mais on peut montrer que, sans exception, les affects
que Spinoza ramène au désir sont, d’après les définitions qu’il en donne, des
affects de la joie ou de la tristesse
8
. D’ailleurs, la Définition générale des affects,
à la fin de la troisième partie de l’Éthique, n’envisage que deux cas de
modification de la « force d’exister » (que nous avons appelée plus haut, comme
Spinoza lui-même, « puissance d’agir ») : qu’elle devienne « plus grande » ou
« moindre », sans autre possibilité
9
. De ce point de vue, la considération du
« désir » dans un affect, comme le précise explicitement Spinoza, n’est pas un
« troisième type » de modification de la puissance d’agir, qui prendrait
inexplicablement place entre « l’augmentation » et la « diminution », mais un
changement de point de vue, par lequel on s’intéresse aux pensées qui résultent
des affects plutôt qu’aux variations quantitative de la puissance d’agir qui les
définissent.
Plus rien ne s’oppose, de ce fait, à la comparaison des puissances
respectives des affects, non plus qu’à leurs multiples combinaisons. Spinoza,
dans les parties III, IV et V de l’Éthique, étagera donc la puissance respective
des affects
10
: les affects seront, pour l’essentiel, d’autant plus forts que leurs
causes sont « présentes », et d’autant moins forts que leurs causes sont
« absentes » : distinction est fondamentale en ce qu’elle prépare de loin la
possibilité, comme on va le voir, de la sortie de l’affectivité passionnelle au
moyen des affects « nés de la raison ». Que nous soyons, donc, affectés d’abord
et avant tout par les causes que nous imaginons « présentes », permet à Spinoza
de mettre en évidence l’impuissance de la raison, ou des affects nés de la raison,
sur les affects passifs, en décrivant la vie passionnelle comme une vie
instinctuelle, animale, faite de stimulations et de réactions immédiates dans
laquelle nous sommes, pour reprendre des derniers mots du dernier scolie de
l’Éthique, « ballottés de beaucoup de façons par les causes extérieures »
11
. De ce
point de vue (pour donner une idée générale de la hiérarchie de puissance des
affects, ou, ce qui revient au même dans la perspective qui est la nôtre en ce
moment, de la hiérarchie de nos impuissances), de ce point de vue, donc, nous
8
Nous avons donné cette démonstration dans notre Qualité et Quantité dans la
Philosophie de Spinoza (Paris, PUF, 1995, 281-283), et nous permettons d’y renvoyer le
lecteur.
9
Un affect, dit Passion de l’âme <animi pathema>, est une idée confuse par laquelle
l’âme <mens> affirme une force d’exister de son corps, ou d’une partie de son corps, plus
grande ou moindre qu’auparavant <majorem vel minorem [...] existendi vim, quam antea,
affirmat>, et qui, donnée <quâ datâ>, détermine l’âme elle-même <ipsa mens [...]
determinatur> à penser à une chose plutôt qu’à une autre ». On note bien, ici, l’absence d’une
« troisième voie » entre « augmenter » et « diminuer » la « force d’exister » du corps.
10
Nous avons analysé en détail cette hiérarchisation dans Qualité et Quantité, op cit,
285-289.
11
E V 42 sc : « l’ignorant, outre qu’il est de beaucoup de manières ballotté par les
causes extérieures » <ignarus enim, praeterquam quod a causis externis multis modis
agitatur>, etc.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%