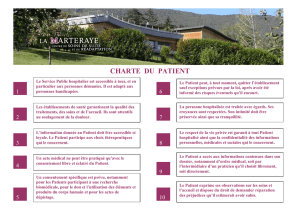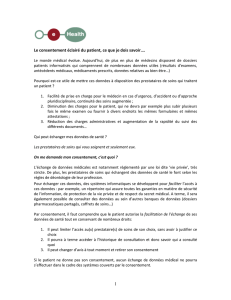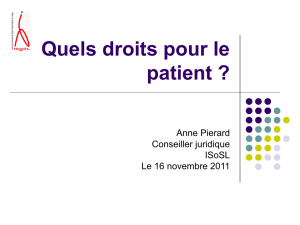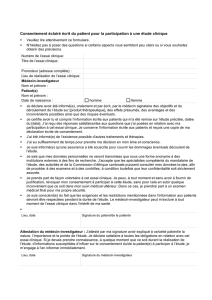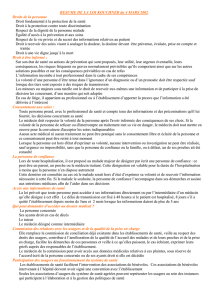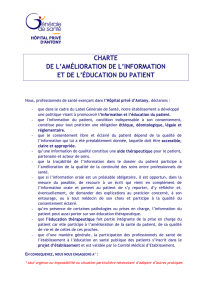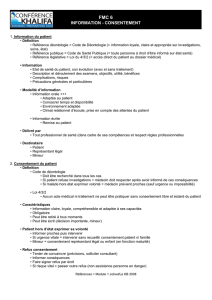Refus de soin et consentement : forces et faiblesses

Éthique
et
santé
(2015)
12,
56—63
Disponible
en
ligne
sur
ScienceDirect
www.sciencedirect.com
DÉMARCHES
ET
OUTILS
:
CONCEPTS
Le
refus
de
soin
:
forces
et
faiblesses
du
consentement
Refusal
of
medical
care:
The
strengths
and
weaknesses
of
giving
consent
P.
Huma,∗,
D.
Bouryb,
T.
Danelc,
L.
Demaillyd,
V.
Dujardine,
C.
Ethuinf,
F.
Lequing,
F.-R.
Pruvoth,
A.
Racinei,
P.
Valettej,
S.
Vandoolaeghek,
B.
Weili,
S.
Weillg
aF2RSM
(fédération
de
recherche
régionale
en
santé
mentale
du
Nord
Pas-de-Calais),
CP2A
(centre
psychiatrique
d’accueil
et
d’admission),
EPSM
agglomération
lilloise,
59800
Lille,
France
bDépartement
d’éthique,
institut
catholique
de
Lille,
5900
Lille,
France
cF2RSM
(fédération
de
recherche
régionale
en
santé
mentale
du
Nord
Pas-de-Calais),
CHRU,
5900
Lille,
France
dUniversité
de
Lille
1,
5900
Lille,
France
eEPSM
Lille
métropole,
5900
Lille,
France
fNord-mentalité
(association
d’usagers),
5900
Lille,
France
gEPSM
agglomération
lilloise,
5900
Lille,
France
hChirurgie
digestive
et
transplantation,
espace
éthique
hospitalo-universitaire
de
Lille,
CHRU,
5900
Lille,
France
iCP2A,
(centre
psychiatrique
d’accueil
et
d’admission),
EPSM
agglomération
lilloise,
5900
Lille,
France
jService
du
SAMU
62,
centre
hospitalier
d’Arras,
62000
Arras,
France
kEspace
éthique
hospitalo-universitaire
de
Lille,
CHRU,
5900
Lille,
France
Disponible
sur
Internet
le
20
f´
evrier
2015
∗Auteur
correspondant.
Adresses
e-mail
:
(P.
Hum),
Dominique.BOUR[email protected]
(D.
Boury),
thierry[email protected]
(T.
Danel),
(L.
Demailly),
(V.
Dujardin),
(C.
Ethuin),
(F.
Lequin),
Francois-R[email protected]
(F.-R.
Pruvot),
(A.
Racine),
Pierre.V[email protected]
(P.
Valette),
Sylvie.V[email protected]
(S.
Vandoolaeghe),
(B.
Weil),
(S.
Weill).
http://dx.doi.org/10.1016/j.etiqe.2014.09.002
1765-4629/©
2014
Elsevier
Masson
SAS.
Tous
droits
réservés.

Le
refus
de
soin
:
forces
et
faiblesses
du
consentement
57
MOTS
CLÉS
Refus
de
soin
;
Consentement
;
Négociation
;
Éthique
;
Contrainte
Résumé
Le
consentement
occupe
une
place
centrale
dans
le
déroulement
des
soins
d’un
point
de
vue
clinique,
juridique
et
éthique.
La
pratique
du
soin
en
psychiatrie
en
mesure
les
effets
bien
que
la
psychiatrie
ne
soit
pas
la
seule
discipline
concernée.
Néanmoins,
la
notion
de
consentement
est-elle
capable
de
porter
les
ambitions
qu’on
lui
prête
?
La
notion
de
refus
de
soin
éclaire
ces
différents
problèmes.
En
effet,
le
refus
de
soin
n’est
pas
simplement
un
obs-
tacle
aux
soins
:
quelle
valeur
peut-on
accorder
à
un
consentement
si
négocier
est
impossible,
si
refuser
les
soins
n’est
pas
envisageable
?
Cet
angle
d’approche
permet
de
préciser
les
carac-
téristiques
immanentes
au
consentement.
Il
met
aussi
en
évidence
certaines
représentations
erronées
du
consentement,
ainsi
que
les
formes
de
quasi
contrainte
qui
caractérisent
les
faux
consentements,
les
consentements
extorqués,
les
désaccords
non
exprimés
ou
mal
écoutés.
C’est
dans
une
perspective
critique
que
seront
envisagées
les
faiblesses
et
les
limites
de
la
notion
de
consentement.
C’est
aussi
pourquoi
nous
aurons
recours
au
moment
du
refus
de
soin.
Ce
temps
n’est
peut-être
pas
à
redouter
et
il
aide
à
concevoir
un
usage
restreint
et
pertinent
du
consentement.
Consentir
à
des
soins
nécessite
des
temps
de
négociation,
sur
la
base
d’une
dynamique
relationnelle,
afin
d’aboutir
à
des
accords
sur
les
soins.
©
2014
Elsevier
Masson
SAS.
Tous
droits
réservés.
KEYWORDS
Refusal
of
care;
Consent;
Negotiation;
Ethics;
Constraint
Summary
The
act
of
giving
consent
plays
a
primordial
role
in
the
delivery
of
care
as
per-
ceived
from
a
clinical,
legal
or
ethical
standpoint.
Recourse
to
psychiatric
care
measures
the
effects
even
though
psychiatry
is
not
the
only
discipline
concerned.
Nevertheless,
can
it
be
said
that
the
concept
of
consent
truly
achieves
its
supposed
ambitions?
The
notion
of
refusing
care
sheds
light
on
these
varying
problems.
Indeed,
refusing
care
is
not
simply
an
obstacle
to
receiving
care:
what
value
can
be
granted
to
giving
consent
if
it
is
not
possible
to
negotiate
the
issue,
or
if
refusing
care
is
not
a
viable
option?
This
perspective
enables
giving
the
precise
immanent
characteristics
for
consent.
It
also
highlights
certain
misrepresentations
concerning
consent,
together
with
types
of
almost
formal
constraint
that
are
seen
in
cases
of
false
consent,
consent
given
by
force,
and
disagreements
that
are
not
expressed
directly
or
misinterpreted.
It
is
through
a
critical
perspective
that
the
weaknesses
and
limits
to
the
notion
of
consent
will
be
considered.
It
is
also
the
reason
why
we
resort
to
this
at
the
very
moment
when
refusal
of
care
occurs.
Maybe
this
moment
should
not
be
considered
as
negative,
and
it
does
help
in
for-
mulating
a
limited
and
pertinent
use
of
the
consent.
Consenting
to
care
involves
a
negotiation
period
that
relies
on
a
basis
of
relational
dynamics,
with
a
view
to
obtaining
acceptance
for
care.
©
2014
Elsevier
Masson
SAS.
All
rights
reserved.
Introduction
Lorsqu’un
patient
refuse
les
soins
proposés,
une
négocia-
tion
complexe
s’engage
entre
le
malade
et
le
médecin.
Deux
volontés
se
confrontent,
celle
du
malade
et
celle
du
méde-
cin,
s’ajoute
une
demande
de
la
famille
et
des
proches
dans
un
contexte
sociétal
donné.
Ce
conflit
comporte
des
enjeux
éthiques
manifestes
:
ce
qui
est
médicalement
souhaitable
pour
un
malade
est
refusé
par
le
malade
lui-même.
Quels
sont
les
enjeux
éthiques
liés
au
refus
de
soin
?
Le
refus
de
soin
est-il
simplement
l’absence
de
consentement
?
Et
si
ce
n’est
pas
le
cas,
comment
l’étude
du
refus
de
soin
permet-
elle
de
mieux
saisir
les
limites
et
les
faiblesses
de
la
notion
de
consentement
?
Car
—
se
sera
notre
premier
temps
—
le
refus
de
soin
ne
conduit
pas
forcément
à
une
rupture.
Le
refus
des
soins
n’est
pas
toujours
un
refus
de
tous
les
soins.
Aussi
est-il
souvent
surmonté
avec
un
aménagement
des
soins,
obligeant
alors
à
trouver
un
nouvel
accord,
même
minimal,
entre
le
médecin
et
le
malade.
Cet
accord
convient
néanmoins,
à
ce
moment,
à
ce
malade.
Aussi,
dans
un
second
temps,
le
consentement
apparaît-il
comme
un
accord
soumis
à
certaines
restrictions
et
menacé
aussi
par
plusieurs
pièges.
Notre
hypothèse
est
que
l’étude
du
refus
de
soin
permet
d’éclairer
ce
que
veut
dire
consentir.
Le
refus
de
soin
révèle
d’abord
certaines
caractéristiques
essentielles
du
consentement.
Mais
il
met
aussi
en
évidence
des
consentements
qui
n’en
sont
pas
vraiment,
ainsi
que
certaines
faiblesses
immanentes
au
consentement.
C’est
pourquoi,
dans
un
troisième
temps,
on
s’interrogera
sur
la
capacité
du
consentement
à
por-
ter
les
ambitions
qu’on
lui
prête
aujourd’hui.
L’exemple
de
la
psychiatrie
éclaire
cette
question.
En
effet,
dans
certaines
conditions
et
de
manière
exceptionnelle,
il
est
possible
d’imposer
des
soins
de
telle
sorte
que
le
refus
de
soin
peut
ne
pas
être
pris
en
considération.
Or,
la
distinction
juridique
entre
deux
régimes
de
soin,
l’un
avec
consentement,
l’autre
sans
consentement,
suppose
une
conception
claire
du
consentement,
ainsi
que
la
possibilité
d’évaluer
avec
fiabilité
ce
consentement.
C’est
dans
cette
perspective
critique
qu’on
envisagera
d’abord
de
récuser
un
usage
extensif
et
peu
clair
du

58
P.
Hum
et
al.
consentement,
sur
les
plans
clinique
et
juridique.
Toute-
fois,
on
s’interrogera
sur
la
pertinence
de
garder
la
notion
de
consentement
pour
la
pratique
du
soin,
sous
réserve
d’en
restreindre
radicalement
l’usage
et
la
portée.
Une
fois
encore,
nous
nous
appuierons
sur
le
refus
de
soin
mais
consi-
déré
cette
fois
comme
un
moment
essentiel
—
le
moment
du
refus
de
soin
—
source
et
révélateur
d’enjeux
éthiques.
Car
si
le
moment
du
refus
de
soin
peut
produire
un
effet
de
rupture,
il
est
aussi
susceptible
de
permettre
une
nouvelle
dynamique
relationnelle,
engageant
d’une
manière
plus
res-
trictive
le
médecin
et
le
malade
dans
des
soins
réellement
consentis.
Le
refus
de
soin
:
un
conflit
à
surmonter
?
Le
refus
de
soin
se
présente
d’abord
comme
un
conflit,
entre
un
malade
et
un
médecin.
Quelle
est
la
nature
de
ce
conflit
?
Et
surtout,
faut-il
toujours
tenter
de
surmonter
le
refus
de
soin
et
jusqu’à
quel
point
?
Le
refus
de
soin
:
un
conflit
Le
refus
de
soin
confronte
le
médecin
à
un
problème
:
ce
qui
est
utile
et
souhaitable
pour
un
malade,
d’un
point
de
vue
médical,
est
refusé
par
le
malade
lui-même.
Ce
refus,
qui
oppose
le
médecin
et
le
malade,
se
décline
de
différentes
manières
:
•comme
la
confrontation
du
droit
du
patient
à
décider
(fai-
sant
aussi
valoir
sa
liberté)
et
d’une
volonté
de
soigner
(mélange
d’obligation
et
de
désir)
[1—3]
;
•en
psychiatrie,
l’opposition
aux
soins
est
souvent
sous-
tendue
par
un
symptôme
dont
la
prise
en
charge
relève
justement
des
soins.
Nous
citerons,
par
exemple,
les
idées
de
persécution,
l’incurabilité
du
mélancolique
;
•la
question
du
déni
mérite
un
traitement
particulier.
Repéré
dans
certains
troubles
psychiatriques,
les
soi-
gnants
savent
que
le
déni
existe
dans
tous
les
champs
de
la
médecine,
en
particulier
dans
les
pathologies
chroniques.
La
difficulté,
dans
la
pratique
du
soin,
est
que
le
refus
de
soin
est
bien
souvent
déterminé
par
ces
différents
motifs
[4].
Rares
sont
les
situations
où
ceux-ci
ne
se
mélangent
pas,
à
des
degrés
divers.
La
première
réaction
du
médecin,
face
à
un
refus
de
soin,
est
de
tenter
d’en
comprendre
les
raisons
et
de
ten-
ter
de
le
surmonter.
C’est
d’ailleurs
ce
principe
très
général
qui
anime
le
Comité
consultatif
national
d’éthique
(CCNE),
lorsqu’il
rédige
en
2005
[5]
un
avis
intitulé
précisément
refus
de
traitement
et
autonomie
de
la
personne.
L’angle
d’approche
du
CCNE
consiste
à
aborder
le
consentement
aux
soins,
par
le
biais
du
refus
de
traitement
au
sens
large.
Certes,
le
but
visé
par
le
médecin
est
bien
de
ten-
ter
de
convaincre
le
patient.
De
ce
point
de
vue,
le
CCNE
invite
à
rechercher
les
différents
obstacles
au
consente-
ment,
notamment
les
raisons
extérieures
parfois
peu
prises
en
considération
(par
exemple,
les
pressions
ou
obstacles
culturels,
religieux,
familiaux,
etc.).
Néanmoins,
l’effort
fourni
pour
obtenir
le
consentement
doit
s’organiser
selon
certaines
modalités,
avec
des
limites.
En
effet,
dans
cet
avis
du
CCNE,
deux
points
nous
semblent
très
pertinents
et
ils
comportent
des
enjeux
éthiques.
En
premier
lieu,
on
ne
doit
pas
se
satisfaire
d’un
consen-
tement
acquis
trop
rapidement,
autrement
dit,
non
éclairé.
Il
faut
convaincre
en
expliquant.
L’information
donnée
par
le
médecin
doit
être
adaptée
à
l’état
du
malade
(celui-ci
ne
dispose
pas
forcément
du
vocabulaire
technique,
il
est
dans
un
état
de
faiblesse
lié
à
la
maladie
etc.).
Rappelons
que
c’est
dans
la
loi
du
4
mars
2002
[6]
qu’il
est
mis
l’accent
sur
les
droits
des
malades
et
l’autonomie
de
la
personne,
soit
3
ans
avant
l’avis
du
CCNE.
Aussi,
le
consentement
du
malade
ne
doit-il
pas
être
simplement
implicite
mais
bien
explicite.
En
second
lieu,
le
refus
de
soin
n’est
pas
forcément
une
opposition
à
tous
les
soins.
Un
refus
de
soin
est
bien
souvent
un
refus
de
certains
soins.
De
ce
point
de
vue,
le
CCNE
insiste
sur
l’intérêt
de
faire
preuve
d’innovation,
de
proposer
un
programme
de
soin
adapté
à
la
personne
et
pas
seulement
à
la
maladie.
Aussi,
les
soins
doivent-ils
être
appropriés
à
cette
personne
malade,
à
cette
personne
toujours-déjà
sin-
gulière,
sur
la
base
d’un
accord
commun
explicite.
Faire
préciser
sur
quoi
porte
le
refus
peut
permettre
d’obtenir
un
consentement
à
des
soins
précis.
Dans
cette
perspective,
la
recherche
du
consentement
doit
envisager
la
possibilité
de
se
heurter
à
un
refus
de
soin
radical.
En
effet,
quelle
est
la
valeur
d’un
consentement
si
aucun
refus
de
soin
n’est
envisageable
?
La
recherche
d’un
consentement
éclairé
et
la
négociation
des
soins
concrets
consentis
n’ont
de
valeur
que
si
le
refus
de
soin
reste
une
possibilité.
Pourtant,
en
psychiatrie,
dans
certaines
conditions,
il
est
possible
d’imposer
des
soins
sous
contrainte
face
à
un
refus
de
soin.
La
possibilité
d’une
contrainte
ne
remet-elle
pas
en
cause
la
dynamique
relationnelle
qui
caractérise
la
recherche
du
consentement
?
Dans
quelles
situations
par-
ticulières
la
discussion
sur
les
soins
consentis
n’est
plus
possible
?
Les
particularités
de
la
psychiatrie
:
des
refus
de
soin
parfois
inacceptables
?
En
psychiatrie,
le
refus
de
soin
est
peut-être
plus
complexe
que
dans
les
autres
champs
de
la
médecine.
En
effet,
la
psy-
chiatrie
comporte
des
particularités
et
certaines
de
celles-ci
ont
un
impact
sur
la
valeur
du
refus
de
soin.
Une
première
particularité
consiste
dans
le
fait
qu’il
existe
des
pathologies
[7]
susceptibles,
à
certains
moments,
d’invalider
la
valeur
du
consentement
ou
du
refus
de
soin.
En
effet,
les
soins
peuvent
être
refusés
lorsque
le
patient
est
dans
une
situation
de
déni
ou
de
non
demande
de
soin
[8].
Pourquoi
consentir
à
des
soins
pour
une
mala-
die
qu’il
n’a
pas
?
Les
soins
peuvent
aussi
faire
l’objet
d’une
compréhension
délirante,
comme
le
délire
peut
moti-
ver
le
refus
de
soin
(empoisonnement,
complot
visant
à
faire
taire
le
patient
etc.).
Dans
les
cas
de
désorganisa-
tion
de
la
pensée,
c’est
la
recevabilité
du
consentement
qui
doit
être
discutée.
Ces
situations
cliniques,
dont
la
liste
n’est
pas
exhaustive,
peuvent
parfois
justifier,
médicale-
ment
et
juridiquement,
des
soins
sous
contrainte.
Toutefois,
l’impossibilité
à
consentir
n’implique
pas
nécessairement
une
mesure
de
soins
sous
contrainte.
Une
deuxième
particularité
de
la
psychiatrie
prolonge
la
possibilité
d’un
consentement
ou
d’un
refus
de
soin
non
valide
ou
non
éclairé.
Et
en
effet,
les
établissements
publics

Le
refus
de
soin
:
forces
et
faiblesses
du
consentement
59
psychiatriques,
depuis
1838,
sont
régis
par
une
loi
derniè-
rement
modifiée
en
juillet
2011
puis
en
2013
[9],
celle-ci
distinguant
les
soins
avec
consentement
(la
plupart
des
soins)
et
ceux
sans
consentement.
En
outre,
faut-il
ajouter
aux
soins
sous
contrainte
les
autres
formes
d’obligation
de
soins
ambulatoires,
notamment
par
décision
judiciaire
[10].
La
légitimité
d’une
telle
contrainte
est
liée
à
un
consen-
tement
temporairement
non
stable
ou
non
valide,
comme
nous
venons
de
le
préciser.
C’est
précisément
la
possibilité
d’une
contrainte
qui
attire
toute
notre
attention
car
elle
met
en
place
une
limite
structurelle
à
la
recherche
du
consentement
et
à
la
prise
en
compte
du
refus
de
soin.
Pour
notre
part,
nous
n’interrogerons
pas
ici
la
légitimité
d’une
contrainte
de
soin,
sous
réserve
que
celle-ci
soit
de
l’ordre
de
l’exception,
soumise
à
conditions
et
encadrée
par
un
réel
contrôle
des
autorités
compétentes.
En
revanche,
nous
insisterons
sur
les
nouvelles
questions
éthiques
produites
par
une
contrainte.
En
effet,
celles-ci
portent
alors
sur
la
privation
de
certaines
libertés
(notamment,
celle
de
se
déplacer,
celle
aussi
de
choisir
ou
de
refuser
les
soins),
sur
le
type
de
soin
possible
dans
ces
conditions.
Aussi,
une
décision
de
contrainte,
qui
est
avant
tout
médicale
et
clinique,
nous
confronte-t-elle
ensuite
à
des
questions
éthiques
très
différentes.
Deux
problèmes
se
présentent
alors.
En
premier
lieu,
le
médecin
peut
se
tromper
en
imposant
des
soins,
alors
que
des
soins
librement
consentis
auraient
été
possibles,
alors
que
le
refus
de
soins
aurait
dû
être
acté.
En
vérité,
la
psychiatrie
soigne
souvent
des
patients
déli-
rants
sans
pour
autant
exiger
une
mesure
de
contrainte.
C’est
dire
que
la
décision
d’imposer
(ou
de
ne
pas
imposer)
des
soins
sous
contrainte
prend
appui
sur
d’autres
éléments,
liés
notamment
au
comportement,
à
l’environnement,
au
contexte
politique
[11].
Et
en
second
lieu,
la
menace
(implicite
ou
explicite)
de
soins
sous
contrainte
n’oblige-t-elle
pas
parfois
un
patient
à
accepter
des
soins,
de
peur
de
se
voir
imposer
des
soins
?
Elle
fait
alors
courir
le
risque
d’interdire
l’expression
libre
d’un
refus
de
soin
et
d’induire
alors
un
consentement
contraint,
par
l’usage
de
l’intimidation.
Ces
différents
problèmes,
rencontrés
spécifiquement
dans
la
pratique
psychiatrique,
ne
manifestent-ils
pas
plus
généralement
la
complexité
du
consentement
et
du
refus
de
soin
?
Autrement
dit,
cette
réflexion,
issue
de
la
psychia-
trie,
n’est-elle
pas
également
pertinente
pour
l’ensemble
du
champ
de
la
médecine
?
Quelles
sont
donc
les
caractéristiques
du
consentement,
en
dec¸à
des
situations
cliniques
psychiatriques
?
Consentir
?
Les
consentements
qui
n’en
sont
pas
vraiment
Le
refus
du
soin,
en
obligeant
à
rechercher
et
à
imaginer
un
nouvel
accord,
illustre
le
caractère
dynamique
du
consen-
tement.
L’hypothèse,
que
nous
proposons
d’examiner,
est
la
suivante
:
le
refus
de
soin,
précisément
parce
qu’il
reste
possible,
ne
révèle
t-il
pas
certaines
caractéristiques
essen-
tielles
propres
au
consentement
?
Pour
mieux
cerner
les
caractéristiques
du
consentement,
nous
proposons
de
le
cir-
conscrire
en
identifiant
plusieurs
types
de
consentement
qui
n’en
sont
pas
vraiment.
En
ce
sens,
nous
pourrions
parler
de
consentements
déguisés.
Le
premier,
l’idéal
du
consen-
tement,
consiste
à
envisager
le
consentement
comme
un
accord
inconditionné
et
définitif.
Le
deuxième
est
l’opposé
:
l’accord
sur
les
soins
est
trop
mince,
rien
de
clair
n’a
vrai-
ment
été
arrêté.
Le
troisième
est
un
consentement
contraint
(par
exemple,
grâce
au
recours
à
la
menace
de
soin
sous
contrainte).
Enfin,
une
dernière
forme
est
un
consentement
abstrait,
c’est-à-dire,
hors
de
toute
dynamique
relation-
nelle,
hors
du
champ
clinique.
Ces
quatre
représentations
erronées
du
consentement
mettent
en
valeur
l’hypothèse
que
nous
proposons
dans
cette
deuxième
partie
:
le
consen-
tement
aux
soins,
dans
la
pratique,
est
par
définition,
toujours
partiel,
évolutif
et
soumis
à
une
dynamique
rela-
tionnelle.
Le
consentement
:
un
accord
partiel
et
temporaire
Tout
d’abord,
le
consentement
est
peut-être
toujours
par-
tiel.
Consentir,
c’est
accepter
certains
soins,
c’est
se
mettre
d’accord
sur
un
schéma
précis
de
soin.
Il
semble
pertinent
de
mettre
en
perspective
la
réalité
partielle
du
consentement
avec
une
de
ses
fausses
représentations,
que
nous
pour-
rions
appeler
un
idéal
de
consentement.
En
effet,
il
serait
absurde
qu’un
patient
accepte
tout,
sans
aucune
condi-
tion,
ni
réserve.
Cet
idéal
serait
quelque
chose
comme
un
consentement
total,
l’inverse
d’un
consentement
trop
par-
tiel,
tellement
partiel
qu’il
deviendrait
inconsistant
(aucun
point
de
vue
commun,
entre
le
médecin
et
le
malade).
Ces
deux
extrêmes
entourent
et
limitent
la
réalité
du
consente-
ment.
Le
refus
de
soin,
ne
serait-ce
que
comme
possibilité,
oblige
donc
le
médecin
et
le
malade
à
se
mettre
d’accord
sur
des
soins
précis.
Cet
accord
n’est
pas
définitif
:
c’est
ce
deuxième
point
qu’il
faut
préciser.
En
effet,
le
propre
du
consentement
est
précisément
d’être
soumis
à
conditions
dans
un
temps
donné.
C’est
une
conquête
quotidienne
:
ce
n’est
pas
parce
que
le
patient
consent
un
jour
qu’il
va
nécessairement
consentir
le
lende-
main,
surtout
dans
certaines
situations
aigues
ou
de
crise.
Par
exemple,
l’apparition
d’effets
secondaires
liés
à
un
trai-
tement,
le
comportement
ou
la
réaction
des
proches,
le
fonctionnement
d’un
service
d’accueil,
l’image
renvoyée
par
la
psychiatrie
:
toutes
ces
raisons
(et
d’autres
encore)
peuvent
susciter
le
refus
de
certains
soins
et
rendre
néces-
saire
une
nouvelle
négociation.
Consentement
et
relation
de
soin
En
plus
du
caractère
partiel
et
temporaire
du
consentement
(avec
comme
deux
extrêmes
un
idéal
de
consentement
et
un
consentement
trop
artificiel,
trop
mince),
une
troisième
caractéristique
s’ajoute
:
il
s’agit
du
caractère
relationnel
du
consentement.
C’est
peut-être
le
point
le
plus
essentiel.
En
effet,
le
consentement
n’est
pas
un
accord
abs-
trait
mais
il
repose
sur
une
relation
entre
un
patient
et
un
médecin,
entre
un
patient
et
une
équipe
soignante,
éventuellement
entre
un
patient
et
un
secteur.
On
parle
parfois
de
contrat,
d’alliance
thérapeutique,
on
parlait
plus
fréquemment
avant
de
transfert
(et
aussi
de
contre
trans-
fert)
:
toutes
ces
manières
de
dire
rendent
compte
de
la
complexité
du
consentement,
de
son
aspect
dynamique
et
relationnel,
des
différents
obstacles
parfois
rencontrés.

60
P.
Hum
et
al.
De
ce
point
de
vue,
le
caractère
relationnel
contribue
à
garantir
une
certaine
stabilité
au
consentement.
C’est
avec
ce
médecin,
cette
équipe,
qu’un
patient
accepte
de
se
faire
soigner,
accorde
sa
confiance,
discute
des
soins
utiles.
C’est
la
qualité
de
la
relation
qui
évite
les
risques
d’un
consen-
tement
trop
partiel,
trop
temporaire.
Mais
c’est
aussi
la
relation
de
confiance
entre
deux
personnes
qui
peut
pré-
cisément
être
le
support
de
violences
relationnelles
[12].
Ce
risque
est
accentué
dans
une
relation
de
soin
qui
relie
un
médecin
(disposant
d’un
savoir,
d’un
pouvoir
et
d’une
responsabilité)
à
un
malade
affecté
par
la
maladie.
Relation
asymétrique
qui
rend
possible
les
soins
mais
qui
est
menacée
aussi
par
ses
ruptures.
Par
ailleurs,
cet
aspect
relationnel
propre
au
consente-
ment
rend
difficile
les
soins
lorsque
le
patient
n’est
pas
connu
d’une
équipe
soignante.
La
nouveauté
d’une
situation
de
crise,
un
patient
qui
change
d’équipe
soignante
contraint
les
équipes
à
prendre
du
temps
avant
d’être
en
mesure
de
s’appuyer
sur
un
consentement
aux
soins.
Nous
pourrions
parler
d’une
temporalité
du
consente-
ment,
d’une
durée
minimale
de
relation
indispensable
aux
subjectivités
singulières
en
jeu
:
singularités
du
patient
et
des
soignants.
Car
le
consentement,
parce
qu’il
n’est
pas
figé,
nécessite
l’adaptabilité
de
chacun.
Ainsi,
c’est
précisément
sur
la
base
de
l’aspect
rela-
tionnel
du
soin
que
surgit
la
menace
d’un
nouveau
risque
éthique.
Ce
risque
est
celui
d’un
consentement
contraint,
ou
encore
d’un
consentement
par
intimidation.
Le
consentement
contraint
En
effet,
à
côté
de
ce
qu’on
peut
appeler
un
idéal
de
consen-
tement
(consentir
à
tout,
de
manière
éclairée
et
définitive),
il
existe
aussi
d’autres
consentements
qui
n’en
sont
pas
vraiment
comme
les
consentements
forcés.
En
psychiatrie,
l’intimidation
peut
prendre
le
visage
de
la
menace
d’une
contrainte
possible.
Le
risque
est
alors
le
suivant
:
forcer
le
consentement,
par
la
menace
de
soins
sous
contrainte.
Ce
risque
est
par-
ticulièrement
présent
dans
les
contextes
d’urgence
et
de
crise.
D’une
part,
il
est
difficile
d’évaluer
un
consente-
ment
aux
soins
en
urgence,
surtout
si
le
patient
n’est
pas
connu
par
l’équipe
qui
l’accueille.
D’autre
part,
il
est
auda-
cieux
de
demander
à
un
patient
de
consentir
à
des
soins
quand
l’équipe
qui
le
prend
en
charge
dans
l’urgence
n’est
pas
celle
qui
continuera
les
soins
dans
la
durée.
Comment
s’engager
pour
les
autres
dans
des
soins
?
En
outre,
l’organisation
des
soins
influe
sur
le
consen-
tement.
Le
fonctionnement
des
secteurs
de
psychiatrie
est
relativement
hétérogène.
On
peut
supposer
que
les
modali-
tés
d’accès
aux
soins
et
le
type
de
prise
en
charge
proposée
peuvent
influer
sur
le
consentement
[13]
ou
le
refus
de
soin.
Le
recours
à
la
menace
d’une
contrainte,
quand
un
malade
hésite
à
accepter
des
soins
nécessaires,
a
pour
effet
de
supprimer
le
moment
du
refus
de
soin.
Il
prive
le
malade
et
le
médecin
de
ce
temps
de
négociation,
qui
parfois
per-
met
de
trouver
un
accord
sur
des
soins
réellement
consentis.
Cette
réflexion
appelle
deux
remarques.
En
premier
lieu,
les
caractéristiques
du
consentement,
pour
nous,
ont
une
portée
générale
et
elles
n’enferment
pas
la
psychiatrie
dans
d’éventuelles
spécificités.
La
reconnais-
sance
du
caractère
relationnel
des
soins,
l’habitude
de
la
négociation,
la
nécessité
d’évaluer
le
consentement
(malgré
les
difficultés
que
nous
avons
soulevées),
les
doutes
parfois
sur
la
capacité
du
patient
à
consentir
:
tous
ces
éléments
révèlent
les
différentes
facettes
de
ce
que
veut
dire
consen-
tir
et
ne
constituent
pas
des
spécificités
psychiatriques.
Et
en
second
lieu,
même
si
cette
réflexion
n’est
pas
spé-
cifique
à
la
psychiatrie,
elle
est
encore
plus
nécessaire
à
la
psychiatrie.
En
effet,
le
moment
du
refus
de
soin
est
une
étape
qui,
parfois,
peut
précéder
une
décision
de
soins
sous
contrainte.
Il
paraît
donc
essentiel
de
prendre
le
temps
d’évaluer
la
valeur
du
consentement,
sans
tomber
dans
les
pièges
liés
aux
consentements
erronés.
Un
risque
possible
serait
d’imposer
une
contrainte
de
manière
très
fréquente
ou
systématique
précisément
sur
la
base
d’une
représenta-
tion
erronée
du
consentement
(qui
serait
total,
indéfini).
Devant
ces
différentes
considérations,
il
nous
semble
que
la
notion
de
consentement
présente
certaines
faiblesses.
Comment
s’assurer
de
la
stabilité
du
consentement
si
celui-
ci
est
par
nature
partiel,
temporaire,
relationnel
et
en
évolution
permanente
?
Quelles
conséquences
peut-on
tirer
des
difficultés
à
évaluer
le
consentement
d’un
patient
?
La
portée
du
refus
de
soin
et
les
faiblesses
du
consentement
Nous
voudrions,
à
présent,
insister
sur
certaines
faiblesses
des
consentements.
On
a
évoqué
plusieurs
risques.
Il
y
a
d’abord
les
consentements
qui
n’en
sont
pas
vraiment
—
les
consentements
déguisés
—
comme
les
consentements
forcés
(par
la
menace
d’une
contrainte).
Faut-il
aussi
se
méfier
des
représentations
erronées
du
consentement
:
un
consen-
tement
qui
serait
idéalisé
(consentir
à
tout),
abstrait
(hors
de
toute
dynamique
relationnelle
et
indépendant
des
soi-
gnants).
La
recherche
du
consentement
se
confronte
donc,
en
permanence,
à
ces
différents
risques
car
ceux-ci
sont
liés
de
manière
constitutive
à
la
réalité
du
consentement,
à
savoir
une
dynamique
relationnelle
générant
un
accord
temporaire
et
partiel,
susceptible
d’être
modifié
ou
remis
en
cause.
Ces
caractéristiques
du
consentement
ne
remettent-elles
pas
en
cause
la
place
accordée
au
consentement
pour
le
déroulement
des
soins
?
On
comprend
les
valeurs
portées
par
le
consentement
(un
accord
éclairé
donné
par
le
patient,
la
reconnaissance
de
leur
autonomie
et
de
leur
responsabi-
lité,
une
légitimité
des
soins,
une
relation
de
confiance).
On
mesure
aussi
la
nécessité
de
disposer
de
normes
juridiques
pour
la
notion
de
consentement.
Mais
le
consentement
est-il
en
mesure
de
porter
de
telles
ambitions
?
Les
critiques
de
la
valeur
du
consentement
L’évolution
des
pratiques
du
soin
[14]
et
des
techniques
ont
un
impact
sur
ce
que
signifie
consentir.
En
effet,
les
soins
aujourd’hui
sont
de
plus
en
plus
spécifiques.
Soigner
se
décompose
alors
en
plusieurs
séquences
de
soin,
avec
le
recours
parfois
à
des
équipes
différentes
et
spécialisées
mais
qui
doivent
rester
cohérentes.
Ce
fait
s’observe
dans
les
différentes
disciplines
de
la
médecine,
dans
la
spécialisa-
tion,
voire
l’hyper-spécialisation
médicale.
En
psychiatrie,
il
y
a,
à
présent
et
de
plus
en
plus
d’équipes
spécialisées,
soit
dans
le
traitement
d’une
pathologie
précise,
soit
dans
des
soins
dits
transversaux.
À
titre
d’exemple,
citons
les
centres
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%