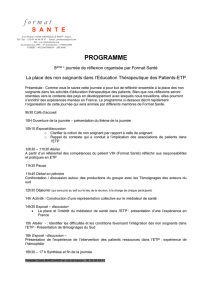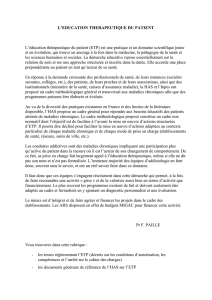Éducation thérapeutique en court séjour : quelles limites ? Cas de

Santé publique
2012, volume 24, n° 4, pp. 291-302
ARTICLES
Correspondance :
Y. Thiam
Réception :
01/08/2011 –
Acceptation :
26/06/2012
Clermont-Ferrand
Éducation thérapeutique en court séjour :
quelles limites ? Cas de patients
cardiovasculaires
The limits of therapeutic education in short-term
hospitalization: the case of cardiovascular patients
Yacine Thiam (1), (2),Laurent Gerbaud (1), (2), (3),Marie-Ange Grondin (3),
Marie Blanquet (2),Laurent Marty (2),Sylvie Pruilhere Vaquier (4),
Pierre-Michel Llorca (5),Jean Cassagnes (6)
(1) Laboratoire Périnatalité, Pratiques et Développement (PEPRADE), EA 4681, Clermont-Ferrand.
(2) Service de Santé Publique - 7 place Henri Dunant - 63000 Clermont-Ferrand.
(3) Faculté de Médecine, Université d’Auvergne, Clermont-Ferrand - France.
(4) Clinique Médicale de cardiopneumologie, Durtol - France.
Résumé :
L’objectif de ce travail était d’identifier les limites d’une prise en charge informative
et éducative des facteurs de risques chez des patients cardiovasculaires en hospitalisation
court séjour. Notre étude s’est basée sur une recherche qualitative basée sur une année
d’enquêtes : 18 situations d’observations des pratiques professionnelles et 18 entretiens
avec 5 professionnels et 13 patients. Les résultats ont montré l’existence d’une discordance
de temps, de préoccupations et d’attentes entre patients et professionnels, qui limitent l’effi-
cacité de la prise en charge proposée. En conclusion, l’hospitalisation court-séjour est vécue
par les patients comme un temps de « survie » après un épisode aigu (Accident Vasculaire
Cérébral ou Infarctus). Elle est inappropriée pour la mobilisation des capacités cognitives et
émotives des patients dans le cadre d’un programme d’éducation thérapeutique.
Mots-clés :
Facteurs de risques cardiovasculaires - éducation thérapeutique du patient -
hospitalisation court séjour - non-observance.
(5) Unité d’Addictologie de liaison, Clinique Médicale Psychiatrique B, CHU Gabriel Monpied, Clermont-
Ferrand - France.
(6) GCS Cardiauvergne - 58, rue Montalembert, Hôpital Gabriel Monpied - 63000 Clermont-Ferrand.
Summary:
The purpose of this study was to examine the limitations of therapeutic education
for patients with cardiovascular risk factors during short hospital stays. The paper presents
the results of a qualitative study conducted over the course of a year involving 18 case studies
of professional practices and 18 interviews with 5 health professionals and 13 patients. The
results show that professionals and patients have conflicting views about the time spent in
hospital, as well as conflicting concerns and expectations, thus limiting the effectiveness
of educational care. The findings suggest that after acute myocardial infarction or a stroke,
patients tend to view themselves as survivors during their experience of short-term
hospitalization in a care unit. As a result, short-term hospitalization may not be conducive to
the mobilization of patients’ cognitive and emotional capacities in a therapeutic education
program.
Keywords:
Cardiovascular risk factors - patient education - therapeutic education program -
short-term hospitalization - non-compliance.

Y. THIAM
et al.
292
Santé publique
2012, volume 24, n° 4, pp. 291-302
Introduction
Les maladies cardiovasculaires posent fréquemment le problème de
l’adhésion des patients au projet thérapeutique notamment en termes de
changement de comportements à risques (tabagisme, déséquilibre alimen-
taire, sédentarité…). Néanmoins, il est aujourd’hui admis que le recours à
l’information des patients et à leur éducation thérapeutique est un élément
sensé résoudre ce problème [1-3].
Au CHU de Clermont-Ferrand, le service de cardiologie en partenariat avec
plusieurs secteurs de soins (Diabéto-endocrinologie, néphrologie, neuro-
logie, Cellule de Nutrition, Addictologie), a mis en place des actions d’édu-
cation thérapeutique du patient (ETP) souffrant de facteurs de risques
cardiovasculaires admis en hospitalisation court séjour. Cependant, malgré
leur mise en œuvre, des situations de récidives et de retour à l’hospitali-
sation sont fréquemment enregistrées. Récidives et retours à l’hospitali-
sation que les équipes médicales et soignantes expliquent par une non-
observance de la part des patients quant aux informations, conseils et pres-
criptions hygiéno-diététiques (arrêt du tabac, activités physiques, alimen-
tation saine et équilibrée, auto-mesure de la pression artérielle, auto-mesure
de l’anticoagulation …) délivrés lors de leur hospitalisation court séjour.
Dans une logique d’encourager l’observance des patients mais également
d’améliorer les pratiques professionnelles en matière d’information et
d’éducation, un travail de recherche sur le thème de la prise en charge
éducative des patients souffrant de facteurs de risques cardiovasculaires, a
été mené. De récentes études [4] ayant montré que la non-observance était
au cœur même de la relation patients/professionnels de santé, la recherche
est partie d’une hypothèse provisoire selon laquelle, la non-observance de
ces patients peut être un produit de l’interaction patients/professionnels
durant la prise en charge informative et éducative. Par interactions, nous
entendons « des actions réciproques modifiant le comportement ou la nature
des éléments corps, objets, phénomènes en présence ou en influence » [5].
L’objectif de cette étude était de retracer les interactions patients/profes-
sionnels durant la prise en charge informative et éducative afin de voir s’il
existe une connexité entre pratiques professionnelles (mode d’organisation
et de mise en œuvre des actions) et non-observance des patients.
Matériels et méthodes
En vue de retracer les interactions patients/professionnels, une enquête
qualitative reposant sur deux stratégies successives a été menée entre juin
2008 et mars 2009 auprès des professionnels de santé (infirmiers, diété-
ticiens, médecins et aides-soignants) et des patients cardiovasculaires en
hospitalisation court séjour.
La première stratégie a consisté à centrer l’enquête sur le déroulement de
la prise en charge (acteurs, contenus, formes, calendrier), notamment sur la
manière dont l’information et l’éducation sont pratiquées par les profes-
sionnels. La technique de l’observation directe a été utilisée.
Particulièrement enrichissante en milieu hospitalier [6, 7], l’observation est
une technique de recueil de données qui permet une appréciation factuelle

PATIENTS CARDIOVASCULAIRES ET ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE 293
Santé publique
2012, volume 24, n° 4, pp. 291-302
de la prise en charge proposée aux patients, notamment les interactions
patients/professionnels. L’analyse du comportement manifeste des observés
plutôt que leurs déclarations de comportement, permet de déceler d’éven-
tuels écarts entre ce que les observés disent faire et ce qu’ils font en réalité.
Une grille d’observation inspirée de celle de Bales [8] a été élaborée pour
analyser les interactions patients/professionnels au cours d’activités d’ETP
sur les thèmes de l’alimentation, du tabac mais également de l’auto-
surveillance du traitement Anti Vitamine K. Les interactions observées étaient
relatives à deux principaux domaines :
1. celui des tâches : qu’est-ce que les professionnels font pour les patients
en termes d’information et d’éducation ? Comment le font-ils ? Quand
est-ce qu’ils le font ? Quel est le rôle de chacun (patients et profes-
sionnels) dans le déroulement de l’activité ? Y a-t-il des échanges
(communication) sur le déroulement de l’activité ? Est-ce que l’activité
répond aux attentes des uns et des autres ? ;
2. celui de la socio-émotion [8] ou socio-affectivité [9] : Quelles sont les
attitudes des uns vis-à-vis des autres durant l’activité ? Est-ce que ces
attitudes s’influencent mutuellement ? Si oui, comment ? Existe-t-il des
manifestations d’accord, de désaccord, d’empathie ou de tension durant
l’activité ? Est-ce que l’émotion est gérée de part et d’autre durant
l’activité ?
La seconde stratégie a, quant à elle, consisté à recueillir le point de vue des
professionnels et des patients sur les résultats issus de ces observations.
Ainsi, des entretiens, dans leurs variantes centrée et semi-directive, ont été
menés afin d’analyser le sens que les individus donnent à leurs pratiques ou
à leurs comportements.
Chez les professionnels, des entretiens centrés ont été menés en vue de
recueillir leurs impressions et leurs points de vue sur les activités qu’ils ont
eues à réaliser auprès des patients. L’entretien centré est une variante intéres-
sante de l’entretien, notamment lorsqu’il s’agit d’analyser l’effet ou l’impact
d’un évènement ou d’une action sur ceux qui y ont participé ou assisté [10].
Au niveau des patients, l’entretien semi-directif a été utilisé comme tech-
nique de recueil de données. Le choix de la semi-directivité s’explique par le
fait qu’elle favorise à la fois la liberté d’expression des patients sans restrein-
dre celle de l’enquêteur, tout en continuant à maintenir une structure faci-
litant l’analyse ultérieure des informations recueillies.
Trois principaux facteurs de risques (tabagisme, déséquilibre alimentaire et
sédentarité), de même que la question de l’autogestion de la maladie et celle
des soins (dans le cas d’un traitement anti vitamine K) ont ainsi été abordés
avec les patients. Des questions relatives à leur vécu de l’épisode aigu et à
leurs ressentis face à la pathologie en général et à l’hospitalisation, ont
également été abordées. En fin d’entretiens, les patients ont été invités à se
prononcer sur la prise en charge proposée afin de voir si elle répondait ou
non à leurs attentes.
Les données recueillies lors de l’enquête par observations et entretiens ont
été exploitées selon les techniques d’analyse de contenu [10-12]. L’analyse a
permis de faire ressortir les liens existant entre les différents résultats
obtenus. Ayant posé comme hypothèse que la non-observance était peut-être

Y. THIAM
et al.
294
Santé publique
2012, volume 24, n° 4, pp. 291-302
un produit de l’interaction patient/professionnels durant la prise en charge
informative et éducative, l’analyse de contenu a permis de mettre en relation
les données suivantes :
–dans le domaine des tâches : mise en relation de « prise en charge
proposée » et « besoins et attentes des patients »,
–dans le domaine socio-émotionnel : mise en relation de « attitudes des
uns » et « comportements des autres ».
Résultats
Les observations ont porté sur 18 situations : 7 consultations infirmières,
4 consultations diététiques, 5 consultations médicales et 2 réunions de staff
abordant les thèmes du tabac, de l’alimentation et des auto-soins.
Concernant les entretiens centrés, 3 infirmières (2 d’addictologie, 1 de
cardiologie), 1 diététicienne et 1 médecin ont été interrogés de manière
intermittente. En ce qui concerne les entretiens semi-directifs, 13 patients
(4 femmes et 9 hommes) d’une médiane d’âge de 53 ans ont été interviewés
pendant une trentaine de minutes en moyenne dans les locaux du service de
cardiologie (27 minutes au minimum et 66 minutes au maximum), soit dans
leurs chambres d’hospitalisation, soit en salle de détente.
Ces patients ont été hospitalisés pour une ou plusieurs des pathologies
suivantes : infarctus du myocarde (IDM), insuffisance cardiaque, revasculari-
sation coronarienne (avec pose de stent ou chirurgie), artériopathie oblité-
rante des membres inférieurs, accident vasculaire cérébral (AVC), hyper-
tension artérielle.
La mise en relation des résultats issus des observations et des entretiens
a mis en exergue quatre circonstances pouvant expliquer la non-observance
des patients : 1°) « un trop plein d’actions informatives et éducatives »,
2°) « des actions menées trop vite », 3°) « un changement de comportement
imposé trop tôt » et 4°) « des projets thérapeutiques trop forts pour les
patients ».
«
Trop plein
d’actions informatives et éducatives »
Indépendamment de la prise en charge médicale, soignante et parfois
chirurgicale dont ils font objet, les patients hospitalisés souffrant de facteurs
de risques cardiovasculaires bénéficient également d’une prise en charge
informative et éducative (tableau I). En effet, très souvent exposés au taba-
gisme, au déséquilibre nutritionnel, au diabète, au surpoids et à la séden-
tarité, ces patients sont mis en relation avec autant de « rééducateurs » qu’ils
ont de facteurs de risques. En une journée, ils peuvent recevoir visites
médicales, soins, interventions ETP sans oublier la visite des proches, le
passage du service d’entretien, etc.
De plus, chaque secteur de soin est autonome dans ses modalités de prise
en charge informative et éducative et aucun travail de coordination n’est
réalisé entre les différents secteurs. De ce fait, ignorant l’activité des autres,
chaque secteur fait son maximum pour le patient. Une situation qui engendre
des redondances mais également des variations de discours dans la prise en

PATIENTS CARDIOVASCULAIRES ET ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE 295
Santé publique
2012, volume 24, n° 4, pp. 291-302
charge globale. À ces variations dues à la spécialisation, s’ajoutent d’autres
variations (réelles ou perçues par le patient) suivant la personne des profes-
sionnels (attitudes, compétences, expériences…) ou suivant la personne
même du patient (attitude, âge, mécanismes psychiques, niveau d’étude,
situation socioprofessionnelle, culture…).
Cet éclatement des différentes modalités de prise en charge à travers les
différents secteurs de soins crée au niveau des patients, un sentiment
d’hétérogénéité et parfois d’incohérence dans la prise en charge globale mais
engendre également une saturation cognitive due au flot d’informations
reçues.
« Des actions menées
trop vite
»
Conjointement à ces problèmes d’hétérogénéité, de surinformation et de
saturation, se pose le problème du calendrier de la prise en charge globale.
En effet, toutes les interventions (soignantes, médicales, informatives, édu-
catives et parfois chirurgicales) ont lieu dans la courte période de l’hospita-
lisation et se succèdent les unes aux autres le plus vite possible. Cette
vitesse dans leur mise en œuvre s’explique, selon les professionnels, par le
temps court dont ils disposent pour s’occuper du patient avant son retour à
Tableau I : Bilan de l’existant en matière de prise en charge informative et éducative durant
l’hospitalisation court séjour des patients souffrant de facteurs de risques cardiovasculaires
Thèmes Contenus Formes Intervenants Fréquences
Alimentation • Explication du régime
méditerranéen proposé
durant l’hospitalisation.
• Analyse de la journée-
type alimentaire.
du patient avec mise en
exergue des points forts
et faibles.
• Élaboration d’un
tableau personnalisé
d’« idéal alimentaire ».
• Remise de livrets.
Entretien individuel
d’environ une heure Diététicien
Au moins une fois
au cours
de l’hospitalisation
Tabagisme • Proposition de
substituts nicotiniques.
• Évaluation de
la dépendance
(Test de Fagerstrom).
• Évaluation de
la motivation au sevrage
(Test de Lagrue).
• Remise de livrets.
Entretien individuel
d’environ une heure Infirmière
d’addictologie
et si besoin
médecin
psychiatre
Autogestion
des soins • Initiation au traitement
Anti-Vitamine K.
• Évaluation des
connaissances du patient
suivi, si besoin, d’une
séance de renforcement
des connaissances.
• Remise de livrets.
Entretien individuel
d’environ une heure Infirmière de
cardiologie
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%