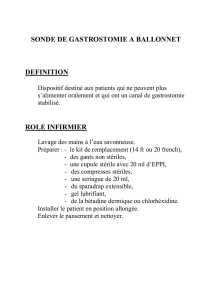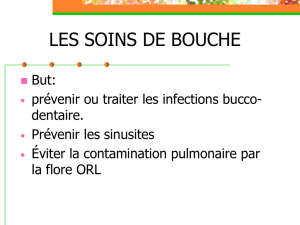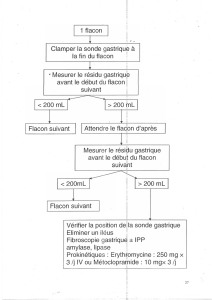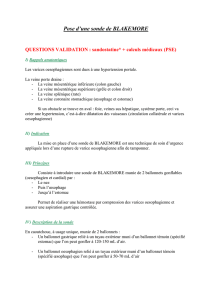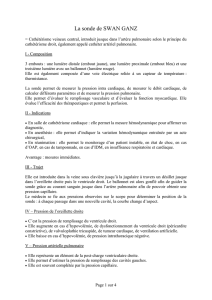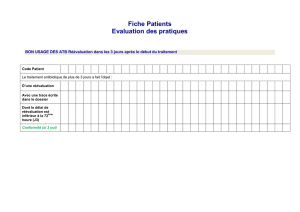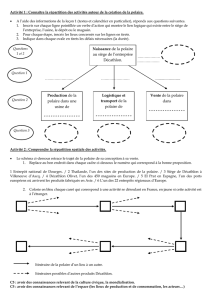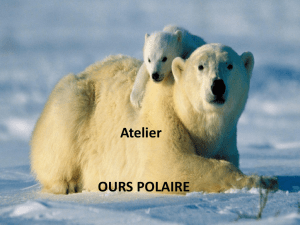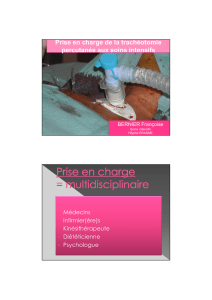Complications de l`endopyélotomie par le ballonnet

ARTICLE ORIGINAL Progrès en Urologie (2003), 13, 39-45,
39
Complications de l’endopyélotomie par le ballonnet “Acucise®”
Jochen WALZ, Catherine LECAMUS, Eric LECHEVALLIER, David BARRIOL, Denis BRETHEAU,
Paul ALBERT, Michel HERMANOWICZ, Christian COULANGE
Service d’Urologie et de Transplantation Rénale, Hôpital Salvator, Service d’Urologie, Hôpital Saint Joseph, Marseille, France
Le traitement de référence de la sténose de la jonction
pyélo-urétérale (JPU) est la chirurgie ouverte. Parmi
les différentes techniques chirurgicales, la technique
d’ANDERSON-HYNES et KÜSS [2] avec résection de la
sténose et anastomose entre l’uretère et le bassinet
rénal est aujourd’hui le standard. Une amélioration de
cette technique est la réalisation de cette intervention
par cœlioscopie comme l’a décrite SCHUESSLER [21] ou
par rétropéritonéoscopie qu’a rapportée JANETSCHEK
[12], dont les premiers résultats ont été publiés en
1993. En 1983, WICKHAM et KELLET [27] ont dévelop-
pé la technique de l’endopyélotomie endoscopique per-
cutanée. Elle a l’avantages d’être moins invasive que la
chirurgie classique ou coelioscopique [12, 21] avec une
durée opératoire et d’hospitalisation plus courtes et une
reprise des activités quotidiennes plus rapide. Cette
technique a d’abord été développée pour un traitement
des sténoses secondaires [11], elle a été ensuite propo-
Manuscrit reçu : mai 2002, accepté : novembre 2002.
Adresse pour correspondance : Pr.E. Lechevallier, Service d’Urologie et de
Transplantation Rénale, Hôpital Salvator, 249, Bd. de Sainte Marguerite, BP. 51,
13274 Marseille Cedex 09.
e-mail : [email protected]
Ref : WALZ J., LECAMUS C., LECHEVALLIER E., BARRIOL D., BRE-
THEAU D., ALBERT P., HERMANOWICZ M., COULANGE C., Prog. Urol.,
2003, 13, 39-45
RESUME
Objectifs: Alors que les résultats de l’endopyélotomie pour sténose de la jonction
pyélo-urétérale (JPU) sont connus, notre but a été d’étudier les complications spéci-
fiques du traitement des sténoses de la JPU par le ballonnet Acucise®.
Matériel et Méthodes: De janvier 1994 à février 1999, 50 patients (40 femmes, 10
hommes) consécutifs ont été traités par endopyélotomie avec le ballonnet Acucise®‚
pour sténose de la JPU ont été revues. L’âge moyen a été de 47 ans (18-84 ans).
Trente-cinq sténoses (70%) étaient primitives. Dans 5 cas il existait un pédicule polai-
re diagnostiqué par l’angio-tomodensitométrie pré-opératoire. La technique a été
celle décrite par CHANDHOKE sauf dans 3 cas où une section avec orientation latérale
externe stricte a été réalisée.
Résultat: Les durées moyennes opératoires et d’hospitalisation ont été respectivement
70 min (35-180 min) et 5,4 jours (2-27 jours). On a rencontré en per-opératoire 6
(12%) incidents techniques (rupture du ballon: 3) et en péri-opératoire 7 (14%) inci-
dents hémorragiques (5 pédicules polaires). Il n’y a pas eu de conversion per-opéra-
toire en chirurgie ouverte. Il y a eu 4 (8%) complications péri-opératoires majeures,
toutes hémorragiques, qui ont nécessité 2 embolisations radiologiques et une lombo-
tomie. Seuls ces patients ont été transfusés (3,25 unités/patient). Quatorze complica-
tions infectieuses urinaires ont été notées dont 2 pyélonéphrites (4%) et une septicé-
mie (2%). Neuf patients ont eu un inconfort important dû à la sonde JJ. Avec un suivi
moyen de 47 mois, le succès global a été de 74%, non influencé par la survenue d’une
complication. Parmi les 12 patients avec un échec de l’endopyélotomie, 7 (58%)
patients avaient un pédicule polaire inférieur.
C o n c l u s i o n: L’endopyélotomie Acucise® est une technique simple et eff i c a c e .
Cependant sa morbidité hémorragique, souvent liée a un vaisseau polaire inférieur,
doit rendre son indication et sa réalisation prudentes.
Mots clés : Sténose, JPU, endopyélotomie, Acucise®, complication.

40
sé comme un traitement des sténoses primitives de la
JPU. Depuis, plusieurs techniques endoscopiques ont
été développées, notamment l’endopyélotomie par uré-
téroscopie à la lame froide, le bistouri électrique ou le
laser Holmium-YAG. CHANDHOKE [6] a décrit en 1993
la technique et les premiers résultats de l’endopyéloto-
mie rétrograde avec le ballonnet Acucise®.
L’endopyélotomie par le ballonnet Acucise®‚ est un
traitement moins invasif et plus rapide à réaliser que
l’endopyélotomie par urétéroscopie rétrograde. Il exis-
te cependant des complications liées à cette technique.
Le but de notre étude a été d’étudier les complications
spécifiques du traitement des sténoses de la JPU par le
ballonnet Acucise®.
MATERIEL ET METHODES
Pour cette étude rétrospective, les dossiers de 50
patients consécutifs, opérés dans deux services d’uro-
logie pour une sténose de la jonction pyélo-urétérale
par le ballonnet Acucise®, ont été revus. L’étude a
concerné les patients opéré de janvier 1994 à février
1999. Le suivi moyen a été de 47 mois (10-71 mois).
Parmi les 50 patients, 40 étaient des femmes (sexe ratio
4:1). L’âge moyen était 47 ans avec des extrêmes de
18-84 ans. Les symptômes de découverte figurent dans
le tableau I et les étiologies de la sténose, primitifs ou
secondaires, dans le tableau II. Le traitement initial des
sténoses secondaires figure dans le Tableau II. Tous les
patients ont eu une urographie intraveineuse préopéra-
toire, sans test au Furosémide. Une scintigraphie au
DTPA 99-Tec a été réalisée 2 fois. Une scintigraphie au
DMSA 99-Tec a été réalisée dans 8 cas, avec une fixa-
tion rénale globale après drainage de 39% en moyenne.
Les sténoses ont été classées selon 4 stades radiolo-
giques : stade 1 (2 cas/4%) dilatation du bassinet et
calices normaux, stade 2 (27 cas/54%) dilatation du
bassinet et des tiges calicielles, stade 3 (20 cas/40%)
dilatation bassinet et des tiges calicielles et du fond des
calices, et stade 4 (1 cas) mutité rénale. Pour la
recherche d’un pédicule vasculaire polaire inférieur
une angio-tomodensitométrie (TDM) rénale avec
reconstruction 3D a été réalisée dans 37 cas (74%).
Dans 5 cas (13,5%) parmi ces 37 un pédicule polaire
inférieur a été découvert. Une artériographie rénale a
été pratiquée chez 1 patient, sans avoir individualisé de
vaisseau polaire. Chez un patient la présence d’un tel
vaisseau était connu due à une pyéloplastie ouverte
avec décroisement d’un vaisseau polaire. Onze patients
n’ont pas eu d’exploration du système vasculaire rénal.
Au total un vaisseau polaire inférieur a été découvert
chez 6 (15%) patients parmi les 39 patients explorés.
Par ailleurs il y avait 3 insertions hautes de l’uretère, 2
malrotations et 5 reins avec des calculs pyéliques de 4
- 15mm de diamètre. Chez 25 patients il existait une
infection urinaire identifiée sur un examen cytobacté-
riologique des urines (ECBU). Toutes ont été traitées
par des antibiotiques de façon à obtenir une stérilité des
urines en période opératoire. Tous les patients ont été
préparés avec une endo-prothèse urétérale type sonde
JJ pendant 37 jours en moyenne avant l’intervention.
Le ballonnet Acucise®‚ est un ballon de 8 mm de dia-
mètre à basse pression (max. 1 Atm.), sur lequel une
électrode de section de 150 microns de large et de 3 cm
de long est montée. L’endopyélotomie avec le ballon-
net Acucise® a éun fil guide est monté dans le bassinet
du rein; sur ce guide le cathéter Acucise® est monté et
positionné au niveau de la sténose après une pyélogra-
phie; le cathéter est positionné de façon que l’électrode
prenne une orientation postéro-latérale; le ballonnet est
gonflé à 2 ml avec du produit de contraste; la sténose
est visible par une empreinte sur le ballonnet; la section
est réalisée en section pure de 75 Watts pendant 1 à 5
secondes; l’empreinte disparaît et, après dégonflage du
ballonnet, l’incision transmurale et vérifiée par une
extravasation de produit de contraste au niveau de la
section pendant une pyélographie; le ballonnet est
regonflé pour obtenir une hémostase pendant 5-10 min
et une sonde uréthrale JJ est montée sur le guide après
ablation du cathéter Acucise®. L’intervention s’achève
par la mise en place d’une sonde vésicale. Dans trois
cas, une section externe stricte a été réalisée. La voie
rétrograde a été choisie dans 47 cas (94%) et la voie
antérograde en association avec une néphro-lithotomie
percutanée dans 3 cas (6%).
Une antibioprophylaxie par une céphalosporine de 2ème
génération a été faite chez tous les patients. En postopé-
ratoire les patients ont gardé une sonde vésicale pendant
24 h à 48 h et une sonde urétérale JJ pendant au minimum
4 semaines. Les patients ont été revues 1 mois après abla-
tion de la sonde JJ, puis à 3 mois, puis tous les 6 mois
J. Walz et coll., Progrès en Urologie (2003), 13, 39-45
Tableau I. Symptômes de découverte du syndrôme de la JPU.
Symptômes de découverte nombre des cas
Fortuite 3 (6%)
Pyélonéphrite 17 (34%)
Lombalgie chronique 16 (32%)
Coliques néphrétiques 12 (24%)
Douleur abdominale aiguë 2 (4%)
Tableau II. Etiologies de la sténose.
Etiologie de la sténose nombre des cas recul
Primitive 35 (70%)
Secondaire 15 (30%) moyenne : 7 ans
(2 mois-16 ans)
dont : Pyéloplastie 12 moyenne : 6,6 ans
Pyélotomie 114 ans
Endopyélotomie 11 ans
Néphrectomie partielle 110 ans

pendant 2 ans et puis annuellement. Une urographie
intraveineuse sans test au furosémide et une échographie
rénale ont été effectuées chez 24 patients 1 mois après
ablation de la sonde JJ. Chez 16 patients ces examens ont
été réalisés après 3 mois, et chez 4 patients après 5 mois.
Chez deux patient perdus de vue, les examens ont été réa-
lisés après plus de 2 ans, soit un total de 46 patients chez
qui une UIV et échographie rénale ont été réalisées. Une
scintigraphie au DTPA 99-Tec a été effectuée dans 4 cas.
Le résultat objectif de l’endopyélotomie a été appréciée
par les critères urographiques suivants : absence de
retard sécrétoire, amélioration du drainage des cavités
pyélo-calicielles, absence de sténose urétérale, visuali-
sation de l’uretère pelvien à 10 min et la réduction de
l’hydronéphrose. Comme critère subjectif une améliora-
tion symptomatique des douleurs de plus de 50% a été
considérée comme succès. Le résultat a été considéré
comme bon en cas de disparition des douleurs et du syn-
drome obstructif. Un résultat moyennement satisfaisant
a été obtenu en cas de diminution des douleurs de plus
de 50% et/ou si un certain degré d’obstruction persistait.
Il était conclu à un échec en cas d’une persistance des
douleurs à un niveau supérieur à 50% et/ou une persis-
tance d’un symptôme obstructif franc.
L’analyse statistique a été réalisée par le test Fischer
avec un seuil de significativité de p<0,05. Il n’y a pas
eu d’analyse multivariée.
RESULTATS
La durée moyenne d’hospitalisation a été 5,4 jours (2-
27 jours). Chez les patients ayant eu une complication
elle a été de 12 jours (7-27 jours). La durée opératoire
a été en moyenne de 70 min (35-180 min). En diffé-
renciant les deux voies d’abord, la voie rétrograde (47
cas) a duré 64 min (35-120 min) et la voie antérograde
combinée (3 cas) avec une néphro-lithotomie percuta-
née 167 min (120-180 min). Il n’y a pas eu de diffé-
rence significative entre les sténoses primitives et les
sténoses secondaires concernant la durée de l’interven-
tion.
Les complications per-opératoires ont été de 2 types:
des hémorragies et des difficultés techniques dues au
ballonnet Acucise®. Les complications hémorragiques
ont été rencontrées dans 6 cas (12%), elles figurent
dans le tableau III. Chez 5 de ces patients un pédicule
polaire inférieur était présent, dont 3 pédicules connus
et 2 découverts à l’occasion de la complication. Une
variation de la technique classique comme une section
externe stricte (1 cas), une section à répétition (1 cas)
et la combinaison de ces deux sections (1 cas) ont pro-
voqué des hémorragies. Les difficultés techniques dues
au ballonnet Acucise® ont été rapportées dans 6 cas,
elles sont précisés dans le Tableau IV. Ces difficultés
ont provoqué dans 3 cas (6%) des hémorragies, deux
fois liées à une rupture du ballonnet, probablement due
41
Tableau III. Complications hémorragiques per- et post-opératoires.
Patient pédicule polairetransfusion problème technique particularité intervention résultat
complémentaire
1antérieur non non section externe stricte non échec
2postérieur 2 US en non section répétée, non bon
post-opératoire section externe stricte
3postérieur 4 US en non non décaillotage, échec
post-opératoire artériographie J7
avec émbolisation
42 pédicules antérieurs non défectuosité du section répétée non échec
ballonnet
5non non rupture du ballonnet non non bon
6antérieur 4 US en rupture du ballonnet NLPC artériographie J19 échec
post-opértoire avec embolisation
7non 3 US en non hémorragie post- lombotomie à J2 bon
post-opératoire opératoire, valve pour évacuation
mitrale artificielle d'un hématome,
découvert par TDM
U.S. : unité sanguine, NLPC : néphrolithotomie percutanée associée.
Tableau IV. Complications dues au ballonnet (6 cas (12%)
Type de Complication nombre des cas
-Fuite du ballonnet 1 cas (2%)
-Défectuosité du ballonnet 2 cas (4%) dont une hémorragie
-Rupture du ballonnet 3 cas (6%) dont 2 hémorragies
J. Walz et coll., Progrès en Urologie (2003), 13, 39-45

à un excès d’insufflation, et une fois à un ballonnet
défectueux. Dans ce cas, après la section initiale, le bal-
lonnet a gardé une empreinte ressemblant à une persis-
tance d’une sténose, provoquant une section à répéti-
tion avec une hématurie importante et caillotage des
cavités rénales. Les hématuries importantes en per-opé-
ratoire ont été traitées par une mise en place d’une
sonde urétérale charrière 8. Elle a été changée par une
sonde JJ Ch 9 à l’arrêt de l’hématurie. Aucune conver-
sion en chirurgie ouverte en per-opératoire n’a été réa-
lisée.
Chez 4 patients (8%) il y a eu des complications post-
opératoires sévères, correspondant à des hémorragies
nécessitant une transfusion entre 2 et 4 unités sanguines
(3,25 en moyenne). Dans 3 cas les complications ont
débuté en per-opératoire. Dans un cas la complication
s’est manifestée en post-opératoire. Suite à la persis-
tance de l’hématurie avec une déglobulisation à moins
de 10g hémoglobine par décilitre, une embolisation
d’un vaisseau polaire inférieur lors d’une artériogra-
phie rénale a été nécessaire chez 2 patients. Chez une
patiente, ayant une valve mitrale artificielle sous anti-
coagulation à dose thérapeutique, une TDM abdomina-
le a été réalisée suite a une chute tensionnelle et une
déglobulisation. Un hématome peri-rénal important a
été découvert chez cette patiente et a nécessité une éva-
cuation chirurgicale par lombotomie, sans avoir mis en
évidence une lésion vasculaire. Chez 1 autre de ces 4
patients un hématome peri-rénal a été découvert pen-
dant des examens réalisés à cause de l’hématurie, sans
conséquence thérapeutique.
Pour le drainage postopératoire une sonde JJ Ch. 6-10
a été utilisée dans 22 cas, une sonde Ch. 9 dans 21 cas,
Ch. 7 ou 8 dans 6 cas et Ch. 7-12 dans un cas. Le drai-
nage a été en moyenne de 41 jours (28-63 jours) et res-
ponsable chez 20 patients (40%) des complications sui-
vantes : des douleurs inhérentes à la sonde JJ dans 9 cas
(18%) et des infections dans 14 cas (28%), dont 11 cys-
tites banales, 1 septicémie à Bacille gram négatif et 2
pyélonéphrites (4%). Les infections urinaires ont été
diagnostiquées par un examen cytobactériologique uri-
naire de contrôle. Un lien avec une infection urinaire en
pré-opératoire n’a pas été trouvé. Le patient ayant eu la
septicémie et une patiente avec une pyélonéphrite
avaient eu des complications hémorragiques en per-
opératoire. Aucun retrait prématuré (avant 28 jours) ou
changement de la sonde JJ n’a été nécessaire.
Le recul post-opératoire moyen a été 47,1 mois (10-71
mois). Quatre patients ont été perdus de vue après
l’ablation de la sonde JJ. Un succès global de l’endo-
pyélotomie a été obtenu chez 34 patients (74%). Un
bon résultat a été obtenu dans 25 cas (54%), un résul-
tat moyennement satisfaisant dans 9 cas (20%) et un
échec dans 12 cas (26%).
En analyse univariée, les résultats ont été indépendants
du sexe, de l’âge, de l’étiologie de la sténose (primiti-
ve ou secondaire), du stade radiologique, de la durée du
drainage (plus ou moins de 6 semaines), d’une infec-
tion urinaire en post-opératoire, des particularités
découvertes en pré-opératoire (insertion haute, malro-
tation, calculs rénaux) et d’une présence de complica-
tion per- ou post-opératoire.
Les particularités des 12 échecs sont rapportées dans le
Tableau V. Parmi les 12 échecs 7 (58%) avaient un
vaisseau polaire inférieur. Comme traitement après
échec, chez 3 des 5 patients sans vaisseau polaire infé-
rieur une nouvelle endopyélotomie a été réalisée avec
succès à 6 mois. Chez 6 patients, dont 4 avec un pédi-
cule polaire inférieur, une pyéloplastie par chirurgie
ouverte a été réalisée avec des bons résultats. Une
patiente a subi une pyélo-lithotomie avec urétérolyse
avec succès. Une patiente a été traitée par des sondes JJ
à demeure et un patient a été perdu de vue.
DISCUSSION
Le traitement de référence des sténoses de la jonction
pyélo-urétérale (JPU) est la résection-anastomose par
lombotomie, avec un taux de succès de 95% [13]. Les
alternatives sont l’endopyélotomie ou la résection-ana-
stomose laparoscopique. La laparoscopie permet des
résultats comparables à ceux de la chirurgie ouverte en
étant moins invasive [12]. Elle a les désavantages
d’une durée opératoire plus longue et de nécessiter un
apprentissage spécifique. Encore moins invasif est
l’endopyélotomie soit par urétéroscopie soit par le bal-
lonnet Acucise®, avec les avantages d’une durée d’in-
tervention et d’hospitalisation moins longues et d’une
reprise des activités quotidiennes plus rapide [10]. Le
42
Tableau V.Particularité associée aux échecs (12 patients).
Echec vaisseau polaire inférieur.sténosefiliforme malrotationrénale fibrose peri-urétérale sans particularité
1retropyélique / / oui /
1 / oui /oui /
1rétropyélique /oui / /
1antérieur oui ///
1rétropyélique ////
3antérieur ////
4////oui
J. Walz et coll., Progrès en Urologie (2003), 13, 39-45

taux de succès est de 70% à 95%. Il est inférieur à celui
de la chirurgie classique [1, 6, 7, 9, 15, 16, 22].
Toutefois, le fait que l’endopyélotomie ait des résultats
satisfaisants et qu’elle soit moins invasive permet de la
proposer comme traitement de première intention
d’une sténose de la JPU [11]. Le but de notre étude
n’était pas d’évaluer les résultats de l’endopyélotomie
Acucise®, déjà publiés [15], mais d’en préciser les
complications.
Les complications survenant avec le ballonnet
Acucise®‚ sont surtout des complications hémorra-
giques qui varient selon les auteurs de 0 à 17% [1, 6, 9,
22] et sont retrouvées dans 14% des cas dans notre
série. Pour la technique de l’endopyélotomie antéro-
grade en combinaison avec une néphro-lithotomie per-
cutanée le taux d’accident hémorragique est de 1 à
13% [3, 4, 16, 18], mais il faut tenir compte du passa-
ge trans-parenchymateux du rein pour cette voie
d’abord. La technique par urétéroscopie rétrograde
avec endopyélotomie par laser, lame froide ou bistouri
électrique a un taux de complications hémorragiques
de 3 à 16% [5, 7, 10, 16]. Le taux d’accident hémorra-
gique pour l’endopyélotomie avec le ballonnet
Acucise® semble donc équivalent à celui des autres
techniques endoscopique. Cette hémorragie est dans la
plupart des cas liée à une lésion d’un vaisseau polaire
inférieur croisant la jonction pyélo-urétérale. Le risque
de lésion d’un vaisseau est évident lorsque l’incision
trans-murale est réalisée de façon aveugle. Pour cette
raison une recherche pré-opératoire des éventuels pédi-
cules polaires est indispensable pour apprécier les rap-
ports de la jonction pyélo-urétérale. L’artériographie
rénale est l’examen de référence mais cet examen est
invasif et coûteux. L’angio-TDM rénale hélicoïdale est
moins coûteuse et fiable dans l’évaluation des pédi-
cules polaires [19, 23]. Les inconvénients sont la
détection seulement des vaisseaux de calibre supérieur
à 2mm [7, 23] et la nécessitée d’une synchronisation
précise de l’injection du produit de contraste pendant
l’acquisition des clichés. CONLIN et BAGLEY [7] ont
proposé une échographie endo-urétérale, permettant
l’imagerie en temps réel de l’anatomie péri-urétérale
en visualisant les artères et les veines; les désavantages
de cet examen sont le prix, l’apprentissage difficile et
la durée prolongée de l’intervention. L’incidence d’un
vaisseau polaire inférieur est plus élevée chez les
patients ayant une sténose de la jonction, selon VAN
CANGH [26] dans 39% des cas et selon CASSIS [4] dans
32% des cas. Dans notre série 13% des cas avaient un
vaisseau polaire. Selon SAMPAIO et FAVORITO[20] un
rapport étroit entre un vaisseau polaire et le système
collecteur existe avec la face antérieure dans 65,1%
des cas et dans 6,2% des cas avec la face postérieure.
SAMPAIO a recommandé une incision latérale externe
stricte comme meilleur moyen pour éviter une lésion
vasculaire. Pour éviter une lésion parenchymateuse du
pôle inférieur du rein pendant une incision latérale
LECHEVALLIER [15] recommande une incision classique
postéro-latérale. Concernant les vaisseaux polaires
l’endopyélotomie par l’urétéroscopie rétrograde a
l’avantage d’effectuer l’incision sous contrôle de la vue
[10] avec un meilleur contrôle de l’orientation de l’in-
cision, la distinction des différents tissus et la possibi-
lité d’arrêter l’incision avant la lésion d’un vaisseau
polaire.
Comme complications liées au ballonnet Acucise®,
McGUIRE et ENGLISH [17] ont décrit deux empreintes
dues à une défectuosité ressemblant à un cas de notre
série. Les fuites du ballonnet (1 cas) et la rupture du
ballonnet (3 cas) ne sont pas rapportées et pourraient
être dues à un excès d’insufflation du ballonnet. Des
complications infectieuses importantes sont rapportées
dans quelques cas isolés [4]. KEHINDE [14] a rapporté
des infections urinaires après mise en place d’une
sonde JJ dans 24% des cas chez la femme et dans 14%
des cas chez l’homme.
Concernant les autres complications, on retrouve dans
la littérature le remplacement de l’endoprothèse JJ en
péri-opératoire dans 3 à 17% [6, 18, 22] des cas, alors
que cela n’a pas été nécessaire dans notre série. Des
extravasations et des urinomes péripyéliques ont été
décrits entre 2 et 4% des cas [9, 16, 22]. Parmi les com-
plications rares ont également été rapportées des avul-
sions de la jonction [9] ou de l’uretère distal [3] et une
invagination urétérale [8]. Une complication liée à l’in-
tervention même est la sténose de l’uretère décrite dans
1 à 3% des cas [3, 9, 18]. Le risque d’une sténose après
une intervention endourologique peut être diminuée
par une préparation de l’uretère par une sonde JJ une à
deux semaines avant l’intervention [25], comme réali-
sée dans notre série. A noter qu’une endopyélotomie
par urétéroscopie rétrograde peut également provoquer
une sténose urétérale dans 0 à 21% des cas [5, 7, 10,
16].
Le taux de succès de l’endopyélotomie par le ballonnet
Acucise®‚ se situe entre 70 à 87,5% [1, 6, 9, 15, 22]
des cas et dans notre série il a été de 74%. La morbidi-
té per- ou peri-opératoire n’a pas influencé le résultat
de l’endopyélotomie Acucise®. Chez 58% des patients
avec un échec et chez 71% avec une hémorragie
majeure un vaisseau polaire inférieur était présent. La
diminution du taux de succès est rapportée par STEPHEN
et NAKADA qui retrouve un résultat satisfaisant dans
62% des cas en présence d’un vaisseau polaire [24].
L’endopyélotomie nous semble contrindiquée en pré-
sence d’un vaisseau polaire inférieur postérieur. Car le
risque de saignement est augmenté et les résultats sont
moins bons. A notre avis une exploration par angio-
indispensable pour toutes les techniques de l’endopyé-
lotomie pour identifier la présence d’un tel pédicule.
Concernant l’orientation de l’incision nous préférons
une incision classique postéro-latérale pour éviter une
43
J. Walz et coll., Progrès en Urologie (2003), 13, 39-45
 6
6
 7
7
1
/
7
100%