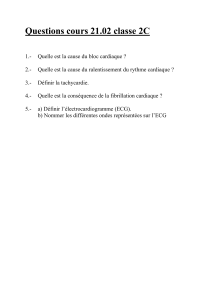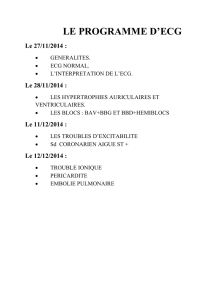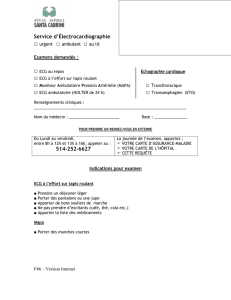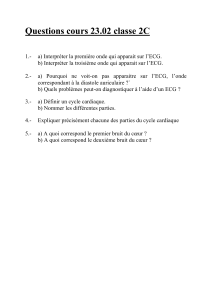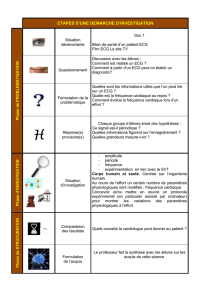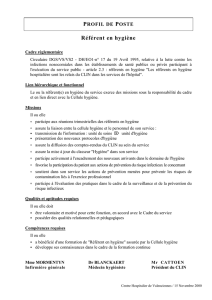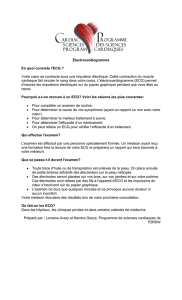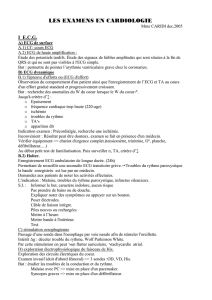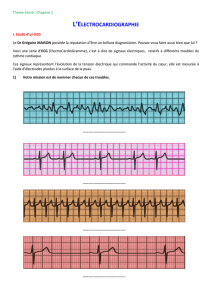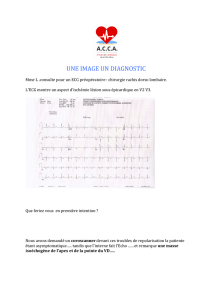Lire la suite…

15
N° 22 JANVIER-FÉVRIER 2010
À propos des recommandations
L
a question de la pratique sportive
chez les enfants et les adultes por-
teurs de cardiopathies congénitales est
fréquente. Le cardiologue et le cardio-
pédiatre en particulier y sont confron-
tés quotidiennement. Nous sommes
parfois étonnés de voir la place appa-
rente du sport dans les familles
lorsqu’une cardiopathie congénitale
(CC) est découverte, quelquefois même
avant la naissance de l’enfant. La ques-
tion : « Pourra-t-il (ou pourra-t-elle) faire
du sport ? » devance quelquefois les
questions sur la gravité de la cardiopa-
thie, sa correction possible, la nécessité
d’une ou plusieurs interventions, sur les
éventuelles souffrances à venir, sur le
risque vital. L’enfant à naître ou déjà né
est porteur d’un projet incluant des
capacités physiques au moins normales,
ce qui est finalement compréhensible.
La peur du handicap s’exprime sans
doute par ce « raccourci » : « Pourra-t-
il (elle) faire du sport ?».
Certaines cardiopathies sont décou-
vertes à l’occasion de l’exploration d’un
souffle lors d’une demande de certifi-
cat médical de non contre-indication
à la pratique sportive.
Enfin, les immenses progrès réalisés
dans le domaine du traitement des CC
ont permis à une population de
patients adultes porteurs de cardiopa-
thies congénitales, opérées ou non, de
mener une vie quasi normale, faisant
espérer une pratique sportive.
Lors de la rédaction d’un certificat de
non contre-indication à la pratique
sportive, le médecin devra connaître les
risques réels ou l’absence de risque
pour le cas particulier du patient et du
sport en question. Il devra rester objec-
tif face aux attitudes excessivement res-
trictives ou permissives du patient, ou
de l’enfant et de ses parents. Les
craintes de syncope ou de mort subite
de certains parents, parfois inappro-
priées, contrastent avec une négation
de la cardiopathie et de ses risques par
tel autre patient ou telle autre famille.
■ Les effets bénéfiques de la pra-
tique sportive (en excluant les dérives
régulièrement d’actualité) ne sont plus
à prouver. Ces bénéfices sont encore
plus importants pour la majorité des
patients porteurs de CC.
L’entraînement physique permet
d’améliorer la consommation d’oxygène
et donc de soulager le travail cardiaque.
P. Dehant, E. Bogino, M. Jimenez
Clinique Saint-Augustin, Bordeaux
Pratique du sport
et cardiopathies congénitales
Tableau 1
Classification des sports
(adaptée et modifiée d’après Mitchell
et al.
(3) ).
a : Danger de collision corporelle,
b : Risque accru si une syncope survient.
Les sollicitations cardiovasculaires les plus basses (débit cardiaque et PA) sont représentées en vert et les plus élevées en rouge. Les couleurs
bleu, jaune et orange correspondent respectivement à des sollicitations cardiovasculaires moyenne basse, moyenne et moyenne haute.
Dynamique faible
ADynamique moyenne
BDynamique forte
C
Statique
faible
I
Billard
Bowling, curling
Golf
Tir (armes à feu)
Cricket
Escrime
Tennis de table
Tennis (en double)
Baseballa
Volleyball
Badminton
Course d’orientation
Course de fond (marathon)
Marche athlétique
Ski de fond (classique)
Hockey sur gazona
Squasha
Statique
moyenne
II
Course autoa,b
Plongée scaphandreb
Sports équestresa,b
Courses motoa,b
Gymnastiquea
Voile
Tir à l’arc
Plongeona,b
Sauts (athlétisme)
Patinage artistiquea
Course de sprint
Football américaina
Rugbya
Footballa
Surfa,b
Basketballa
Biathlon
Hockey sur glacea
Ski de fond
(skating technique)
Course de demi-fond
Natation
Tennis (en simple)
Handballa
Statique
forte
III
Bobsleigh/lugea,b
Lancers (athlétisme)
Escalade sportivea,b
Ski nautiquea,b
Haltérophiliea
Planche à voilea,b
Arts martiaux (judo,karaté)a
Body buildinga
Ski de descentea,b
Luttea
Snowboarda,b
Skateboard
Boxea
Canoë/kayak
Cyclismea,b
Décathlon
Aviron
Patinage de vitesse
Triathlona,b

Les facteurs de risque (HTA, surcharge
pondérale, troubles des métabolismes lipi-
dique et glucidique) sont mieux contrô-
lés. Enfin, la pratique sportive adaptée,
même partielle, évite aux enfants la mar-
ginalisation d’une dispense, souvent abu-
sive, des activités physiques et sportives
scolaires. De plus, l’autorisation, voire
l’encouragement par le médecin de la pra-
tique sportive, permet de lever l’angoisse
des enfants et surtout des parents vis-à-
vis des risques de l’activité physique et
d’éviter une éventuelle surprotection de
l’enfant. Il est quelquefois nécessaire
d’intervenir auprès de l’encadrement sco-
laire pour permettre l’intégration adap-
tée de l’enfant aux activités sportives.
Si l’autorisation à la participation aux
activités physiques et sportives dans le
cadre scolaire ou du loisir pose en géné-
ral moins de problèmes que l’auto-
risation de la pratique du sport en com-
pétition, elle doit néanmoins être déli-
vrée par un médecin connaissant par-
ticulièrement le patient et les recom-
mandations détaillées ci-dessous.
■ Des recommandations(1, 2) existent
pour nous aider dans nos conseils et
nos décisions.
➜La classification des sports de Mit-
chell(3), bien qu’imparfaite, modifiée à
plusieurs reprises, avec des sports sus-
ceptibles de changer de catégorie en
fonction du poste occupé dans l’équipe
ou de la sous-spécialité éventuelle,
constitue cependant une aide précieuse
au quotidien (Tableau 1 p. 15). Elle est
basée sur les niveaux statiques et dyna-
miques maximaux atteints en compé-
tition. Il faut cependant noter que des
niveaux plus élevés peuvent être atteints
durant l’entraînement. Le niveau de la
composante dynamique est défini en
termes de pourcentage estimé de
consommation maximum d’oxygène
atteinte et donc d’augmentation de débit
cardiaque. Le niveau de la composante
statique est en relation avec le pourcen-
tage de contraction volontaire maximale
(MVC) atteint et s’exprime donc en
termes d’augmentation de la pression
artérielle.
Les sollicitations cardiovasculaires les
plus basses (débit cardiaque et PA) sont
représentées en vert et les plus élevées
en rouge. Les couleurs bleu, jaune et
orange correspondent respectivement
à des sollicitations cardiovasculaires
moyenne basse, moyenne et moyenne
haute.
➜Les recommandations euro-
péennes et nord-américaines sont
assez comparables. Nous avons choisi
la présentation des recommandations
européennes (Tableau 2), plus faciles
à utiliser, établies en fonction des car-
diopathies opérées ou non permettant
une activité sportive sans restriction,
avec restrictions partielles, ou repré-
sentant une contre-indication absolue
à la pratique sportive.
Ces recommandations appellent
plusieurs commentaires :
- elles sont destinées à fournir des
conseils de base au médecin sollicité
pour autoriser la pratique d’un sport
en compétition à des patients porteurs
de CC. La pratique du sport en com-
pétition sous-entend la notion
d’entraînement en vue d’améliorer les
performances et de recherche de
dépassement de soi-même lors de la
compétition, c’est-à-dire de sollicita-
tion des capacités physiques, donc car-
diovasculaires, à la limite des possibi-
lités, dans un contexte de stress mental
lié à la compétition ;
- de ce fait, un certain nombre de CC,
opérées ou non, sont incompatibles
avec le sport en compétition, du fait
de la complexité des lésions anato-
miques, de la limitation des perfor-
mances ventriculaires et du risque de
survenue de troubles rythmiques. Il
s’agit du syndrome d’Eisenmenger, de
l’hypertension artérielle pulmonaire,
des cœurs univentriculaires, des ano-
malies coronaires congénitales, de
l’anomalie d’Ebstein (Fig. 1), des sté-
noses aortiques critiques, de la dou-
N° 22 JANVIER-FÉVRIER 2010
16
À propos des recommandations
Figure 1
©DR
Anomalie d’Ebstein (forme moyenne) contre-indiquant toute pratique sportive en compétition.
L’autorisation, voire l’encouragement par le médecin
de la pratique sportive, permet de lever l’angoisse
des enfants et surtout des parents vis-à-vis des risques
de l’activité physique et d’éviter une éventuelle
surprotection de l’enfant.

Tableau 2
17
N° 22 JANVIER-FÉVRIER 2010
Anomalie Evaluation Critères Recommandation Suivi
CIA
(fermée ou petite,
non opérée) et FOP
Hist.Clin., classe NYHA,
Ex.Clin., Echo, Rx, EE
Orifice < 6mm, ou 6 mois après
fermeture avec PAP normale,
arythmie = 0,
dysfonction ventriculaire = 0
Tous sports.
Si FOP, discussion de
fermeture avant plongée
régulière avec bouteilles
Annuel
CIV
(fermée ou petite,
non opérée)
Hist.Clin., classe NYHA,
Ex.Clin., ECG, Echo,
Rx, EE
Orifice restrictif
(gradient VG-VD > 64mmHg) ou 6
mois après fermeture, PAP normale
Tous sports Annuel
CAV
Hist.Clin., classe NYHA,
Ex.Clin., ECG, Echo,
Rx, EE
Pas ou peu de régurgitation
valvulaire, pas de sténose sous-
aortique, arythmie = 0,
VO²max normale
Tous sports
Annuel.
Réévaluation
complète tous
les 2 ans
RVPA
partiel ou total
Hist.Clin., classe NYHA,
Ex.Clin., ECG, Echo,
Rx, EE, IRM
Pas d’obstruction veineuse
pulmonaire, PAP normale,
pas d’arythmie d’effort
Tous sports Annuel
Canal artériel opéré
Hist.Clin., classe NYHA,
Ex.Clin., ECG, Echo,
Rx, EE
6 mois après fermeture,
PAP normale Tous sports Non
nécessaire
Sténose pulmonaire
(peu serrée,
opérée ou non)
Hist.Clin., classe NYHA,
Ex.Clin., ECG, Echo,
Rx, EE
Native ou 6 mois après fermeture,
gradient max transvalvulaire
< 30mmHg, VD normal,
ECG normal ou HVD modérée,
arythmie = 0
Tous sports Annuel
Sténose pulmonaire
(moyennement serrée,
opérée ou non)
Hist.Clin., classe NYHA,
Ex.Clin., ECG, Echo,
Rx, EE
Native ou 6 mois après fermeture,
gradient max transvalvulaire
entre 30 et 50 mmHg, VD normal,
ECG normal ou HVD modérée,
arythmie = 0
I A, I B Tous les
6 mois
Coarctation aortique
(native ou corrigée)
Hist.Clin., classe NYHA,
Ex.Clin., ECG, Echo,
Rx, EE, IRM
HTA = 0,
gradient TA bras-jambe < 21mmHg,
TA max pendant EE < 231mmHg,
pas d’ischémie à l’ECG, pas d’HVG
I A, I B, II A, II B.
Si interposition d’un tube,
éviter les sports avec
risque de collision
Annuel.
Réévaluation
complète tous
les 2 ans
Sténose aortique
(modérée)
Hist.Clin., classe NYHA,
Ex.Clin., ECG, Echo,
Rx, EE
Gradient moyen < 21mmHg,
arythmie = 0, syncope = 0,
dyspnée = 0, angor = 0
Tous sports sauf III C Annuel
Sténose aortique
(moyenne)
Hist.Clin., classe NYHA,
Ex.Clin., ECG, Echo,
Rx, EE, Holter ECG
Gradient moyen
entre 21 et 49 mmHg,
arythmie = 0, syncope = 0,
dyspnée = 0, angor = 0
I A Tous les
6 mois
Tétralogie
de Fallot
Hist.Clin., classe NYHA,
Ex.Clin., ECG, Echo,
Rx, EE, Holter ECG,
IRM
Peu ou pas d’obstruction droite,
pas ou peu de régurgitation
valvulaire pulmonaire,
fonction biventriculaire normale
ou sub normale, arythmie = 0
I A, I B, II A, II B
Annuel.
Réévaluation
complète tous
les 2 ans
Lésion résiduelle moyenne avec
pression VD < 50% de pression VG,
ou CIV résiduelle, ou régurgitation
pulmonaire moyenne, mais
fonction biventriculaire normale
I A.
Si interposition d’un tube,
éviter les sports avec
risque de collision
Annuel.
Réévaluation
complète tous
les 2 ans
Transposition
des gros vaisseaux
(switch artériel)
Hist.Clin., classe NYHA,
Ex.Clin., ECG, Echo,
Rx, EE
Pas ou peu d’insuffisance aortique,
pas de sténose pulmonaire signifi-
cative, arythmie et ischémie = 0
au test d’effort. Coronarographie
ou scanner coronaire normal(e)
dans l’enfance
Tous sports sauf III C Annuel
Recommandations pour la participation aux sports de compétition pour les sportifs porteurs de cardiopathie congénitale.
Hist.Clin. : histoire clinique ; Ex.Clin. : examen clinique ; ECG : électrocardiogramme 12 dérivations ; Echo : échocardiographie-Doppler ;
Rx : radiographie de thorax ; EE : ECG d’effort. Le suivi inclut : interrogatoire, classe NYHA, Ex.Clin., ECG, et écho.

N° 22 JANVIER-FÉVRIER 2010
18
À propos des recommandations
ble discordance et des transpositions des
gros vaisseaux corrigées par les interven-
tions de Mustard, Senning ou Rastelli ;
- rappelons que les CC les plus fré-
quemment associées avec la mort subite
pendant la pratique sportive sont la
myocardiopathie hypertrophique, les
anomalies coronariennes, le syndrome
de Marfan et les sténoses aortiques.
■ Certains éléments déterminants
méritent d’être rappelés
➜ Les troubles du rythme
La survenue de troubles du rythme
chez les patients avec CC est un pro-
blème fréquent, en particulier dans la
population des congénitaux adultes.
Les patients ayant bénéficié d’une chi-
rurgie avec incisions auriculaire et/ou
ventriculaire sont à risque majoré
d’arythmie et de dysfonction ventricu-
laire du fait des cicatrices myocar-
diques.
➜ La fonction ventriculaire
La dysfonction ventriculaire, droite ou
gauche, du fait des arythmies d’effort
potentiellement inductibles, est une
contre-indication à la pratique de
sport de compétition.
➜ Les pressions pulmonaires
Les shunts gauche-droit, corrigés ou
non, peuvent ou ont pu élever les
pressions pulmonaires et modifier les
résistances artérielles pulmonaires.
En cas de doute sur leur niveau, une
évaluation à l’effort est nécessaire.
Une élévation de la pression artérielle
pulmonaire systolique au cours des
efforts de moins de 35 mmHg ne
semble pas faire prendre de risque.
➜ Les valvulopathies
Qu’elles soient sténosantes ou régur-
gitantes, les valvulopathies congéni-
tales (Fig. 2) ou résiduelles après chi-
rurgie doivent être évaluées au repos
et à l’effort et des recommandations
spécifiques existent à leur propos(4).
Figure 2
©DR
A et B : incidences parasternales grand axe
et petit axe d’une bicuspidie aortique avec 2 raphés.
C : Enregistrement en Doppler continu
par voie apicale du gradient moyen de la sténose
(24 mmHg), ne permettant que la pratique des
sports de type I A de la classification de Mitchell.
AB
C

19
N° 22 JANVIER-FÉVRIER 2010
➜ Les prothèses valvulaires et les
conduits prothétiques
Les patients avec prothèse valvulaire
mécanique et traitement anticoagulant
ainsi que les patients porteurs de
conduits prothétiques doivent éviter
de pratiquer les sports à risque de col-
lision.
➜ Le statut fonctionnel
Seuls les patients en classe fonction-
nelle 1 de la NYHA peuvent pratiquer
sans restriction les sports de compéti-
tion.
➜ La réponse tensionnelle à l’effort
Une chute tensionnelle à l’effort chez
un patient porteur de sténose aortique
nécessite d’autres investigations. Une
élévation tensionnelle anormale à
l’effort chez un patient opéré d’une
coarctation aortique est possible, mais
son pronostic n’est pas connu.
■ Deux points essentiels doivent être
observés
➜ Le premier est la nécessité d’une
évaluation documentée
Celle-ci comportera :
- une histoire complète de la maladie
avec connaissance des éventuels
comptes-rendus opératoires et des pré-
cédentes évaluations ;
- un interrogatoire rigoureux sur le sta-
tut fonctionnel et les aspects spécifiques
de la pratique, des entraînements et des
compétitions du sport en question ;
- un examen clinique ;
- un ECG ;
- un cliché radiologique ;
- une échographie-Doppler cardiaque
avec évaluation des pressions pulmo-
naires et des fonctions ventriculaire
gauche et droite ;
- un test d’effort maximal avec ECG,
mesure de TA et si possible mesure de
la VO²max.
Dans certains cas, d’autres investi-
gations sont requises :
- enregistrement Holter en cas de
recherche de trouble rythmique ;
- scanner pour l’étude des vaisseaux de
la base incomplètement appréhendés
par l’échographie ;
- IRM pour l’évaluation de la fonction
et du volume du ventricule droit ;
- échographie d’effort pour évaluer les
pressions pulmonaires dans certaines
cardiopathies opérées ou non.
Cette évaluation est nécessaire à
l’utilisation du Tableau 2 (p. 17) avant
l’autorisation de la pratique du sport
en compétition.
➜ Le second est le suivi et la rééva-
luation périodique de ces patients
Le suivi doit intervenir dans les 6 mois
ou un an après la première autorisa-
tion et, compte tenu de l’évolution pos-
sible ou attendue de la CC, être renou-
velé annuellement dans la plupart des
cas, avec des réévaluations complètes
plus ou moins espacées.
En conclusion, les bénéfices de l’activité
physique, voire sportive, sur la santé phy-
sique et mentale des patients porteurs
de CC sont évidents. De ce fait, seuls les
patients dont l’activité physique pourrait
aggraver la pathologie ou induire des
troubles rythmiques potentiellement dan-
gereux doivent être écartés de la pratique
sportive.
Néanmoins, malgré l’aide apportée par
les recommandations, les cardiopédia-
tres connaissent bien les multiples asso-
ciations, variétés anatomiques et cli-
niques des CC, opérées ou non, et la
variabilité de leur retentissement et de
leurs complications.
Ils sont donc les mieux formés pour don-
ner les conseils adaptés à chaque patient
et délivrer les autorisations de pratique
sportive, en particulier en compétition,
qui s’appuieront toujours sur une évalua-
tion rigoureuse.
Ces conseils et autorisations, voire res-
trictions, peuvent varier au fil du temps,
dans un sens ou dans un autre, du fait de
l’évolution de la CC ou des interventions
réalisées. La réévaluation périodique est
donc indispensable. ■
RÉFÉRENCES
1 • Graham TP Jr, Driscoll DJ, Gersonny WM, Newburger JW, Rocchini A, Towbin JA. Task Force 2 : Congenital heart disease. J Am Coll Cardiol. 2005;45:1326-33
2 • Pelliccia A, Fagard R, Bjørnstad HH, et al. Recommendations for competitive sports participation in athletes with cardiovascular disease: A consensus document from the
Study Group of Sports Cardiology of the Working Group of Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology and the Working Group of Myocardial and Pericardial
Diseases of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2005 Jul;26(14):1422-45
3 • Mitchell JH, Haskell W, Snell P, Van Camp SP. Task Force 8 : Classification of sports. J Am Coll Cardiol. 2005;45:1364-7
4 • Bonow ROMD, Cheitlin MD, Crawford MH, and Pamela S. Douglas PS. 36th Bethesda Conference. Task Force 3: Valvular heart disease. J Am Coll Cardiol 2005;45:1334-40
Seuls les patients dont l’activité physique pourrait
aggraver la pathologie ou induire des troubles
rythmiques potentiellement dangereux doivent être
écartés de la pratique sportive.
1
/
5
100%