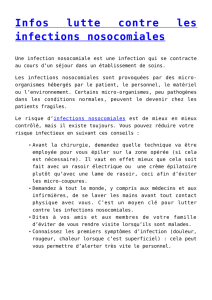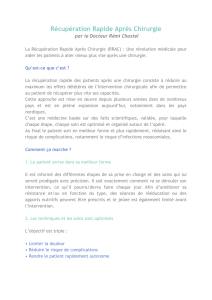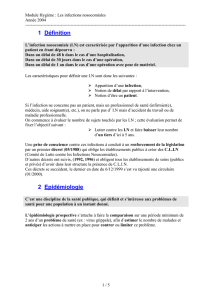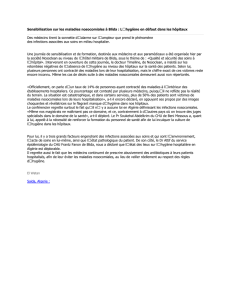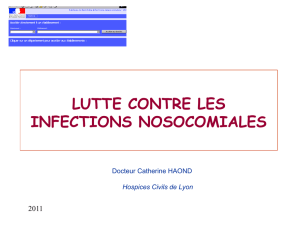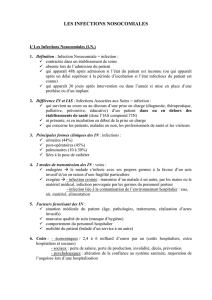Les risques infectieux en milieu de soins

1
Ministère de la Santé Publique
Direction Régionale de la Santé de Bizerte
Service Régional d’Hygiène du Milieu
HYGIENE HOSPITALIERE ET LUTTE CONTRE LES
INFECTIONS ASSOCIEES AUX SOINS
Ouvrage collectif à l’usage des personnels
soignants et des hygiénistes
Volume 2
Les risques infectieux en
milieu de soins
Année 2009

2
EUIPE DE COORDINATION
COMITE DE LECTURE
Aoun Karim
(Institut Pasteur de Tunis)
Chakroun Mohamed
(EPS Fattouma Bourguiba de Monastir)
Loussaief Chawki
(EPS Fattouma Bourguiba de Monastir)
Khalfaoui Moncef
(Hôpital Régional de Menzel Bourguiba)
AUTEURS
AISSA SALWA (CHU Sahloul - Sousse) HAMZA RIDHA (Service Régional
d’Hygiène du Milieu de
Bizerte)
AOUN KARIM
(Institut Pasteur de Tunis) HARTEMMAN PHILIPPE (CHU Nancy – France)
BEN SAID ABDELKADER (Hôpital Régional de Bizerte)
KAMMOUN HAYET (Service Régional
d’Hygiène de Bizerte)
CHAKROUN MOHAMED
(EPS Fattouma Bourguiba de
Monastir)
KHALFAOUI MONCEF
(Hôpital Régional de
Menzel Bourguiba)
CHERIF DRISS (Churirgien de libre pratique-
Bizerte)
LAATIRI SAID HOUYEM (CHU Sahloul – Sousse)
DHAOUADI GADHOUM LEILA (Hôpital Régional de Bizerte)
MAATOUG FETHI (Clinique dentaire de
Monastir)
FERSI MOUNIR
(Hôpital Régional de Bizerte) NOUIRA AMEL
(CHU Farhat Hached de
Sousse)
GANDOURA NAJOUA (Hôpital Régional de Bizerte)
SIALA EMMNA (Institut Pasteur de Tunis)
GZARA AHLEM (GSB de Tunis) SOUILAH DAGHFOUS
HELLA
(CHU Mohamed Kassab
de Tunis)
HAMDI SAMIRA (Hôpital Régional de Menzel
Bourguiba)
Hamza Ridha (Service Régional d’Hygiène de Bizerte)
Kammoun Hayet (Service Régional d’Hygiène de Bizerte)
Dhaouadi Mahmoud (Service Régional d’Hygiène de Bizerte)

3
SOMMAIRE
PREFACE 4
INFECTION ASSOCIEE AUX SOINS : DEFINITIONS 5
EPIDEMIOLOGIE DES INFECTIONS ASSOCIEES AUX SOINS 9
INFECTION ASSOCIEE AUX SOINS : ASPECTS SOCIO-ECONOMIQUES 15
INFECTION ASSOCIEE AUX SOINS : ASPECTS MEDICAUX -LEGAUX 24
INFECTION ASSOCIEE AUX SOINS : ASPECTS CLINIQUES 27
INFECTIONS VIRALES ASSOCIEES AUX SOINS 37
MYCOSES ASSOCIEES AUX SOINS 46
INFECTIONS URINAIRES ASSOCIEES AUX SOINS 51
INFECTIONS DU SITE OPERATOIRE 61
RISQUES INFECTIEUX EN REANIMATION 78
RISQUES INFECTIEUX LIES A L’ANESTHESIE 87
INFECTIONS ASSOCIEES AUX SOINS EN MILIEU OBSTETRICAL 104
INFECTIONS ASSOCIEES AUX SOINS EN PEDIATRIE 112
INFECTIONS ASSOCIEES AUX SOINS EN GERIATRIE 118
LEGIONELLOSE ASSOCIEE AUX SOINS 124
RISQUES INFECTIEUX EN MILIEU DE SOINS AMBULATOIRES 135
RISQUES INFECTIEX EN MILIEU DE SOINS DENTAIRES 138
ACCIDENTS D’EXPOSITION AU SANG 148

4
PREFACE
Ce deuxième volume de notre ouvrage collectif portant sur l’hygiène hospitalière et la
lutte contre les infections associées aux soins destiné aux personnels soignants et
hygiénistes, traite des différents aspects et multiples facettes de l’infection associée aux
soins. D’éminents spécialistes de différentes disciplines dont la plupart participent
régulièrement depuis 2002 à l’animation du cours du nord d’hygiène hospitalière, ont
contribué à l’élaboration de ce document par la soumission d’articles couvrant non
seulement tous les aspects relatifs à l’infection associée au soins : cadre conceptuel ;
aspects épidémiologiques, socio-économiques, médico-légaux et cliniques mais également
les divers milieux de soins concernés par le risque infectieux : hospitalier, ambulatoire et
dentaire sans omettre certaines formes particulières tel que la légionellose et certaines
spécificités tels que les risques liés à l’anesthésie, les particularités des infections associées
aux soins en réanimation, en pédiatrie, en gériatrie et en milieu obstétrical.
Bien entendu quoique d’une richesse exceptionnelle, ce document ne peut prétendre
être complet dans la mesure où le domaine des infections associées aux soins est tellement
vaste et complexe qu’il ne se prête pas à être cerné dans un seul document.
A l’instar du premier volume de notre ouvrage, ce deuxième de la série sera diffusé à
l’occasion des prochaines sessions du Cours du Nord d’Hygiène Hospitalière pour être
consulté par les participants à ce cours de manière à faire éviter aux enseignements les
exposés théoriques et à favoriser l’approche participative et interactive lors de ces sessions
futures. Il est envisageable également d’en assurer une diffusion plus large auprès des
personnels soignants et des hygiénistes.
Que tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce volume
(auteurs, relecteurs et coordinateurs) soient vivement remerciés pour leur générosité.
L’équipe de coordination

5
INFECTION ASSOSCIEE AUX SOINS : DEFINITIONS
HAYET KAMMOUN
INTRODUCTION
Les soins de santé peuvent sauver des
vies et le font. Ils ont apporté des
bienfaits sans précédent à des
générations de patients et leurs familles.
Ils véhiculent néanmoins également des
risques. Les infections liées aux
procédures de soins constituent parfois la
conséquence de la médecine moderne
(1).
Chaque année dans le monde, le
traitement et la prise en charge de
centaines de millions de patients sont
perturbés par des infections contractées
au cours des soins. Il arrive alors que des
malades tombent plus gravement
malades qu’ils n’aurait dû être en
situation normale. Certains doivent subir
des hospitalisations prolongées, d’autres
souffrent d’une incapacité de longue
durée, d’autres encore décèdent (1).
Ces dernières années, l’évolution des
concepts de l’hygiène hospitalière a
marqueé l’actualisation de la définition
des infections nosocomiales pour
englober celles contractées au cours de
soins, même en dehors des
établissements de santé (2). Il a été
convenu d’élargir globalement le champ
couvert et de réviser les définitions
classiques.
LE CONCEPT CLASSIQUE
Classiquement on parle d’infection
hospitalière ou infection nosocomiale. Le
terme « Nosocomial » datant de 1845,
vient du grecque (nosos = maladie et
Komeion = soigner) et signifie « lieu où on
soigne » ou « hôpital » qualifiant ainsi ce
qui se rapporte aux hôpitaux, ce qui se
contracte à l’hôpital (3). On appelle alors
infection nosocomiale ou infection
hospitalière (c’est aussi l’hospitalisme
infectieux), toute infection cliniquement et
microbiologiquement identifiable acquise
à l’hôpital, que ce soit au cours d’une
hospitalisation, d’une consultation ou de
tout autre acte pratiqué à l’hôpital,
comme une exploration radiologique ou
endoscopique (4). Ainsi, les infections
nosocomiales concernent en premier lieu
les malades hospitalisés mais peuvent
aussi toucher les patients des
consultations externes, le personnel
soignant et auxiliaire et les visiteurs (5).
En fait, les définitions sont
extrêmement nombreuses. On en trouve
dans les travaux de l’Organisation
Mondiale de la Santé, du Conseil de
l’Europe, des « Centers for Diseases
Control » d’Atlanta (3). La définition la
plus communément admise et la plus
utilisée est celle adoptée par le conseil de
l’Europe et qui stipule que l’infection
nosocomiale est « toute maladie due à
des microorganismes contractée à
l’hôpital, cliniquement et/ou
microbiologiquement reconnaissable, qui
affecte soit le malade du fait de son
admission à l’hôpital ou des soins qu’il a
reçus en tant que patient hospitalisé ou
en traitement ambulatoire, soit le
personnel hospitalier du fait de son
activité, que les symptômes de la maladie
apparaissent ou non pendant que
l’intéressé se trouve à l’hôpital ». On parle
parfois d’infection iatrogène, mais les
termes « nosocomial » et « iatrogène » ne
sont pas tout à fait synonymes. En effet,
le vocable « infection iatrogène » est
d’utilisation plus récente (il date de 1970)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
1
/
158
100%