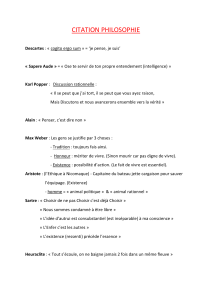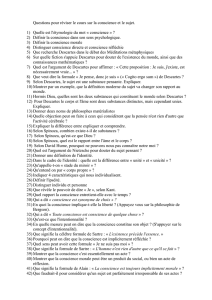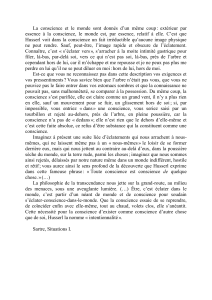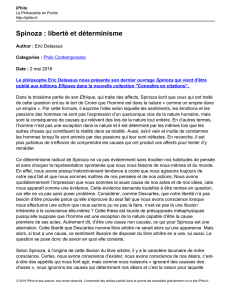Philosophies du cogito et philosophies du conatur

« Philosophies du cogito et philosophies du conatur :
Descartes, Spinoza et leurs descendants »
par Michel Juffé
Conférence à Brigham Young University, lundi 18 octobre 2004
I. Ce n’est pas d’hier que la distinction, voire l’opposition, entre ceux qui croient que la
science et notamment celle du calcul donnent la clef des affaires humaines d’un côté et ceux
qui croient que celles-ci s’appréhendent mieux par la poésie ou d’autres formes de récit,
existe. Elle a ses racines, me semble-t-il, et sans remonter à Platon et Aristote, dans la
séparation entre philosophies du Cogito et philosophies du Conatur, telle qu’elle a lieu,
emblématiquement, avec Descartes et Spinoza. Pour l’un « je suis une chose qui pense » ;
pour l’autre le désir est l’essence de l’homme.
Ce qui ne signifie pas que Descartes n’a rien à dire sur le désir ou Spinoza sur la pensée. L’un
et l’autre accordent une très grande importance à la connaissance, mais pour l’un cette
connaissance est issue de l’esprit seul (de l’âme) ; pour l’autre elle vient entièrement du
corps (et le corps et l’esprit sont une seule et même chose). Pour l’un, une volonté libre peut
exister indépendamment du corps, pour l’autre c’est le corps lui-même désire et veut.
La différence, fondamentale, est d’orientation.
Pour Descartes la pensée peut acquérir une totale autonomie, s’abstraire des vicissitudes
des passions, faire abstraction - par une ascèse intellectuelle – des contingences corporelles
(c’est l’objet des Méditations et du Discours de la méthode pour bien conduire sa raison),
autrement dit exercer son propre empire sur les idées, les sensations, voire les volitions.
Pour lui le corps est source d’erreur, de perte, de distraction, de corruption.

Pour Spinoza la volonté et l’entendement sont une même chose, la puissance d’agir et la
connaissance sont une seule et même chose, et plus nous connaissons plus nous aimons
(Dieu, les autres choses et soi-même). Pour lui, toute connaissance/activité naît du corps et
se développe avec le corps, au point qu’il finit par écrire : « Qui a un Corps apte à un très
grand nombre de choses, a un Esprit dont la plus grande part est éternelle. »
Ces différences et même ces oppositions naissent d’une divergence fondamentale,
ontologique et éthique à la fois : pour Descartes, existent deux mondes, celui de l’Etendue
et celui de la Pensée, celui des passions (l’âme liée au corps) et celui de l’intellection, celui de
la nature et celui du divin. Pour Spinoza il n’existe qu’un seul monde – Deus sive Natura - la
pensée et l’étendue sont une seule et même chose, même si nos moyens limités nous font
apercevoir des différences entre Pensée et Etendue (deux attributs de la même et unique
Substance), entre connu et inconnu, entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui y échappe.
II. Les philosophies du cogito font souvent abstraction des forces, des efforts, des
mouvements (et des émotions) sans lesquels aucune pensée ne pourrait non seulement se
manifester mais exister. Plus précisément, pour eux le monde des forces est celui de
l’Etendue, celui de la pensée étant dépourvu de corps, étant pure intellection ou intuition
de soi, du monde et de Dieu.
Pour Descartes il existe deux substances : l’âme, dont l’attribut est la pensée, et le corps,
dont l’attribut est l’extension. L’être suprême, Dieu, est incorporel. Notre essence est
spirituelle et non corporelle : « examinant ce que nous sommes, nous pensons maintenant
qu’il n’y a rien hors de notre pensée qui soit véritablement ou qui existe, nous connaissons
manifestement que, pour être, nous n’avons pas besoin d’extension, de figure, d’être en
aucun lieu, ni d’aucune autre chose que l’on peut attribuer au corps, et que nous sommes
par cela seul que nous pensons. »1
Descartes inclut dans la substance pensante non seulement les idées, mais les sensations, les
désirs, les volontés, les imaginations, etc. ainsi est affirmée sans aucun doute la suprématie
de la pensée, puisqu’elle annexe sentiments, vouloirs, etc. De plus, seuls ces attributs de la
1 Principes de la philosophie, in Oeuvres et lettres, Gallimard, La Pléiade, 1953, p. 574

pensée sont garantis exister : « Car il est de soi si évident que c’est moi qui doute, qui
entends, et qui désire, qu’il n’est pas ici besoin de rien ajouter pour l’expliquer. Et j’ai aussi
certainement la puissance d’imaginer ; car encore qu’il puisse arriver […] que les choses que
j’imagine ne soient pas vraies, néanmoins cette puissance d’imaginer ne laisse pas d’être
réellement en moi, et fait partie de ma pensée. Enfin, je suis le même qui sens […] puisqu’en
effet je vois la lumière, j’ouïs le bruit, je ressens la chaleur. Mais l’on me dira que ces
apparences sont fausses et que je dors. Qu’il en soit ainsi ; toutefois, à tout le moins, il est
très certain qu’il me semble que je vois, que j’ouïs, et que je m’échauffe ; et c’est
proprement ce qui en moi s’appelle sentir, et cela, précisément, n’est rien d’autre que
penser. »1
De même pour distinguer ce qui est de l’âme et ce qui est du corps, la règle à suivre est
simple : « tout ce que nous expérimentons être en nous, et que nous voyons aussi pouvoir
être en des corps tout à fait inanimés, ne doit être attribué qu’à notre corps ; et, au
contraire, tout ce qui est en nous, et que nous ne concevons en aucune façon pouvoir
appartenir à un corps, doit être attribué à notre âme. » (Art. 3) Comme le corps ne pense
pas, les pensées appartiennent à l’âme ; comme les corps inanimés ont mouvement et
chaleur, ceux-ci n’appartiennent qu’au corps (Art. 4)2.
Kant, plus averti que Descartes des pièges de l’ontologie et la logique, suppose un monde
nouménal au-dessus ou derrière le monde phénoménal (il est vrai, le seul qui nous soit
accessible). Ce qu’il croit déduire de la distinction entre connaissances pures a priori et
connaissances empiriques, résultant de l’expérience. Connaissance pure, « au-delà du
monde sensible »3 qu’il importe de bien délimiter pour traiter des problèmes « inévitables
de la raison pure elle-même [que] sont Dieu, la liberté et l’immortalité »4, précisément ceux
de la métaphysique. Et celle-ci ne peut être que spéculative, théorique. « Car tout ce qui est
pratique, en tant qu’il contient des mobiles, se rapporte au sentiment, qui appartient aux
sources empiriques de la connaissance. »5
Nous voyons ainsi chez Kant, la supériorité de la métaphysique sur la physique. En témoigne
encore son esthétique transcendantale, où il montre que l’espace et le temps sont des
1 Méditations, in Œuvres et lettres, pp. 278-279.
2 Les passions de l’âme (1649), in Œuvres et lettres, La Pléiade, Gallimard, 1953.
3 Critique de la raison pure, Introduction, in Œuvres philosophiques I, Gallimard, La Pléiade, 1980, p. 762
4 Ibid. p. 762
5 Ibid. p. 779

formes pures a priori de l’intuition, indépendamment de toute expérience. Cependant, quels
présupposés admis sans discussion pour y parvenir ! « Par le moyen du sens externe (une
propriété de notre esprit), nous nous représentons certains objets comme étant hors de
nous et placés tous ensemble dans l’espace. »1 Le sens externe et le sens interne (celui du
temps) sont inhérents à l’esprit : ils n’ont aucune genèse, soit sociologique ou psychologique
ou autre. Ils sont simplement admis, sans discussion. Plus généralement, la dualité des
mondes chez Kant, et la supériorité de la raison sur la sensibilité se traduit une double
hiérarchie : « L’entendement constitue un objet pour la raison, exactement comme la
sensibilité le fait pour l’entendement. »2 ; Kant continuera sur sa lancée avec la Critique de la
raison pratique, où il pense établir la même distinction pour l’action : d’un côté le monde de
la liberté, dans lequel nous agissons par maximes ; de l’autre celui du sentiment (les choses
senties), au sein duquel nous agissons par penchant.
Les positions de Kant peuvent être résumées dans ce tableau :
ENTENDEMENT, LOGIQUE SENSIBILITÉ, PSYCHOLOGIE
Activité, action (faire) Passivité, affection (subir)
Chose en soi (intemporel) Apparition, phénomène (temporel)
Supérieur Inférieur
Spontanéité Réceptivité
Unité du Je Diversité du Je
Concepts (appréhension pure) Intuitions (appréhension empirique)
L’ESPRIT « PUR » L’ÂME, L’ESPRIT LIÉ AU CORPS
Notons que chez Descartes comme chez Kant, ce qui légitime cette entreprise de purification
de l’esprit, d’autonomie de la pensée par rapport au monde sensible, ce sont les
mathématiques. L’un comme l’autre puisent chez elles les exemples et les modes de
raisonnement qui peuvent donner lieu à des « idées pures ».
Il en va de même pour Husserl, qui commença par étudier les mathématiques et chercha
une « fondation platonicienne de la logique »3 Pour lui la science et la philosophie moderne
ont perdu le sens de l’Idée, du Logos. Pour m’en tenir aux Idées directrices pour une
phénoménologie (1913), Husserl cherche à fonder une science non empirique de la
1 Esthétique transcendantale, CRP, p. 784
2 Dialectique transcendantale, Appendice, p. 1263.
3 Logique formelle et transcendantale, 1929.

conscience, laquelle forme une « région » séparée de la « région » nature, et autrement
existante qu’elle. Dans la sphère « naturelle », « l’expérience donatrice originaire est la
perception » au sens habituel du terme ; l’ « expérience originaire de nous-même et de nos
états de conscience » est une perception interne.1 Les deux sont encore des perceptions,
alors que la vision des essences (Idées, Eidos) est une intuition pure, indépendante des faits
et de leur connaissance, où l’expérience ne joue aucun rôle : logique pure, mathématique
pure, théorie pure du temps, etc. Par suite, « la phénoménologie […] constitue le fondement
éidétique essentiel de la psychologie et des sciences de l’esprit. »2
Il s’agit dès lors d’affranchir la conscience des limites de la vie, de l’existence, qui la
« divertit » d’elle-même, lui ôte sa pleine capacité de voir, « l’intuition donatrice originaire ».
Par la suspension (réduction), le sujet qui se croyait partie du monde s’en voit le fondement.
C’est le Cogito cartésien, poussé à ses ultimes conséquences (ce que Descartes, selon
Husserl, n’a pas su réaliser). Car il ne s’agit pas de « douter » de l’existence du monde, mais
de mettre « hors circuit » , « entre parenthèses », ce que nous en savons. Nous n’avons plus
alors qu’à considérer les objets intentionnels, ceux que nous révèlent les vécus
intentionnels. Pour nous, êtres pensants, il existe un « être en tant que conscience »,
immanent, et un « être en tant que réalité », transcendant. Transcendant veut dire : hors de
notre conscience, extérieur à la pensée, l’être des « choses » qui peuplent le « monde »
entant qu’unité spatio-temporelle. Ainsi Kant se trompe lorsqu’il croit que nous pensons
dans ce cadre spatio-temporel (esthétique transcendantale), alors que nous pensons ce
cadre. Le moi pur, celui du Cogito, est indubitable, alors le monde est contingent. Ainsi il est
clair « que l’être de la conscience, et tout le flux du vécu en général, serait certes
nécessairement modifié si le monde des choses venait à s’anéantir, mais qu’il ne serait pas
atteint dans sa propre existence. »3
Quels que soient les affinements qu’il lui apporte, Husserl ne changera jamais son point de
vue. J’en tiens pour preuve le rapport qu’il établit entre psychologie et phénoménologie
dans ses derniers textes.4 La psychologie ne peut être fondée comme les sciences de la
nature, car elle consiste à connaître l’ego transcendantal, en tant qu’âme qui n’a rien de «
réel », de spatio-temporel (là encore contrairement à Kant, qui fait de la temporalité la base
1 Idées directrices pour une phénoménologie, Gallimard, 1950, p. 15.
2 Idées…, p. 63.
3 Idées…, p. 161.
4 La crise de la conscience européenne et la phénoménologie transcendantale (1935-1936), Gallimard, 1976.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%