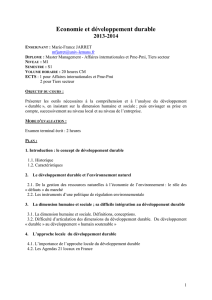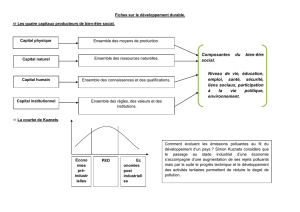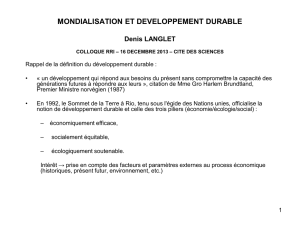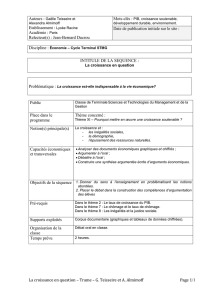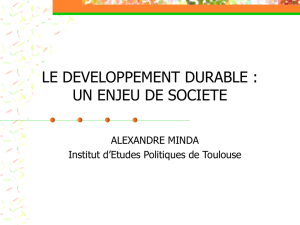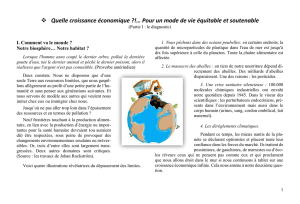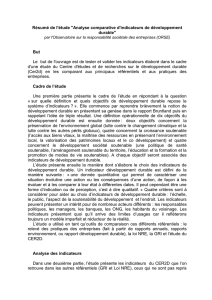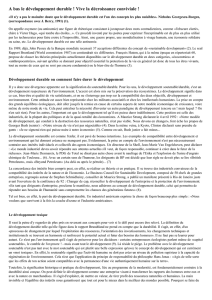Le développement soutenable

Le développement soutenable
Franck-Dominique Vivien
Repères
Introduction
Le terme « durable » a tendance à renvoyer à la durée du phénomène auquel il s'applique, comme si
le problème se résumait à vouloir faire durer le développement. Or la notion de soutenabilité permet
de mettre l'accent sur d'autres questions relatives à la répartition des richesses entre les générations
et à l'intérieur de chacune des générations.
La définition du développement soutenable la plus souvent citée est une de celles qui figurent dans
le rapport Brundtland : « Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre
la capacité des générations futures de répondre aux leurs ».
•Le développement soutenable : au moins trente ans de débat
Le Club de Rome : Le premier rapport remis au Club de Rome, The Limits to Growth, paraît en
1972. C'est un point de vue global et systémique qui est adopté par Meadows et son équipe du MIT.
De fait, les problèmes considérés s'étendent à l'ensemble de la planète et interagissent les uns avec
les autres.
« Développement et environnement doivent absolument être traités comme un seul et même
problème » selon Meadows.
Le développement reste possible mais dans d'autres domaines. Ainsi : « la population et le capital
sont les seules grandeurs qui doivent rester constantes dans un monde en équilibre. Toutes les
activités humaines qui n'entraînent pas une consommation déraisonnable de matériaux
irremplaçables, ou qui ne dégradent pas d'une manière irréversible l'environnement, pourraient se
développer indéfiniment. En particulier, ces activités que beaucoup considèrent comme les plus
souhaitables et les plus satisfaisantes : éducation, art, religion, recherche fondamentale, sports,
relations humaines pourraient devenir florissantes ».
Au-delà du slogan de la « croissance zéro », qui a beaucoup marqué les esprits et fait l'objet de
vives discussions, y compris au sein du Club de Rome, c'est l'idée d'une redistribution des richesses
au niveau mondial qui est proposée. Pour ce faire, la croissance doit se poursuivre dans les pays du
Sud, au moins pendant un certain temps, tandis qu'elle doit s'arrêter dans les pays du Nord.
La conférence de Stockholm : en juin 1972 se tient à Stockholm la première conférence des Nations
unies sur l'homme et son milieu. Son slogan officiel est : « Une seule Terre ! ». la décision est prise
de créer un organe spécifique au sein de l'ONU en charge des questions environnementales. Le
Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) voit le jour dans la foulée et est
installé à Nairobi. Pendant ce temps, on assiste à une mobilisation très importante des ONG. Au
slogan « Une seule Terre » répond l'appel des ONG « Un seul peuple ».
Le rapport Brundtland : en 1983, l'Assemblée générale des Nations unies décide de créer la
Commission mondiale sur l'environnement et le développement (CMED), un groupe de travail
composé de membres du personnel politique de différents pays, placé sous la présidence de Mme
Brundtland, qui est alors le Premier ministre de la Norvège. Le mandat de la CMED est triple :
1. établir un diagnostic en matière de problèmes d'environnement et de développement et faire
des propositions pour une action novatrice, concrète et réaliste
2. viser à la prise de conscience et à la mobilisation de l'ensemble des acteurs concernés
3. envisager de nouvelles modalités de coopération internationale susceptibles de renforcer
celle-ci et de provoquer les changements souhaités.

Après cinq ans de travail, la CMED, en 1987, publie Notre avenir à tous, un rapport dont le contenu
fait écho à beaucoup d'anciennes propositions.
La notion de développement soutenable y est décrite. L'accent est d'abord mis sur la durée du
développement. Une deuxième dimension à prendre en compte concerne l'équité sociale, à établir
entre les générations et à l'intérieur des générations. Une troisième dimension est le respect des
systèmes naturels qui nous font vivre. Cela constitue ce que l'on désigne généralement comme les
« trois piliers » du développement soutenable.
La qualité de cette croissance doit changer en respectant « la non-exploitation » d'autrui et en
recourant à des techniques moins consommatrices d'énergie et de matière. Les pouvoirs publics et
l'industrie ont à intégrer l'environnement dans leurs décisions. Il importe que cette croissance soit au
service d'une conception élargie du développement, intégrant les besoins essentiels en ce qui
concerne l'alimentation, l'énergie, l'emploi..., un objectif qui doit être décliné différemment selon les
pays, puisque ceux-ci connaissent une variété de conditions écologiques et de systèmes
économiques et sociaux.
Le Sommet de la Terre de Rio : Suggérée par les rédacteurs du rapport Brundtland, la conférence
des Nations-Unies sur l'environnement et le développement se tient à Rio de Janeiro du 3 au 14 Juin
1992, soit vingt ans presque jour pour jour après celle de Stockholm (d'où surnom Stockholm +20).
Par son ampleur (40 000 personnes, 108 chefs d’État et de gouvernement, 172 États représentés), la
conférence de Rio est, en son temps, la réunion la plus importante organisé par l'ONU. Elle voit le
véritable lancement médiatique de la notion de développement soutenable.
Au terme de dix jours de discussion entre gouvernements, plusieurs textes sont adoptés. La
Déclaration de Rio reprend, en préambule, celle de Stockholm et entend lui donner de nouveaux
prolongements. L'article 5 de la Déclaration de Rio se réfère à quelque chose qui ressemble au
principe de précaution. Un plan d'action, baptisé Agenda 21, volumineux pense-bête de 40 chapitres
et 800 pages, sans valeur juridique contraignante, recense plus d'une centaine d'actions à
entreprendre pour que le développement soutenable devienne une réalité au XXI siècle. Le coût de
cette mise en œuvre est estimé à environ 600 milliards de dollars à l'horizon 2000, ce qui
correspond aux dépenses d'armement mondial. Un certain nombre d'engagements internationaux ont
été signées, la première relative au changement climatique (CCCC), la seconde à l'érosion de la
diversité biologique.
La Convention cadre sur le changement climatique (CCCC) et le Protocole de Kyoto : le CCCC
vise à « stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui
empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique ». Le Protocole de
Kyoto est un texte additionnel à la CCCC, qui a été signé en 1997 lors de la troisième conférence de
ses parties signataires. Il définit l'engagement différencié de la communauté internationale – seuls
les pays industrialisés sont concernés – dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Pour atteindre cet objectif, 3 mécanismes internationaux de flexibilité sont prévus :
1. Un commerce de permis d'émission entre pays industrialisés, qui doit entrer en vigueur en
2008. L’Union européenne a décidé de mettre en œuvre un tel système depuis janvier 2005
2. La « mise en œuvre conjointe », entrant en vigueur en 2008, qui est un mécanisme
concernant essentiellement les investissements directs pauvres en carbone réalisés par les
pays industrialisés dans les « pays en transition », la différence de rejets de gaz à effet de
serre évités étant portée au crédit du pays investisseur et au débit du pays d'accueil
3. Le « mécanisme de développement propre » qui porte aussi sur des projets, mais localisés
dans les pays du Sud, qui permettent de réduire les émissions de GES par rapport à une
situation de référence, ces réductions étant portées au crédit de l'investisseur.

Le Sommet de Johannesburg : le Sommet mondial du développement soutenable est organisé à
Johannesburg du 26 août au 4 septembre 2002. Initialement, son ordre du jour portait sur la
concrétisation des engagements pris, dix ans plus tôt, lors de la conférence de Rio. Il s'agissait, par
ailleurs, d'insister davantage sur le pilier social de la soutenabilité et de mettre l'accent sur la
pauvreté. Las ! Les crises financières (asiatique et bulle internet) et les problèmes de sécurité (11
septembre) ont entre-temps accaparé l'attention. Les observateurs s'accordent pour reconnaître la
faiblesse des résultats de ce « Stockholm +30 ». La déclaration finale du Sommet n'a fait que
reprendre les déclarations précédentes. Le plan d'action ne comprend que des engagements chiffrés
assez flous, lesquels pour la plupart avaient déjà été annoncés lors de précédentes rencontres
internationales (Déclaration de Doha en 2001, Déclaration du Millénaire).
Ajout : La seconde conférence de Rio : 2012. « L'avenir que nous voulons » a été le titre de la
déclaration finale de ce Rio +20. Triste échec. Des 3 piliers du développement soutenable il ne reste
plus que l'économique avec une touche de couleur : vive la « croissance verte ». Des objectifs de
développement durable seront proposés en 2013 pour une mise en place en 2015. Chaque paye
pourra choisir une approche appropriée des politiques d'économie verte. A condition, bien sûr, de ne
pas imposer des règles rigides ni de faire une restriction déguisée au commerce international.
Absence totale d'objectifs contraignants et de financement. Il semble que la priorité a été donnée à
la crise économique, pour l'écologie, on verra plus tard.
•La confiance de la théorie économique standard dans une croissance durable
La recherche des conditions économiques, sociales et environnementales de la poursuite de
l'accumulation des richesses sur le long terme n'est pas neuve. Elle est même constitutive de la
formation de l'économie politique.
Chez les classiques : Pour beaucoup de classiques on note l'idée d'un état stationnaire même si chez
Smith la division du travail et l'ouverture aux marché internationaux, et pour Ricardo, le progrès
technique, peuvent contrecarrer cela. Il en va différemment chez John Stuart Mill, 1848 : « Il n'est
pas nécessaire de faire observer que l'état stationnaire de la population et de la richesse n'implique
pas l'immobilité du produit humain. Il resterait autant d'espace que jamais pour toutes sortes de
culture morale et de progrès moraux et sociaux ; autant de place pour améliorer l'art de vivre et
plus de probabilité de le voir amélioré lorsque les âmes cesseraient d'être remplies du soin
d'acquérir des richesses. Les arts industriels eux-mêmes pourraient être cultivés aussi sérieusement
et avec autant de succès, avec cette seule différence qu'au lieu de n'avoir d'autre but que
l'acquisition de la richesse, les perfectionnements atteindraient leur but, qui est la diminution du
temps de travail. Il est douteux que toutes les inventions mécaniques faites jusqu'à ce jour aient
diminué la fatigue quotidienne d'un seul être humain […], elles ont augmenté l'aisance des classes
moyennes ; mais elles n'ont pas encore commencé à opérer dans la destinée de l'humanité les
grands changements qu'il est dans leur nature de réaliser ». Mill, indique ainsi que la non-
croissance n'implique pas la fin du progrès et n'est pas incompatible avec l'épanouissement de la
liberté individuelle.
Chez Keynes : Bien qu'il se soit concentré sur les problèmes de court terme que rencontre à son
époque le capitalisme, Keynes ne néglige pas la question du devenir à long terme des sociétés
d'abondance. Ainsi, dans ses « Perspectives économiques pour nos petits-enfants »; c'est-à-dire
quand la croissance de la productivité aura fait son œuvre, Keynes envisage sérieusement
l'hypothèse d'une diminution du temps de travail dans les sociétés industrielles et s'interroge sur le
vide que cela ne manquera pas de laisser sur le plan des motivations des individus et des valeurs
dominantes de la société : « Ainsi, pour la première fois depuis sa création, l'homme fera-t-il face à
son problème véritable et permanent : comment employer la liberté arrachée aux contraintes
économiques ? Comment occuper les loisirs que la science et les intérêts composés auront conquis

pour lui, de manière agréable, sage et bonne ? ».
Les néoclassiques : L'idée avancée depuis les années 1970 par certains néoclassiques est que la
poursuite de la croissance va dans le sens de la protection de l'environnement. Il y aurait une
capacité des économies modernes à gérer la problématique environnementale. Beckerman évoque
notamment le cas de la pollution par le dioxyde de soufre aux États-Unis dont il note la disparition
dans de nombreux États alors même que la croissance du pays se poursuit.
Ainsi, le développement soutenable apparaîtrait finalement comme une sixième étape de la
croissance si l'on reprend la typologie de Rostow.
Les néoclassiques sont donc très confiants. Pour eux, si il y a des problèmes d'environnement, c'est
parce qu'il y a interférence entre deux catégories de biens. Les objets environnementaux sont en
train de devenir des biens rares, alors qu'ils étaient considérés jusqu'alors comme des biens libres,
disponibles en quantités illimitées et, de ce fait, ne relevant pas de l'analyse économique.
Cependant, bien qu'entrant de plus en plus dans la sphère de la rareté, les objets naturels ne
présentent pas encore toutes les caractéristiques des biens économiques, ce qui empêche que les
relations marchandes jouent pleinement leur rôle régulateur (pas de prix clairement identifié, donc
régulation par les prix impossible). Ces « défaillances de marché » aboutissent à une mauvaise
allocation des ressources qui prend la forme de pollutions ou d'épuisement de ressources naturelles.
Pour répondre à ces défaillances, la solution préconisée consiste, quand cela est possible, à faire
basculer dans la sphère marchande les événements environnementaux qui n'y sont pas encore
totalement entrés. On va procéder à une internalisation des externalités en créant des marchés ou
des quasi-marchés là où, au départ, ils n'existent pas, ou pas complètement, soit en établissant des
signaux-prix envoyés aux agents économiques, soit en leur distribuant des droits de propriété
échangeables sur des ressources naturelles. C'est ce que l'on désigne comme le principe du pollueur-
payeur, prôné par l'OCDE depuis le début des années 1970.
En résumé, c'est par le renforcement de la logique économique dominante que les problèmes de
pauvreté, de pollution et d'épuisement des ressources naturelles se résoudront.
•Le développement soutenable grâce à une économie écologique ?
Croissance ne signifie pas développement. La croissance correspond à un accroissement quantitatif
des biens et services disponibles, mesuré en termes monétaires ou physiques. Le développement,
lui, traduit une amélioration qualitative des conditions de vie.
Définition de Perroux (1961) : « Le développement est la combinaison des changements mentaux et
sociaux d'une population qui la rendent apte à faire croître, cumulativement et durablement, son
produit réel global ».
Sans négliger une action sur les prix, l'option instrumentale privilégiée par les économistes
écologiques consiste à établir des limites quantitatives quant aux ressources exploitées et aux rejets
effectués dans les milieux naturels. Ce faisant, ils affichent leur scepticisme vis-à-vis de l'analyse
néoclassique en termes d'internalisation des externalités. Rompant avec cette idée qui vise à faire
entrer à l'intérieur de la sphère économique ce qui, au départ, lui est extérieur. Les économistes
écologiques conçoivent l'économie comme un sous-système d'un système englobant, constitué par
l'ensemble des activités humaines, lui-même compris dans le système plus vaste formé par la
Biosphère, le problème étant alors de mettre en place des relations d'insertion – ou d'encastrement
pour reprendre Polanyi – entre ces différents systèmes : insertion de l'économique dans la sphère
des activités sociales, elle-même devant s'insérer dans la Biosphère.
L'écologie industrielle va proposer une autre voie pour concilier économie et écologie et œuvrer à
l’événement d'un développement soutenable. Il faut engager le système industriel dans une réforme
profonde de ses pratiques environnementales.

Quatre objectifs sont assignés :
1. L'optimisation de l'usage de l'énergie et des matières premières
2. La minimisation des émissions de polluants et le bouclage des flux qui circulent à l'intérieur
des systèmes productifs
3. La dématérialisation des activités économiques
4. La réduction de la dépendance vis-à-vis des sources énergétiques non renouvelables (des
énergies fossiles, en particulier, dans le souci de lutter contre le changement climatique).
A l'image des décomposeurs qui, dans les écosystèmes, se nourrissent des déchets et dépouilles des
autres espèces, les sous-produits et déchets des entreprises doivent servir de matière première pour
la production d'autres firmes. Plutôt que de mettre en œuvre une approche en bout de chaîne, qui
traite après coup les pollutions et les déchets, il s'agit d'éviter d'en produire et d'en émettre à la
source.
Les firmes entendent gagner sur les deux tableaux en réduisant l'impact environnemental de leurs
processus de production tout en gagnant de l'argent. La problématique du développement
soutenable en vient à être traduite dans le monde de l'entreprise par celle de la responsabilité sociale
des entreprises, voire de manière plus restrictive encore par l'investissement socialement
responsable qui vise à réconcilier les activités de l'entreprise avec les valeurs de l'ensemble de la
société en répondant aux attentes de partenaires qui ne limitent pas aux actionnaires et aux clients
de l'entreprise.
L’auto-réglementation est jugée bien plus efficace que la contrainte publique puisqu'elle suppose
l'adhésion volontaire des entreprises et est censée assurer la transparence des procédés mis en
œuvre. On l'aura compris, ce qui est recherché avant tout, c'est la mise en œuvre de nouvelles
politiques d'environnement qui prendraient enfin en compte les intérêts d'entreprises
« responsables ».
L'empreinte écologique, un indicateur de développement soutenable controversé : Élaborée il y a
une dizaine d'années par Rees et Wackernagel (1996). Il vise à évaluer la capacité de certains
écosystèmes à servir de support aux activités humaines. Seulement, il ne porte que sur certains flux
de certaines ressources renouvelables. Mis à part la problématique de l'effet de serre (appréhendée
par le nombre d'hectares de forêt nécessaires pour absorber le CO2), les pollutions ne sont pas
considérées.
•Le développement soutenable : un autre développement ou l'après-
développement ?
Un troisième ensemble de travaux économiques met résolument l'accent sur les questions sociales
soulevées par la problématique du développement soutenable. Rompant avec la vision économique
dominante, qui fait de l'avènement du développement le déroulement normal de l'histoire des
sociétés, ces analyses s'interrogent sur la spécificité du non-développement que connaissent
certaines régions et sur les possibilités d'un autre développement que celui empruntant la voie tracée
des pays occidentaux.
L'écodéveloppement : il préfigure et apparaît comme une expression concurrente de celle de
développement soutenable. Cette notion a été proposé par Strong en 1972. La croissance
économique, même si elle est forte et accompagnée d'une modernisation des structures de
production, ne conduit pas au développement. Au contraire, elle débouche généralement sur un
accroissement des inégalités sociales, qui dont responsables d'une bonne part de la dégradation de
l'environnement. Il y a un gaspillage quand la richesse des uns amène à la consommation de
produits superflus et quand la misère des autres provoque une surexploitation des rares ressources
disponibles. Le « mal-développement » est donc un problème général. D'où la nécessité de mettre
en œuvre un programme global de réformes dans la manière de prendre les décisions économiques,
avec des recommandations différenciées selon les types de pays, les responsabilités du Nord dans la
 6
6
1
/
6
100%