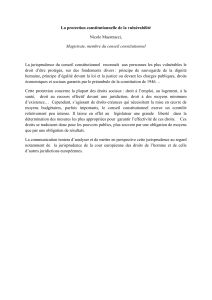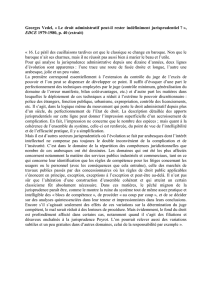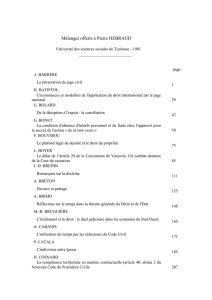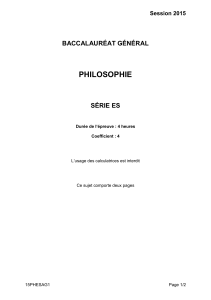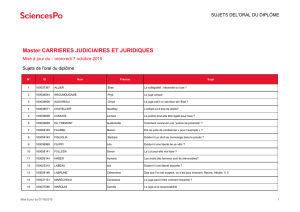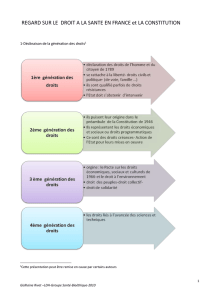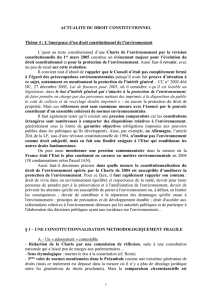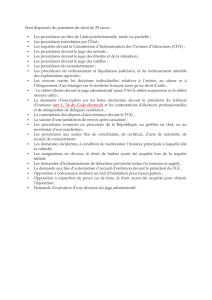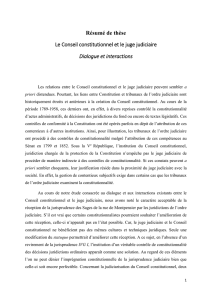Introduction 1. À la recherche de l`objet du cours Le premier

Introduction
1. À la recherche de l’objet du cours
Le premier problème quand l’on cherche à définir, ce sont les oppositions et les
classifications universitaires. En particulier la distinction droit public droit privé structure
l’apprentissage du droit, la recherche en droit. Or, elle est moribonde en dehors des murs de
l’Université. La façon dont est fabriquée et construit le droit de l’Union ne se base pas sur
une distinction public privé. Le droit de l’Union est ainsi indifférent à cette distinction, il s’est
construit sans en tenir compte. Ensuite les arbitrages politiques et la coopération propre au
droit communautaire préfère ignorer cette distinction. C’est particulièrement vrai dans le
domaine de la réglementation de l’économie, le droit de l’UE est très largement indifférent
au régime de propriété applicable aux acteurs économiques, la seule chose qui compte est
cette dernière qualité. Alors pourquoi parlons nous de droit public économique ?
Nulle part dans les programmes, nulle dans les bibliothèque on ne peut trouver du
droit privé économique. Est ce à dire que seul le droit public s’intéresse à l’économie ? Non
bien sur, le droit public peut éventuellement s’intéresser à l’économie du point de vue du
droit, mais le droit privé peut le faire aussi, simplement la façon de s’exprimer n’est pas la
même manière. Par exemple en droit privé on parle plus facilement de droit des affaires. La
qualification de privé n’est pas utilisée en tout état de cause. Alors quelle est la différence ?
En réalité la différence est assez difficile à expliquer. Le droit des affaires est l’ensemble des
règles juridiques qui organisent les rapports de commerce. Et alors ? N’est ce pas du droit de
l’économie ? Et en quoi est ce spécifiquement du droit privé ? Parce que cela organise les
rapports entre personnes privés, mais hors les cas contractuels ou contentieux, les rapports
sont réglementaires ou législatifs, donc public.
Le droit des affaires pourrait perdre une partie de sa spécificité. Le droit public
économique pourrait en effet être l’ensemble des règles juridiques qui visent à organiser
l’activité économique de l’ensemble des acteurs économiques. Mais cela pourrait être le
droit des seules personnes publiques.
La fonction première des personnes publiques n’est pas l’activité économique. Le
rôle de l’État et des collectivités locales, le rôle des établissements publics, n’est pas
premièrement, prioritairement de développer une activité économique. Non, leur rôle est
avant tout de développer des activités de services publics. Mais le droit des services publics
n’est pas le droit public économique. Donc le droit public économique ne peut pas être
seulement le droit qui organise les services publics, non plus leurs seules activités
économiques. Le cœur du service public, matériellement, c’est le service public
administratif, hors des activités industrielles et commerciales, donc hors du champ du droit
public économique.
Or, le droit administratif croise les préoccupations économiques à plusieurs reprises,
d’abord dans ce que l’on appelle le droit administratif général, quand par exemple on traite
de la police administrative, techniques juridiques permettant de gérer l’équilibre entre ordre
public et libertés individuelles et collectives, on trouve parmi les outils les « autorisations ».
L’autorité administrative peut donner dans le cadre de ses pouvoirs de police des
autorisations, cela concerne assez souvent des autorisations, dans le cadre des activités
économiques réglementées. Peut être approchons nous le droit public économique, mais il

n’y a pas de spécificité par rapport au droit administratif général. Autre exemple, celui des
casinos, des pharmacies, etc.
La théorie des services publics est elle aussi mobilisée lorsque l’on parle d’activité
économique avec la notion de service public industriel et commercial. Certains SPIC sont des
acteurs économiques majeurs dans notre système économique, prenons la SNCF par
exemple, ou aéroport de Paris. On peut aussi parler de la DSP, mode de gestion de service
public, contrat par lequel une personne publique confie le plus souvent à un opérateur privé
une mission de service public, l’opérateur étant rémunéré par les usagers, exemple de
Transpole, et du service d’eau. Il n’y a encore une fois rien de spécifique, ce ne sont que des
« morceaux » de droit administratif général.
Par rapport au droit administratif spécial, notamment le droit des propriétés
publiques. Aujourd’hui on ne peut plus affirmer le principe d’inaliénabilité, en effet ce droit
s’est transformé. Il s’agit de faire en sorte que les personnes publiques propriétaires d’un
domaine public puissent valoriser leur domaine financièrement comme pourrait le faire un
propriétaire privé. Il s’agit de faire passer le domaine public des charges aux ressources.
Mais valoriser une propriété inaliénable est complexe, comment faire pour louer ou
vendre ? Des « acrobaties » juridiques ont été trouvées, notamment les PPP, ou les BEA,
catégories mal construites mais impératives dans cette volonté de valorisation économique.
Ce n’est toujours pas stricto sensu du droit public économique, mais bien une part de droit
de la propriété publique.
On peut aussi parler du droit de la commande publique, c’est à dire les règles
applicables aux outils juridiques que sont les marchés publics, les délégations de service
public, etc. Ce n’est pas rien, le poids économique est fort, c’est tout ce que les personnes
morales de droit public achètent pour satisfaire leurs besoins : biens, services, ouvrages,
prestations, etc. Ce sont des règles juridiques assez compliquées, le droit des marchés
publics est compliqué, la mécanique est assez précise.
Le droit des finances publiques enfin, au travers de ce que les économistes appellent
les politiques budgétaires. Si l’État décide de dépenser beaucoup d’argents, cette dépense
va créer de la richesse puisqu’elle va être distribuée sous forme de salaire à des
fonctionnaires qui vont eux-mêmes consommer, mais aussi sous forme de commande
publique. Le problème c’est évidemment que l’État finance ces dépenses. Il faut donc des
ressources que l’État va chercher dans l’économie, à travers notamment les prélèvements
obligatoires, le droit fiscal. On ne parle toujours pas de droit public économique.
La question reste entière, qu’est ce que le droit public économique ? Certains auteurs
ont choisi de ne plus utiliser cette expression, précisément parce que l’on ne sait pas à quoi
cela renvoie. Il y a alors deux possibilités, ou bien ils parlent de droit de l’économie, voir de
droit économique, ou bien ils parlent de droit public des affaires. Donc, à travers ces deux
intitulés, ils prétendent parler des outils juridiques que la puissance publique va créer, et le
cas échéant utiliser, pour intervenir directement ou indirectement dans l’économie.
Cela veut dire que quelque soit le nom, le champ juridique que l’on prétend mettre
en évidence, investiguer, est assez large, et probablement il contient tout ce dont on a parlé.
Il contient potentiellement le droit des affaires, mais aussi le droit de la commande
publique, de la propriété publique. Mais il contient aussi plus que cela, notamment des
outils juridiques qui signalent l’intervention de la puissance publique, le plus souvent de
l’État, dans l’économie.

Cette question de l’intervention de l’État dans l’économie est abordée dans certaines
disciplines de manière frontale et essentielle, notamment en sciences économiques. Pour les
économistes, la question de l’intervention de l’État dans l’économie est centrale : l’État doit
il intervenir ? En simplifiant beaucoup les choses, on sait qu’à cette question la science
économique fournit deux grands types de réponses.
Il y a d’un côté ceux qui pensent qu’a priori l’État n’a pas à intervenir en raison de
l’autorégulation de l’économie sur le marché, l’outil de la régulation étant le prix : à chaque
activité économique correspond un prix. Pour que le marché fonctionne de façon
pertinente, c’est à dire au mieux des intérêts de ceux qui sont présents (offreurs et
demandeurs), il faut s’accorder un prix. Et ce prix va être trouvé spontanément, il n’y a pas
d’alternative : celui qui offre doit vendre, et celui qui demande doit pouvoir acheter. Cette
école de penser est l’école néo-classique qui a produit au XIXème siècle une théorie de
l’équilibre général de l’économie au travers de ces mécanismes de micro arbitrage sur des
marchés successifs, appelé Pareto. Il explique en substance qu’à un moment donné sur un
marché, l’équilibre se fait de telle façon qu’à un moment donné plus personne n’a intérêt à
le modifier, le marché s’auto-équilibre. Il ne faut donc aucune intervention extérieure, cela
ne pouvant qu’empêcher l’équilibre, voir le détruire.
Une autre école considère que le postulat de l’école néo-classique est faux : jamais
dans l’histoire le marché s’est équilibré seul. Or, bien entendu, dans une économie de
marché, les acteurs ont intérêt à ce que le marché s’équilibre, c’est à dire que le prix ne soit
pas déterminé de manière trop arbitraire pour pouvoir réaliser la vente. Cet équilibre ne
peut donc pas se trouver spontanément, quelques fois il est trouvé puis se dérègle, en raison
notamment des variations de l’offre et la demande. La possibilité pour l’offre et la demande
de se régler spontanément est une vue de l’esprit, notamment en raison de l’irrationalité
des acteurs économiques. La grande figure de cette école est Keynes. Il dit tout au long de sa
pensée que l’État doit intervenir dans l’économie au nom de l’intérêt général pour rétablir
les déséquilibres du marché et pour le pousser même à l’équilibre. Il plaide donc pour des
« politiques budgétaires », en cas de dépression il faut que l’État relance la machine avec par
exemple des grands travaux pour réactiver la consommation, donc la demande et l’offre. Ou
bien encore l’État doit intervenir lorsque les prix sont fixés de manières trop arbitraires par
des trop rares offreurs ayant des comportements irrationnels sur la longue période, l’État
doit alors imposé un prix maximum, cela peut passer par techniques fiscales.
Pendant longtemps il y a eu un troisième modèle économique, ou plus exactement
un second puisque ne postulant pas l’économie de marché. L’alternative était celle du plan,
l’organisation de l’activité économique par l’État, ou en réalité le parti politique unique.
C’est le modèle de l’Union soviétique et de ses pays satellites, de même que la République
Populaire de Chine avant son passage dans un système mixte. Ce modèle n’existe
aujourd’hui plus, il n’y a plus de modèle alternatif au marché. Et donc il faut en revenir à
cette opposition à l’intérieur de l’économie de marché entre autorégulation et intervention
de l’État.
Dans la théorie néo-classique, le droit public économique n’a pas de substance. Au
contraire, si c’est la théorie keynésienne qui nourrit la pensée des autorités politiques, le
droit public économique risque d’être assez substantielle. Ce débat sur la place de l’État
dans le fonctionnement économique est aujourd’hui très vif. Les temps que nous vivons
posent avec acuité la question des relations entre les Etats, le pouvoir politique et les outils

juridiques dont ils disposent pour agir, et les marchés, et notamment les marchés financiers.
De ce point de vue, s’interroger sur ce qu’est le droit public économique aujourd’hui est
assez intéressant vue la situation de crise économique, politique peut être demain. Cette
situation pose la question de la capacité de l’État à intervenir, et du coup celle des outils
juridiques qui permettent d’intervenir. La question de l’intervention de l’État peut donc faire
l’objet d’un débat théorique, mais d’autres éléments interviennent : l’État doit il ou peut il
intervenir pour réglementer ou réguler les activités économiques ?
Il y a tout d’abord un paramètre propre à chaque État : son histoire collective.
S’interroger sur le rôle de l’État dans l’économie ne peut se faire sans regarder l’histoire, la
culture, de l’État. Or la culture française est assez largement dominée par l’idée que l’État
est légitime à intervenir dans la vie économique, et qu’il peut intervenir de différentes
façons : en créant des emplois par le développement de la fonction publique, ou en aidant
financièrement à la création d’emploi, les emplois aidés ; en subventionnant des activités
économiques par la distribution d’aides financières, fiscales, en nature, etc. ; en
nationalisant des entreprises, la France a connu trois vagues de nationalisations en 1936, en
1945 et en 1981 (seul exemple d’Europe occidentale), c’est d’une certaine façon la forme
ultime de l’intervention de l’État dans la vie économique. Il peut aussi intervenir en créant
des services publics, et là encore, hors de l’ex bloc soviétique, il y a peu d’États qui ont
autant développé ce mode. C’est dire que le poids de l’État dans l’économie française est
fort. Nous avons même un mot pour cela, c’est le colbertisme. Donc notre culture collective
en France est une culture qui fait place à la fois au fonctionnement du marché, car nous
n’avons jamais été autre chose qu’une économie de marché, avec une forte intervention de
l’État.
Pourtant, Lionel Jospin, alors Premier Ministre, a déclaré que « l’État ne pouvait pas
tout ». De la même manière, dans les années 1970, le marché des magnétoscopes a explosé,
et des entreprises françaises comme japonaises se sont lancés dans la production. Et les
entrepreneurs françaises ont demandé à l’État de protéger la France de cette « invasion ».
Donc, les acteurs économiques, salariés comme dirigeants, ont à l’esprit que l’État doit
protéger. Aujourd’hui, on parle plus volontiers de néoprotectionnisme avec les
problématiques de la TVA sociale, de la fermeture des frontières, du made in France.
Il y a un dernier paramètre, l’aire du jeu du marché c’est aujourd’hui le monde. Le
marché est aujourd’hui mondial - en réalité le marché là où se trouve une demande solvable.
Réglementer ces activités, marchés financiers comme marchés d’économie réelle, ne relève
pas du mondial, pas même du régional, cette capacité est nationale. Donc comment faire
pour que l’intervention économique de la puissance publique soit véritablement efficace.
C’est la problématique actuelle de l’émergence d’une gouvernance économique
européenne. Cela est difficile, par exemple le gouvernement de J. Cameron a refusé. Un
nouveau traité devra donc sans les Anglais. Or il est aujourd’hui clair que le marché ne se
régule pas seul. Certes le marché a des qualités, mais les crises sont nombreuses. L’autorité
publique nationale n’apparaît cependant plus en phase avec les marchés transnationaux.
C’est ce contexte qui va servir de base à notre droit public économique. Ce cours
pourrait d’ailleurs s’appeler de manière un peu caricaturale « marché et droit ».
Mais y a t’il place pour l’hypothèse d’un non droit public économique ? La réponse
est non, l’histoire n’offre pas d’exemple d’un marché qui ne nécessiterait pas d’intervention

économique. Les Etats-Unis, dans la dernière partie du XIXème, s’est développé de manière
sauvage, notamment à travers le chemin de fer. Le chemin de fer est alors vital, il permet le
développement économique, là où il s’installe, l’économie émerge. Problème cependant, les
entreprises qui vont développer ce chemin de fer sont peu nombreuses, deux en réalité, qui
vont finir par fusionner et créer un monopole, c’est-à-dire avoir la main sur le
développement économique. Le pouvoir politique est intervenu pour dire que cette
situation là n’était pas tenable, elle était pourtant le produit du fonctionnement normal du
marché. La Cour Suprême des Etats-Unis va construire une théorie juridique toujours
valable, c’est la théorie dite des « facilités essentielles » : lorsqu’un opérateur économique
détient en position de monopole une infrastructure, ici un chemin de fer, il doit (obligation
juridique) ouvrir son infrastructure aux autres opérateurs économiques. Cette décision
rendue en 1878 sera suivie par une loi fédérale de 1890, dite « Sherman Act », fondement
de la législation anti-trust.
La Cour de justice utilise cette théorie en 1974 dans une décision sur les terminaux
pétroliers. Et même le Conseil d’État français en 2005, dans une décision Union fédérale des
consommateurs, il écrit que l’existence de la concurrence dans le système économique est
une condition de la réalisation de l’intérêt général, elle est d’intérêt public. Donc on voit bien
à travers l’émergence et la pérennité de cette notion de facilités essentielles que même dans
les systèmes où l’idéologie dominante ne remet jamais en cause la pertinence du marché,
l’hypothèse du non droit, de la non intervention de la puissance publique, n’existe pas. La
puissance publique amène le marché à se rééquilibrer à se réorganiser dans l’intérêt
général. Contrairement à ce que pensent les néo-classiques, le marché se rééquilibre
toujours de manière instable, en protégeant toujours mieux certains intérêts.
Autre exemple, dans certains pays ont lieu des émeutes de la faim à cause de prix
ayant trop augmentés, à ce moment là, le constat est un peu le même : le marché a conduit
a une trop grande augmentation, telle qu’une partie de la population ne peut plus accéder à
des ressources de bases. A qui ces émeutes vont elles s’adresser ? Elles ne s’adressent pas
aux entreprises qui augmentent les prix mais bien à l’État qui est sommé de trouvé une
technique juridique pour régler la situation en bloquant les prix, ou en les régulant.
On peut faire raisonnablement l’hypothèse que le droit public économique, ce sont
les méthodes juridiques que l’État va utiliser pour rendre le fonctionnement du marché
politiquement et socialement acceptable.
Si l’on essaye d’appliquer cette proposition à notre histoire, sans remonter trop loin,
en restant dans la période de l’après seconde guerre mondiale, on constate que l’État, en
France, n’a jamais été absent du fonctionnement de l’économie, mais que sa présence a
varié au fil du temps en intensité. A certains moments, l’État est intervenu de façon très
dense, très prégnante dans l’économie, tandis qu’à d’autres il a pris ses distances. La période
d’intervention forte et massive c’est l’immédiat après seconde guerre mondiale, la période
de la reconstruction, il s’agit de reconstruire ce qui a été détruit par la guerre :
l’infrastructure ferroviaire, électrique, la voirie, le logement, etc. Cette période est marquée
par plusieurs difficultés, notamment des pénuries, les tickets de rationnements servant
jusqu’en 1947. Les pénuries ont aussi débouché sur une augmentation des prix empêchant
une grande partie de la population de consommer. L’un des symboles de cette période c’est
l’encadrement des prix, en particulier le prix des céréales. C’est l’époque où on crée des
institutions publiques, offices professionnels, administrant tel ou tel segment du marché.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
1
/
42
100%