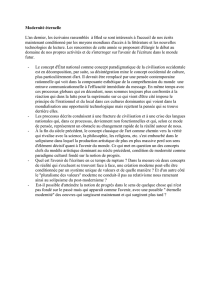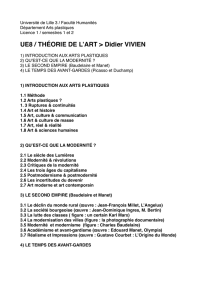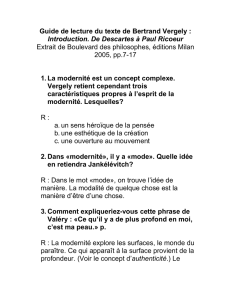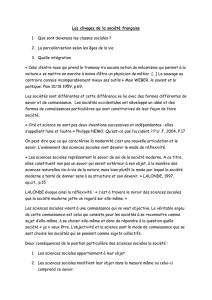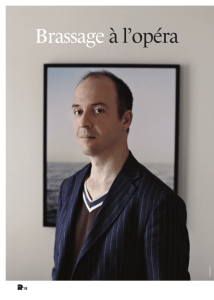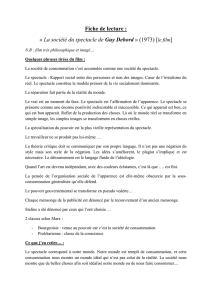La mise en représentation des grands textes : modernité ou

La mise en représentation des grands
textes : modernité ou modernisation ?
Isabelle STARKIER1
’ingénierie culturelle, nous dit-on, étudie les modalités de la mise en œuvre des créations sur
les territoires et les publics. Problème crucial, s’il en est, pour nous, artistes du XXIe siècle,
confrontés à cette question fondatrice du théâtre : à quelle population nous adressons-nous et
comment ? Les modalités de mise en ouvre d’une création posent donc à la fois la question de sa
forme – et de sa communication – mais aussi et surtout la question de son contenu. Et ce, afin de
sortir de la démagogie culturelle la plus répandue qui consiste à confondre populaire et
populisme ; afin de poser autrement le dilemme des collectivités territoriales (ou de l’État) qui
adorent opposer « théâtre commercial » qui remplit (à tort pour les uns, à raison pour les autres)
et « théâtre expérimental » - censé vider les salles pour les uns ou payer l’exigence de ses
prétentions pour les autres.
La modernité ou la modernisation sont des concepts chargés de rendre compte des rapports,
dans le spectacle même, entre texte et contexte, ainsi que dans sa mise en œuvre et sa
communication sur le territoire.
Nous refusons de dissocier ce qui relève d’une philosophie et d’une politique culturelle :
comment amener le grand public – au sens le plus large de la notion de « public » (sans
dévalorisation qualitative au regard du quantitatif) – à la nécessité vitale de l’art théâtral.
Du texte au contexte
Qu’est ce que la mise en représentation sinon la mise en œuvre d’une représentation au sein
même de la société qui la produit et qui la reçoit ? La représentation théâtrale ne se cantonne pas
au texte, mais au contexte qui entoure le texte et sa production. Sa production au sens figuré mais
propre aussi… J’ai mis longtemps à comprendre pourquoi Antoine Vitez prônait, dans Le Théâtre
des idées, l’importance pour un metteur en scène de savoir monter et défendre la production
(financière, logistique) d’un spectacle. Je pense aujourd’hui, à travers mon expérience de directrice
de compagnie, qu’il parlait d’une production d’œuvre au sens propre qui implique la prise en
considération de la production au sens plus vaste et politique de cette même œuvre dans le
territoire. Savoir comment défendre un projet auprès des directeurs de lieux, c’est savoir lier le
propos du spectacle à son incontournable « utilité » pour le public. Et c’est cette utilité, voire cet
utilitarisme là – aussi provocateur soit-il aux oreilles bien-entendantes de l’élite institutionnelle de
notre profession – que nous défendons à notre tour. La mimesis qu’implique la notion de
modernité ou de modernisation entraîne la question de la catharsis, ce qui revient à dire que
1Maître de conférences à l’université d’Evry Val d’Essonne, metteur en scène, directrice de Star théâtre
L

La mise en représentation des grands textes : modernité ou modernisation ?
l’esthétique même du spectacle dépend en grande partie de son éthique et/ou de sa relation avec
la société et le public citoyen qui l’entoure.
Aristote ne se retournerait donc pas dans sa tombe si je disais, en termes actuels de marketing
culturel, que le « conditionnement » de la représentation mêle – en termes purement
commerciaux – la cible et le produit… Il ne s’agit pas de prendre cette idée à l’envers – comme
savent le faire les cinéastes dits « populaires » et qui penchent très nettement vers le populisme –
qui est un dévoiement certain de la démagogie. Nous n’allons pas changer le spectacle ou le
modeler en fonction du goût du public, que nous testerions par des questionnaires à la sortie de
la représentation. Laissons à la télé et à son audimat cette très mauvaise interprétation de la
catharsis…
En tant que re-présentation, j’inclus le destinataire, celui auquel la représentation s’adresse et
sans lequel elle ne pourrait exister – comme simple pièce écrite. La problématique du public est
inscrite, non dans la pièce, mais dans le spectacle et son intrinsèque modernité. Shakespeare était
habile lorsqu’il nommait Hamlet le fantôme du père d’Hamlet, indiquant en cela que – comme le
disait Daniel Mesguich – lorsqu’on joue Hamlet on joue aussi les fantômes des interprétations
passées de Hamlet (Lawrence Olivier…). Les spectateurs sont eux aussi sur le plateau – à jouer
Hamlet et les fantômes de sa représentation.
Voilà pourquoi ils est fondateur et moderne de monter aujourd’hui les « grands textes » du
répertoire – et je plaide ici pour la chapelle, dont je fais partie, des metteurs en scène qui
revendiquent le droit – souvent contesté par les auteurs – de monter « les classiques » afin de ne
pas rendre notre société amnésique et d’offrir à tous l’accès à la mémoire de son humanité. C’est
parce que ces « grands textes » s’ancrent dans la continuité temporelle non du texte même mais
de sa représentation - dans laquelle le texte s’inscrit - qu’on peut les définir comme de « grands
textes ». J’ai fait cette expérience très amusante, au cours de mon enseignement pratique du
théâtre, de travailler l’interprétation de monologues dont le choix, laissé libre aux étudiants, s’était
porté sur des « one-man-shows ». Très vite et d’un commun accord nous avons dû abandonner
un travail d’interprétation et de parti-pris scénique qui repose inévitablement sur la polysémie des
textes, sur la richesse de leurs doubles, triples, multiples lectures. Les monologues incriminés se
consommaient au moment même de leur énonciation mais se périmaient aussi vite que des
yaourts… Or c’est précisément la polysémie scénique qui fonde l’actualité de ces « grands
textes ».
Je m’insurge donc contre l’idée même de « modernisation » de ces pièces. Mettre en complet-
veston Molière ne sert pas nécessairement l’idée de modernité de ce répertoire, modernité qui
s’impose à chaque siècle, à chaque décennie, à chaque minute de l’histoire de nos représentations.
Mais faire de Tartuffe un mollah intégriste en Algérie qui rentre à la tête d’une foule de fanatiques
se flagellant au cours d’une des fêtes religieuses auto-mutilatoires en jetant un « Laurent, serrez
ma hère et puis ma discipline », comme Ariane Mnouchkine ; faire de Chérubin dans Le Mariage
de Figaro un adolescent en chemise à volants et pantalon de jogging, se déhanchant à la manière
des « ados » blasés de notre siècle, comme Christophe Rauck ; ou faire jouer Monsieur de
Pourceaugnac arrivant de Limoges et se faisant rejeter par la « famille (maffieuse) » parisienne qui
ne veut pas d’un prétendant étranger par un comédien noir antillais, comme je l’ai fait dans
Monsieur de Pourceaugnac : voilà quelques mises en représentation qui fondent la modernité des
grands textes.

Isabelle Starkier
3
Le théâtre n’est pas un musée et les pièces de théâtre ne sont ni des archives ni des
témoignages anthropologiques. Travailler aujourd’hui sur la tragédie grecque, ce n’est pas
travailler sur sa représentation ethnologique. Le chœur n’est plus ce chorus sacré, emblème d’un
rite religieux dansé et chanté qui nous échappe – mais dont ni le signe ni le sens n’échappait aux
spectateurs grecs qui s’enfuyaient de terreur à l’apparition du chœur des Erynies. Le chœur de la
tragédie grecque aujourd’hui renvoie à l’interrogation vivante du sens, de la signification
profonde, inconsciente de la collectivité qui se rassemble (chœur politique, chœur sportif…) et
aux musiques (re)sacralisées - des gospels aux raves. Ce contexte – qui n’est pas à montrer ou à
monter mais à dé-signer dans les signes de la représentation, inscrit le texte dans les enjeux de sa
modernité… Le contexte n’est pas à prendre au sens étroit (contextuel !). Nul besoin de
transposer dans les époques modernes pour moderniser. La modernité est ce en quoi le texte fait
écho pour un spectateur aujourd’hui : ce en quoi il peut comprendre et reconnaître ses propres
codes, ceux qui le font résonner et font résonner sa culture, au sens large du terme. Je n’en veux
pour exemple que Benno Besson montant lui aussi Tartuffe, empli d’une humanité gloussant et
caquetant comme un poulailler. Dans ce regard sur la société, Tartuffe lui pose – et nous pose –
la question d’une supercherie « bling-bling » ou sociale, problème que Molière se posait
probablement très différemment en dénonçant la dictature des prélats, la dictature des religieux,
la dictature de Dieu – et là encore je repars sur une lecture moderne de la représentation pour un
public concerné par l’intégrisme montant…
La mise en œuvre sur le terrain
La question de la mimesis une fois abordée, la catharsis nous renvoie au public qui est en effet sur
le plateau mais aussi – avec un peu de chance – dans la salle. Affirmons haut et fort que les
modalités de « communication » d’une œuvre à un public font partie de l’œuvre elle-même – au
sens opératoire du terme- et doivent donc être artistiques. Ce qui implique une véritable
révolution dans le système de l’institution culturelle. Les théâtres nationaux, les scènes nationales
et les centres dramatiques regorgent d’administratifs, relations publiques, directeur de
communication, etc. mais pas ou si peu d’artistes permanents. La plus grosse partie des budgets
est mis sur l’administratif et non sur l’artistique. Nous sommes dans une logique de
consommation : on achète un « produit » pour le vendre au public… ou on cherche à « remplir »
les salles – avec ce que ça implique de définition de « l’audimat artistique » (faire ce qui plaît entre
autres…), et à convaincre de l’extérieur de l’œuvre elle-même, sans impliquer dans un même geste
artistique la représentation et sa mise en œuvre. « Ce n’est pas pour nous », disent la plupart des
associations ou structures des villes que nous avons rencontrées en parlant du théâtre, et souvent
d’un théâtre au label institutionnel. « Ce n’est pas pour nous » : cela signifie « ce n’est pas fait,
conçu, pensé pour nous », qui nous ramène au concept même de la représentation que nous
avons abordé en première partie mais aussi aux signes artistiques qui entourent, enveloppent et
déterminent, inscrivent, définissent l’œuvre représentée parmi ceux pour qui elle se représente – à
savoir tous les publics confondus.
Revenons alors aux acteurs de terrain, au sens propre du terme : les véritables acteurs de terrain,
ceux d’une troupe qui pratique non pas une action socio-culturelle pour un public ciblé afin de

La mise en représentation des grands textes : modernité ou modernisation ?
l’occuper ou de le convaincre de « se laisser tenter » et de « se risquer » à venir dans l’antre sacrée
du théâtre où opèrent les vrais prêtres de l’art théâtral, mais qui pratique un seul et même travail
d’artiste autour d’une représentation dans ce qu’elle implique nécessairement et par définition de
mise en œuvre… sur le terrain. Parler d’un spectacle ne sert pas, à mon sens, à grand-chose – à
plus forte raison quand on en parle de l’extérieur. Je rechigne souvent moi-même, en tant que
metteur en scène, à aller « parler » aux classes d’un spectacle qu’ils vont voir. J’aime en parler
après, dans l’espace citoyen du débat et de la réflexion où nous ont conduit le rire et l’émotion du
spectacle. Parler, c’est du sens, du discours, de la raison, de la communication. La représentation
crée des signes, de l’imaginaire, de la communion par le rêve… C’est ce fil là qu’il faut suivre et
enrouler tout autour des représentations au sein d’une théâtre : en exportant les représentations
hors les murs, en menant un travail de résidence qui tisse inextricablement des liens entre
amateurs et professionnels autour de productions qui sont développées ici (au théâtre) et là (dans
la ville) dans un même concept, un même désir, une même vision…
Le « remplissage » des salles renvoie donc à un problème autrement plus existentiel que du
simple marketing : à quoi sert le théâtre et à qui s’adresse-t-il ? Double question qui touche à la
modernité de la représentation et donc des publics, publics pluriels comme les strates de lecture
d’une œuvre doivent l’être. Molière le savait bien qui touchait à la fois le parterre composé
d’artisans, de valets, de gens du peuple debout et les loges des aristocrates et des bourgeois.
Adressons nous au « Japonais du troisième rang », comme le serinait Pierre Debauche (faisant
allusion à un Japonais qui avait suivi plusieurs représentations et qui, lorsque Pierre, un peu
intrigué, l’avait interrogé sur son intérêt pour le spectacle avait décrypté tous les signes, les plus
cachés, de la mise en scène), comme au scolaire, casquette vissée sur la tête et walkman branché
(mais quelle victoire quand il l’enlève au bout de dix minutes de représentation). Adressons-nous
au retraité habitué souvent à aller voir des « grosses machines » au théâtre Michel ou Antoine
(parce que c’est là que le service des personnes âgées d’une ville l’emmène…) comme à
l’enseignant qui a la mémoire du spectateur (de tous les spectacles vus et engrangés), etc. La
question des codes et de l’accessibilité nous renvoie une fois de plus à notre travail d’artiste, et
renvoie les structures à une véritable réflexion sur leur programmation et sur leur… mise en
œuvre.
L’opposition ou la défense que certains programmateurs mettent en avant en décrivant les
deux camps opposés du théâtre « commercial » dit « populaire » et d’un « théâtre exigeant » (donc
« de qualité ») qui peut par conséquent se revendiquer expérimental – tant il touche peu de
monde, ou qui en tout cas vide les salles (comme on a pu le voir une année terrible au Festival In)
nous ramène à la définition même du théâtre populaire. Le théâtre populaire n’est en aucun cas
un théâtre populiste qui va chercher le « peuple » avec ce que l’on croit être son humour et son
langage. La véritable exigence d’un théâtre populaire, c’est d’inclure la multiplicité des codes de
notre société, de ses populations donc de ses publics – de TF1 à Arte-deuxième partie de la
nuit… En cela le théâtre est plus fort que la télévision : il ne cible pas, il rassemble et il rassemble
dans un même geste universel. Les farces de Molière (encore lui !) ou les pièces de Shakespeare,
avec leurs double sens et leurs jeux de mots, servaient à la fois le bas et le haut, le graveleux et le
mystique. La polyvalence d’une représentation est le gage de son exigence, celle du fameux
« théâtre élitaire pour tous » qu’avait défini Antoine Vitez au théâtre des Quartiers d’Ivry. Et qui
dit polyvalence sémiotique ne veut pas dire contextualité facile pour autant : l’univers fantastique

Isabelle Starkier
5
de Benno Besson faisait appel à tous les imaginaires infantiles et inconscients – du manœuvre à
l’énarque ; l’univers volontairement anachronique et gaguesque de Peter Sellars touche tous les
publics – de la vendeuse au cadre supérieur.
Ne soyons pas démagogique, soyons pédagogique. Lorsque j’ai monté Le Bal de Kafka, j’ai
volontairement choisi, moi qui suis une « accro » de Kafka dont j’ai eu l’opportunité durant ou
grâce à mes études de lire la totalité de l’œuvre, une comédie contemporaine qui parle de Kafka :
de sa vie (à partir de ce qu’il en a raconté), de ses soucis quotidiens à la Woody Allen avec sa
famille et sa fiancée, de son malaise de juif tchèque et aussi de jeune et enfin d’artiste – tous
problèmes si proches de tous et que Kafka, lui, transcende dans l’écriture dont on entend les
continuels bribes sur le plateau. C’est à la fois – c’est en tout cas ce que nous ont renvoyés les
spectateurs – un accès à l’œuvre de Kafka pour ceux qui ne le connaissent pas et un nouvel
éclairage apporté à son œuvre – pour ceux qui en sont férus. Kafka, c’est nous, c’est pour nous,
c’est à nous – et à nous tous… À moi et à mon équipe de comédiens, décorateur, costumière… le
devoir de l’offrir à tout le monde, y compris dans la mise en œuvre de la représentation sur les
territoires où nous l’avons joué (en allant vers les publics en amont et en aval de la représentation
au théâtre).
La recherche d’une véritable modernité artistique est donc incluse dans le geste de la création
elle-même qui définit la générosité d’un théâtre (teatron) d’où l’on voit le monde et où tout le
monde voit.
En ce sens, le théâtre est un outil militant actif (contre la passivité consommatrice) de la
démocratie. C’est là où « çà » se joue : il est politique parce qu’impliqué dans les affaires de la cité
(« le théâtre, à quoi ça sert ? »), il est universel parce qu’il transcende les classes et les frontières -
ce qui à l’heure de l’Europe nous interpelle particulièrement, enfin il est à la fois pédagogique et
thérapeutique, au sens noble de ce que la catharsis implique ou de ce que Schopenhauer explique
lorsqu’il dit que « Ne pas aller au théâtre, c’est comme faire sa toilette sans miroir »… Bref, le
théâtre s’affirme, à l’encontre de la mode actuelle, comme un art moderne, total et populaire.
1
/
5
100%