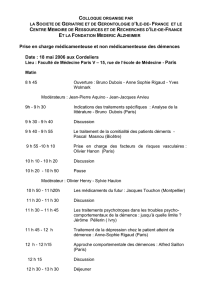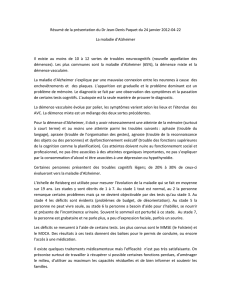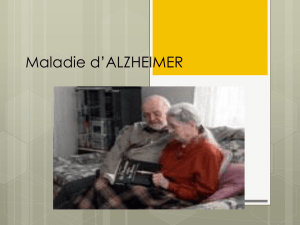Le traitement pharmacologique de la maldie d`Alzheimer

LES DEMENCES DEGENERATIVES :
LE TRAITEMENT, LES ASPECTS ETHIQUES ET ECONOMIQUES.
Prof. J.M. Maloteaux
Unité de pharmacologie, UCL et Service de Neurologie, Cliniques universitaires St Luc,
B-1200 Bruxelles.
Les démences sont des affections fréquentes, liées à l’âge. Les étiologies sont le plus souvent
dégénératives ou vasculaires. Parmi les démences dégénératives, la plus fréquente est la
maladie d’Alzheimer. On la distingue des démences fronto-temporales, des « maladies à corps
de Lewy diffus » et d’autres affections plus rares ou qui touchent moins spécifiquement le
cortex cérébral (anciennement appelées démences sous-corticales). C’est essentiellement la
pharmacothérapie de la maladie d’Alzheimer et certains aspects éthiques et économiques qui
y sont liés qui seront discutés ici.
La maladie d’Alzheimer.
L’incidence de la maladie d’Alzheimer augmente nettement avec l'âge et c’est la démence la
plus fréquente dans les pays développés. La maladie d' Alzheimer est une affection
dégénérative qui, jusqu’à présent, ne peut être ni guérie ni prévenue mais nous avons depuis
quelques années des traitement symptomatiques, essentiellement des médicaments
anticholinestérasiques à action centrale et des médicaments anti-glutamatergiques. Ces
médicaments ne sont pas des neuroprotecteurs susceptibles de ralentir la progression de la
maladie. Les anticholinestérasiques compensent partiellement le déficit cholinergique qui
caractérise la maladie, mais qui n'est certainement pas la seule altération neurochimique
présente dans cette affection. Les molécules anti-glutamatergiques visent à réduire l’effet
excito-toxique exercé par le glutamate en excès, sur les neurones corticaux via des récepteurs
spécifiques.
La maladie d’Alzheimer n’est pas liée des troubles vasculaires et aucun traitement récent ne
revendique un effet sur la vascularisation ou le débit sanguin comme tel, alors que la plupart
des médicaments que nous utilisions il y a plus de dix ans étaient censés améliorer la
perfusion cérébrale. D’autres étaient réputés agir sur le métabolisme cérébral mais il faut
souligner qu’aucun de ces médicaments anciens n’a fait l’objet d’études telles que les exigent
actuellement les autorités chargées de l’enregistrement des médicaments.
On peut distinguer dans le traitement de la maladie d’Alzheimer les médicaments ayant un
effet symptomatique sur les troubles cognitifs de ceux qui ont des effets sur les symptômes
d’accompagnement fréquents, mais non spécifiques aux syndromes démentiels (dépression,
agitation, troubles du sommeil…).
Parmi les médicaments susceptibles d'agir sur les troubles cognitifs et la détérioration
intellectuelle, on trouve essentiellement les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase et un
inhibiteur glutamatergique (mémantine), tous approuvés par la FDA (Food and Drug
Administration) et l'EMEA (European Medicines Agency). A côté de ces
anticholinestérasiques et antiglutamatergiques, certains médicaments présenteraient une
tendance à réduire les symptômes mais l'effet est jugé insuffisant et ils ne sont pas enregistrés
dans cette indication (vitamine E, sélégiline, nicergoline, propentofylline..) tandis que pour
d’autres, l’efficacité est très faible et controversée (extraits de ginkgo biloba).
Les inhibiteurs des cholinestérases (donepezil, rivastigmine, galantamine).
1

Les preuves d'un déficit cholinergique dans la maladie d'Alzheimer, et dans les troubles de
l'apprentissage chez l'animal ou chez l'homme sont établies depuis plus de vingt ans.
L'innervation cholinergique du cortex, à partir de noyaux sous-corticaux (noyaux de
Meynhert) est très importante. La densité des récepteurs cholinergiques est élevée dans le
cortex cérébral et ils interviennent dans de très nombreuses fonctions, en particulier
l'apprentissage, la modulation de l'activité limbique et le maintien de la vigilance. L'efficacité
des médicaments anticholinestérasiques n'a été démontrée que depuis quelques années. La
première publication par Summers et al. en 1986 était exagérément optimiste et fut très
contestée. Durant les dix années suivantes, l’efficacité des anticholinestérasiques fut très
controversée et il fallut attendre deux études cliniques rigoureuses, contrôlées qui furent
menées en 1992-94 pour admettre le bénéfice modeste d’un inhibiteur de la cholinestérase. Le
premier médicament introduit, et aujourd'hui pratiquement abandonné en raison de sa toxicité
potentielle, fut la tacrine ou tetrahydroaminoacridine (cognexR). Plus récemment, le donepezil
(1998), la rivastigmine (1998/99) et la galantamine (2000/01) ont montré une efficacité
comparable à la tacrine mais une plus grande sécurité d'emploi et des effets indésirables
moins nombreux (1, 3, 4, 7).
Il existe quelques différences entre ces trois médicaments (donepezil, ariceptR ; rivastigmine,
exelonR ; et galantamine, reminylR) en ce qui concerne leur durée d'action, leur
biodisponibilité ou leur métabolisme mais on peut retenir que dans tous les cas, ces
médicaments ont été étudiés de façon rigoureuse, dans des études cliniques contrôlées, au
moyen d'échelles cliniques validées et les résultats des études cliniques sont très comparables.
Ces médicaments répondent aux critères de l'"American Academy of Neurology" ; ils ont un
effet symptomatique (faible et pas chez tous les patients) sur les fonctions cognitives, le
comportement, l'attention. Les effets sont dépendants de la dose, ils persistent durant le
traitement pendant une période de l'ordre d'un an mais ils n’empêchent pas la maladie de
poursuivre sa progression. L'effet est supérieur à celui d'un placebo. Les effets indésirables
sont surtout digestifs mais rarement sévères : nausées, vomissements, anorexie, crampes
abdominales, perte de poids, diarrhées. Les effets cholinomimétiques peuvent aussi entraîner
du tremblement, des crampes musculaires, des myalgies, une hypersudation. Rarement
peuvent survenir des troubles du sommeil, des céphalées. Les effets indésirables nécessitent
parfois un arrêt de traitement ou une réduction de dose mais ceci est peu fréquent. Parmi les
contre-indications ou précautions à prendre, citons les troubles du rythme cardiaque, l'ulcère
digestif, l'asthme, les antécédents de convulsions. L'association aux médicaments
anticholinergiques (et aux antidépresseurs qui ont des effets anticholinergiques) est à éviter
puisque les effets sur le système cholinergique sont alors opposés !
Les traitements par médicaments anticholinestérasiques au cours des études cliniques initiales
ont eu lieu sur des périodes de quelques mois. Des évaluations plus prolongées ont montré
que l'effet bénéfique ne durait guère plus d'un an. Au-delà d'un an de traitement, la maladie a
vraisemblablement progressé de telle sorte que la symptomatologie clinique est réapparue, ce
qui fait dire parfois que le traitement permet de « retarder d'un an » les manifestations de la
maladie, mais ceci ne doit pas être interprété comme un traitement protecteur (1,3,7). Les
raisons pour lesquelles les effets du traitement sont modestes et ne se maintiennent pas sont
multiples : la progression des processus dégénératifs et de la perte neuronale, la progression
de déficits neurochimiques qui ne sont pas de nature cholinergique, la dégénérescence
éventuelle des cellules corticales cibles de l'innervation cholinergique.
De plus, le déficit cholinergique n'est pas équivalent chez tous les patients atteints de maladie
d'Alzheimer, il n'intervient pas dans la composante vasculaire de la démence mais pourrait au
contraire être plus important dans certaines démences d'un autre type telles les démences à
corps de Lewy dans lesquelles quelques études ont montré un bénéfice très significatif de la
rivastigmine.
2

Les médicaments anticholinestérasiques exercent leurs effets via une stimulation du système
cholinergique et on a longtemps pensé que le système le plus important au niveau cortical
était le système muscarinique parce que les récepteurs muscariniques sont très abondants dans
le cortex et parce que la scopolamine (inhibiteur muscarinique) perturbe l'apprentissage. Le
rôle des récepteurs nicotiniques est certainement très important également et le nombre de
ceux-ci est diminué dans la démence d’Alzheimer. La galantamine est un
anticholinestérasique qui possède en outre un effet allostérique positif sur les récepteurs
nicotiniques et la stimulation cholinergique pourrait donc être plus marquée. Les résultats
cliniques ne démontrent cependant pas jusqu'à présent de supériorité de la galantamine sur les
autres anticholinestérasiques.
Les anticholinestérasiques sont également utiles dans la maladie à corps de Lewy diffus
(« diffuse lewy body disease ») et selon certaines études dans les démences vasculaires.
L’intérêt dans les démences vasculaires est inattendu car la physiopathologie dans ce cas n’est
pas caractérisée par un déficit cholinergique marqué. Récemment, un bénéfice a été rapporté
dans la démence associée à la maladie de Parkinson (5). D’un point de vue thérapeutique cela
rejoint l’observation que les troubles confusionnels et cognitifs des parkinsoniens sont accrus
par les atropiniques mais par contre, ces atropiniques restent indiqués pour traiter la maladie
de Parkinson lorsque le tremblement est présent précocement.
Les médicaments anti-glutamatergiques
Le système glutamatergique est complexe : le glutamate est un acide aminé excitateur
très abondant dans le système nerveux central dont la libération est très contrôlée. Plusieurs
récepteurs sont impliqués dans la réponse pharmacologique (4) : des récepteurs ionotropes
(canaux ioniques) dont le récepteur NMDA impliqué dans la potentialisation à long terme
(LTP) qui sous-tend la mémoire à court terme, les récepteurs AMPA qui influencent la
libération d’acétylcholine, mais aussi des récepteurs métabotropiques (couplés aux protéines
G) dont les rôles sont complexes. Les sites de recapture du glutamate (ou transporteurs) sont
essentiels car leur insuffisance ou leur dysfonctionnement se traduira par une excitotoxicité
accrue. Ces sites de recapture se situent surtout sur des cellules gliales et le métabolisme de la
glie est donc également impliqué dans le fonctionnement global du système. Parmi les pistes
théoriques, dont certaines ont débouché sur des études cliniques, on retiendra donc l’intérêt
de médicaments qui freinent la libération du glutamate, de bloqueurs (partiels) du récepteur
NMDA, d’agonistes (ou agonistes partiels) du récepteur AMPA, de stimulateurs de la
recapture du glutamate ou du métabolisme glial. Les études sur animaux transgéniques ou sur
divers modèles sont très intéressantes mais jusqu’à présent, seul le blocage relatif du récepteur
NMDA s’est traduit par un intérêt thérapeutique : la mémantine (ebixa®), un dérivé de
l’amantadine, a montré un effet significatif dans le traitement de la démence d’Alzheimer, en
particulier dans les formes sévères. On peut évidemment s’interroger sur la signification
clinique d’un effet statistiquement positif au stade avancé de cette maladie : y a t’il vraiment
amélioration de la qualité de vie, de l’autonomie, des possibilités de communication dans la
vie quotidienne ?
Traitements symptomatiques des troubles cognitifs : effets modestes, coût élevé
Quel que soit le médicament utilisé, l’effet obtenu est faible. L’utilisation d'échelles précises
ne montre que de petites différences entre les patients traités ou pas, au cours des études
cliniques : en six mois de traitement, la différence sur l'échelle MMSE est 1,2/30 par rapport
au placebo et dans l'échelle ADAScog elle est de 2,5/70. L'évaluation précise du bénéfice du
traitement est donc difficile et est elle-même coûteuse car elle exige un examen clinique et
3

neuropsychologique prolongé. Exprimé en terme de NNT (number needed to treat), le résultat
est aussi modeste : il faut traiter 9 patients avec le donepezil (ou un autre dérivé
anticholinestérasique) pour observer une amélioration significative telle que définie dans
l’étude, chez un seul patient (pour une amélioration de 21% des patients effectivement traités
comparée à l’amélioration de 10% de sujets sous placebo ; 11% = 1/9, effet statistiquement
visé). Par rapport à divers médicaments psychotropes, ce résultat est très faible et signifie un
coût réel élevé représenté par le traitement inefficace de 8 patients sur 9.
Les nouveaux médicaments anticholinestérasiques sont coûteux, le bénéfice est modeste et
transitoire et la population susceptible d'être traitée est vaste. Le rapport bénéfice/coût est
considéré comme faible par divers experts et a récemment fait l’objet d’une publication très
controversée (expertise NICE, National Institute for Clinical Excellence : www.nice.org.uk) ,
qui concluait à un rapport bénéfice/coût défavorable avant d’émettre des conclusions un peu
plus positives en mai 2006. En Belgique, un remboursement sous conditions (évaluation
neuropsychologique, diagnostic précis, bilan fonctionnel...) a été autorisé depuis quatre ans et
les procédures de remboursement ont été simplifiées. Assez logiquement, les patients
"modérément" atteints (MMSE entre 12 et 24/20) chez lesquels le diagnostic a été posé de
façon documentée, ont bénéficié d'un remboursement pour une durée renouvelable si les tests
indiquent que les fonctions intellectuelles sont stables ou seulement légèrement dégradées.
Les effets thérapeutiques de ces médicaments, s’ils sont modestes, satisfont cependant aux
recommandations publiées par les autorités chargées de l’enregistrement (EMEA pour
l’Europe, Note of guidance concerning the treatment of Alzheimer disease) et ces exigences
ont indiscutablement relevé le niveau d’efficacité thérapeutique et permettent actuellement de
prescrire de façon plus rigoureuse. On peut se demander si les recommandations, telles les
« guidelines de l’EMEA », sont suffisamment exigeantes : ne devrait-on pas viser un résultat
cliniquement plus significatif (sur base d’échelles cliniques, de qualité de vie, de satisfaction
des soignants…) plutôt que statistiquement significatif en fonction du but ou «end point»,
préalablement fixé.
Le coût élevé des nouveaux médicaments est en partie lié aux exigences des autorités
compétentes des différents pays membres et des instances de l’Union Européenne, des Etats-
Unis ou du Japon. Le prix des médicaments est la conséquence des études complexes et
rigoureuses imposées, par contre leur taux de remboursement et les critères de remboursement
sont propres à chaque pays, à son niveau économique et à ses priorités en matière de santé.
Signalons enfin que le soutien psychologique et les traitements non médicamenteux sont très
importants et que des simples mesures telles qu’une augmentation de l’activité physique
modérée (marche régulière par exemple) se traduisent par un bénéfice cognitif démontré par
des études rigoureuses et des publications sérieuses et récentes.
Le traitement des symptômes d’accompagnement
Les plaintes principales dans la maladie d’Alzheimer sont les troubles de mémoire et les
déficits cognitifs, ce n’est pourtant pas cela qui constitue la principale cause
d’institutionnalisation mais bien les troubles du comportement. On tolère et on entoure un
patient calme amnésique et partiellement aphasique mais on ne peut pas surveiller
constamment et protéger un patient agité, halluciné, qui circule la nuit, crie ou fugue
régulièrement… Les troubles du comportement accompagnent la maladie d’Alzheimer à des
degrés divers, ce qui a donné naissance au concept de « Behavioral Psychological Syndrom of
Dementia » ou BPSD. Il est certain que divers psychotropes (antidépresseurs, anxiolytiques,
neuroleptiques…) sont très utiles dans certaines phases de la démence : ils réduisent l'anxiété,
les troubles comportementaux, l'apathie ou la dépression qui sont très souvent associés à
4

certains stades de la maladie. Récemment, une polémique est apparue concernant la sécurité
d’utilisation de neuroleptiques atypiques (risperidone, olanzapine) dans le traitement de
l’agitation chez des patients déments car une incidence plus grande d’accidents vasculaires
cérébraux a été rapportée chez les patients traités avec ces médicaments. Les nouveaux
neuroleptiques ne semblent pas supérieurs aux anciens et leur utilisation ne doit en tous cas
pas être prolongée. Les positions divergentes prises par différentes autorités ou experts
indiquent que la question du risque induit par les neuroleptiques atypiques chez les sujets âgés
n’est pas clairement résolue.
Les promesses et les dangers de la « vaccination thérapeutique »
Une étape très importante fut franchie en 1999/2000 lorsque des modèles de souris
transgéniques furent mis au point à partir du gène d’une forme familiale de la maladie
d’Alzheimer. Ces animaux ont montré des anomalies histologiques mais aussi des troubles de
l’apprentissage. Ce même modèle a été utilisé pour tester l’intérêt d’un vaccin thérapeutique
et le résultat s’est montré très prometteur car le vaccin permettait une réduction des dépôts
d’amyloide et une réduction des troubles d’apprentissage (3,6,8).
Très rapidement, trop rapidement disent certains, une étude clinique a démarré pour vérifier
que cette « vaccination » permettait une réduction des troubles chez les patients. De toute
l’histoire des études cliniques chez des patients déments, aucune n’a vu l’inclusion aussi
rapide d’un grand nombre de patients. La pharmacovigilance très efficace au cours de cette
étude clinique a rapidement indiqué plusieurs cas de méningo-encéphalite et l’étude fut
interrompue d’urgence, mais plusieurs cas d’encéphalite furent encore enregistrés par la suite
(6% des patients inclus en furent atteints après un délai moyen de 75 jours). Certains malades
ont gardé des séquelles. Un patient est décédé et l’autopsie révèlera une encéphalopathie
proche des vasculites d’origine immunologique (de type ADEM) survenant de façon moins
aiguë. Dans l’ensemble, les troubles cognitifs n’ont pas été améliorés, les patients ont bien
développé des anticorps anti-amyloïde mais la persistance de lésions histopathologiques
(dégénérescences neurofibrillaires, dépôts péri-vasculaires de substance amyloïde)
indiqueraient plutôt l’importance cruciale des protéines Tau. Certains experts affirment que
les dépôts amyloïdes sont une conséquence de la pathologie mais pas l’élément
physiopathologique essentiel. Cette théorie a reçu un important support lorsque, très
récemment, des chercheurs ont montré que dans la chorée de Huntington, les dépôts de
protéines pathologiques sont la traduction de la résistance cellulaire au processus
pathologique et que ces dépôts ne sont pas les éléments initiaux de la dégénérescence
neuronale. Les hypothèses concernant le rôle de ces dépôts dans les pathologies dégénératives
restent très controversées.
Autres possibilités pharmacothérapeutiques : perspectives et contradictions.
Les dérivés oestrogéniques. Diverses données expérimentales et épidémiologiques ont
supporté pendant des années la probabilité d’un effet favorable, protecteur, des oestrogènes
chez les patientes susceptibles de présenter une démence et des études cliniques ont démarré
avec des substituts oestrogéniques ou des dérivés de type raloxifène. Les publications récentes
des études de substitution hormonale réalisées chez les femmes ménopausées (one million
women study/WHI) apportaient une brutale déconvenue : le traitement par substitution
hormonale n’apporte aucune protection et on a au contraire mis en évidence des risques
accrus (pathologies cardio-vasculaires, cancers de sein…) qui ont conduit à limiter très
fortement ces traitements alors qu’on les encourageait depuis plus de vingt ans.
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%