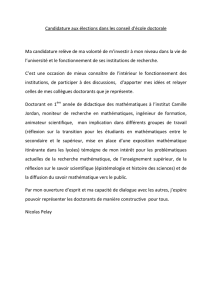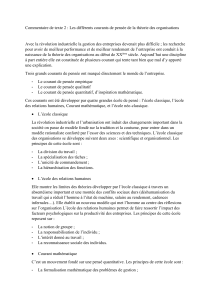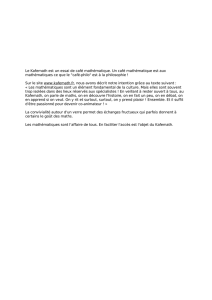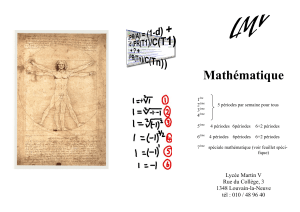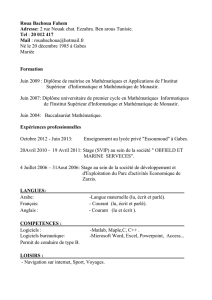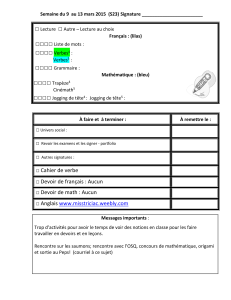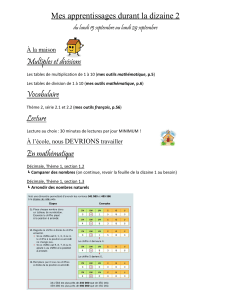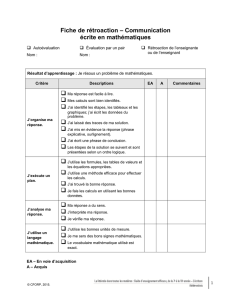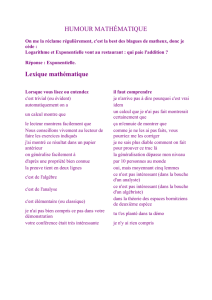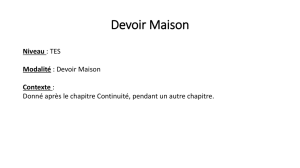texte en PDF - Intellectica

1
Le continu mathématique :
nouvelles conceptions, nouveaux enjeux
Les grands paradigmes
Les grands paradigmes qui s’affrontent dans le champ des sciences cognitives se
laissent volontiers définir comme des façons de mettre les mathématiques au
service d’une science de l’esprit.
Le cognitivisme, défini comme un fonctionnalisme computo-représentationnel,
s’est fondé, à l’origine, sur l’analogie de l’esprit et de la machine de Turing, la
boîte noire du mental étant supposée obéir au modèle du calcul logico-symbolique,
c’est-à-dire à l’hypothèse que les rôles causaux sont des rôles computationnels
opérant sur des symboles d’un langage interne. En postulant que les
représentations sont indépendantes, dans leur structure formelle et leur contenu
informationnel, de leur implantation dans le substrat physique, le cognitivisme est
contraint de souscrire à un dualisme entre le physique et le symbolique. Par
ailleurs, en postulant l’existence de représentations mentales neurobiologiquement
implantées dans des états cérébraux et la nature symbolique de ces représentations
mentales, le cognitivisme obéit à un réductionnisme du cognitif au symbolique.
Comment, dès lors, s’étonner du discrédit qui frappe ces approches mentalistes,
dualistes et réductionnistes ? Notons, toutefois, que le cognitivisme sert de
repoussoir commode aux approches concurrentes et, en particulier, que
l’antilogicisme légitime que celles-ci véhiculent confine souvent, si l’on nous
permet cette formule, à l’(antilogic)isme, c’est-à-dire conduit à denier à la logique
la possibilité de jouer quelque rôle que ce soit dans la modélisation en sciences
cognitives.
Les approches dynamicistes, adossées, entre autres, au rejet du cognitivisme, se
sont, ipso facto, démarquées du primat théorique de la logique et plus
généralement des mathématiques discrètes dont le cognitivisme avait cru pouvoir
se suffire. Ces approches dynamicistes ont, a contrario, mobilisé les
mathématiques continues au travers des modèles d’auto-organisation, des modèles
physiques de l’émergence et des modèles de la théorie des catastrophes de Thom
et Zeeman. L’un des éléments de l’attrait de ces approches est l’ancrage
neurophysiologique supposé de ces modèles dynamiques : un système dynamique,
modélisant telle ou telle activité mentale, est supposé avoir un « répondant »
cérébral. Il est évident que la référence des modèles dynamicistes aux neurones et
aux liens synaptiques plaide en faveur d’une certaine plausibilité neurobiologique
à laquelle les approches cognitivistes, qui font de l’activité mentale un simple
commerce informationnel, ne peuvent prétendre.
Pour ce qui concerne le rôle joué, ici, par les mathématiques – en l’occurrence les
mathématiques continues – et les enjeux cognitifs inhérents aux choix des
modèles, un élément fondamental du débat, curieusement peu commenté, est le
suivant : les outils de la théorie des systèmes dynamiques, de la théorie des
singularités, de la théorie des catastrophes ne sont pas de simples modèles ; ils
sont des constituants de ces approches. Au fond, si ces approches peuvent être
qualifiées, comme on le fait souvent, de naturalisantes, c’est qu’elles plaident, de
façon plus ou moins explicite, pour une unité des mathématiques et de la physique

2
(et de la biologie). Ce réalisme majuscule, outre qu’il tranche le débat inauguré par
la naissance de la physique (comment faut-il interpréter les modèles
mathématiques de la physique ?), impose au réel d’être continu en son essence.
Un autre aspect de l’attrait exercé par les modèles continuistes est le rejet, déjà
mentionné, du logicisme des approches cognitivistes. Mais le clivage logique-
dynamique ne doit pas être confondu avec l’opposition continu-discret : un
système dynamique peut parfaitement être discret et tous les ingrédients du
dynamicisme (état, trajectoires, attracteurs, …), schèmes théoriques majeurs de la
modélisation, ont un pendant discret. L’arrimage du dynamicisme à la physique
fait que les modèles proposés sont ceux de la physique mathématique qui se
déploient sur des espaces (espace euclidien, espace de Hilbert, …) qui
« ressemblent », au moins localement, à l’ensemble de réels ou à l’une de ses
puissances. Le dynamicisme est, dès lors, contraint d’adopter une ligne hautement
anti-constructive. Toutefois, la ligne de clivage réalisme-constructivisme n’épouse
nullement aucune des deux oppositions logique-dynamique et discret-continu :
d’une part, rien ne s’oppose, dans le principe, à l’élaboration d’une physique
discrète et/ou constructive (les développements récents en théorie des cordes et en
géométrie non commutative vont dans ce sens) ; d’autre part, continu et anti-
constructifs ne sont nullement synonymiques : le constructivisme intuitioniste a
toujours revendiqué son inscription au sein des mathématiques continues.
Les approches naturalisantes ne sont pas les seules à revendiquer leur adhésion au
dynamicisme continuiste. La théorie des formes sémantiques de Cadiot et Visetti
(2001) consiste en une approche « culturalisante » qui, bien qu’elle n’envisage
pas, a priori, de se soumettre à une modélisation mathématique, obéit à un
dynamicisme herméneutico-continuiste. Bien que non directement guidée par la
question du continu, mais par celle des formes en sémantique, la théorie établie
par Cadiot et Visetti plaide pour un recours au continu, notamment comme fond
intuitif de la saisie du sens. Le continu est pour la sémantique la première des
ressources puisque les langues et les discours le créent, le déploient et le
présupposent d’une multitude de façons : expérientiels-corporels, pratiques-
sémiotiques, textuels, etc. (Visetti, 2004). Pour reprendre les propos des auteurs, le
recours au continu est exigé par (i) la primauté de leur concept de champ, (ii) le
privilège accordé aux descriptions inspirées de celle de l’être-au-monde, considéré
comme l’« emblème » d’un modèle indéfiniment transposable, (iii) le primat de la
perception c’est-à-dire d’un sens perceptif, (iv) un mode d’interprétation où la
dynamicité joue un rôle essentiel, (v) le choix d’une théorie microgénétique des
formes d’inspiration gestaltiste, (vi) un rôle premier accordé aux théories de la
textualité.
Mais, comme déjà mentionné, ces approches herméneutico-continuistes
n’entendent pas s’inscrire dans une démarche de modélisation mathématique, à
telle enseigne que le continu qui y est invoqué n’obéit à aucun modèle formel a
priori.
Aussi sommaire soit-il, cet exposé des recherches sur les fondements
mathématiques de la cognition fait clairement apparaître l’apport de (la
philosophie des) mathématiques aux sciences cognitives. Les recherches
consacrées aux fondements cognitifs des mathématiques mettent en scène l’apport
réciproque des sciences cognitives à la philosophie des mathématiques.

3
L’un des traits saillants des mathématiques est leur orientation vers la recherche de
relations caractérisées par de riches classes d’invariants dont l’un des objectifs est
de nous « faire voir » le réel. Les physiciens, en effet, n’utilisent des formalismes
mathématiques que ceux qui offrent des invariants, c’est-à-dire des entités qui ne
sont pas modifiées par certaines transformations. Ce sont ces invariances qui
permettent d’élaborer des lois susceptibles de décrire une réalité physique qui ne
soit pas liée à un point de vue particulier. Quel que soit le sens que l’on donne à
cette « efficacité » des mathématiques (s’agit-il d’un pur « miracle » ou ne
sélectionne-t-on des outils mathématiques que ceux qui « marchent » en
physique ?), la question centrale est la suivante : qu’y a-t-il à l’origine de cette
capacité du langage mathématique à produire des structures riches en invariants ?
Le fait que les mathématiques soient pourvoyeuses d’un ensemble invariant et
stable de formes de construction de connaissance et, conséquemment, que la
constitution des théories mathématiques soit un mode de constitution d’une
objectivité met en lumière un problème majeur de la philosophie des
mathématiques : celui de comprendre comment les constructions peuvent parvenir
au degré d’invariance et de stabilité que nous pouvons constater. Que cette notion
d’objectivité mathématique soit prise comme une notion ontologique (c’est-à-dire
qu’elle renvoie à un univers de concepts qui nous pré-existe et qui s’impose au
mathématicien) ou comme une notion épistémologique (en ce qu’elle concernerait
l’organisation et la constitution de notre connaissance mathématique), le problème
posé est un problème central de la philosophie (et de l’histoire) des mathématiques
et un formidable défi lancé aux sciences cognitives : comment les mathématiques
peuvent-elles se constituer en tant que connaissance d’objets, que ceux-ci soient
par hypothèse donnés à l’avance ou, au contraire, qu’ils résultent de l’activité
mathématique elle-même ? Selon quelles conditions cognitives l’objectivation,
c’est-à-dire la transformation d’une donnée plus ou moins conceptualisée en objet
mathématique porteur d’une connaissance et sur lequel puissent s’articuler des
connaissances, peut-elle s’effectuer ? Il va sans dire qu’une telle question prend
toute sa force en faisant l’hypothèse (la moins « coûteuse ») que les objets
mathématiques sont une construction humaine (c’est-à-dire résultent de l’activité
d’êtres humains soumis à une variabilité inter-personnelle et à un contexte
historique donné) et pose la question du sens en mathématique. De la possibilité de
répondre à ces questions dépend une part de la crédibilité des sciences cognitives.
Ces deux problèmes – celui de l’« efficacité » des mathématiques et celui,
corollaire, de la constitution d’une objectivité qu’elles permettent – sont
intimement liés puisque le second met en jeu les conditions de possibilité du
contenu du premier, mais sont susceptibles de réponses différentes, dans la mesure
notamment où la question de l’objectivité peut être appréhendée indépendamment
de celle de l’efficacité.
L’énigme de l’efficacité des mathématiques
La question de l’efficacité a reçu, au fil de l’histoire, diverses formulations et
diverses réponses (Klein, 2000, Wigner 1960).
Selon Kepler, réductionniste avant l’heure, le physicien étudie du réel ce qu’il est
capable d’en saisir par des lois mathématiques. La science a pour objet d’élaborer
un modèle propre à éclairer l’intelligibilité du réel. C’est cette même idée que l’on
retrouve chez Feynman : si nous faisons de la physique mathématique, c’est faute

4
de mieux ; seules les propriétés du monde exprimables en termes mathématiques
nous sont accessibles et la puissance et l’efficacité de la physique tiennent
précisément à ce qu’elle a su se limiter aux questions susceptibles d’une réponse
mathématique. Einstein formule la question de façon différente (« Comment la
mathématique, produit de la pensée humaine, indépendante de toute expérience,
peut-elle s’adapter d’une façon si remarquable aux objets de la réalité ? La raison
humaine serait-elle capable, sans recours à l’expérience, de découvrir par la
pensée seule les propriétés des objets réels ? » ) mais ne lui apporte pas de
réponse. Dans son fameux article, « La déraisonnable efficacité des
mathématiques dans les sciences de la nature », Wigner (1960) considère que cette
efficacité des mathématiques relève du « miracle » ou d’un « don magnifique que
nous ne comprenons ni ne méritons ». Plus près de nous, Châtelet (1997)
manifeste le même étonnement : « Comment se fait-il que la mathématique, qui,
dans les sciences, est à la fois la bonne à tout faire et la reine des sciences, soit si
utile à cette cuisinière malpropre et performante qu’est la physique ? » En d’autres
termes, comment un ensemble de symboles abstraits, manipulés par un jeu
axiomatique, issus d’une activité purement intellectuelle, peut-il posséder de telles
capacités de modélisation du monde empirique ? Mais Châtelet apporte une
réponse : l’unité des mathématiques et de la physique ; les mathématiques seraient
constitutives du concept même de réalité physique.
La notion d’efficacité en mathématiques a donc plusieurs facettes.
Tout d’abord, celle associée à la capacité de prédiction : une théorie mathématique
est efficace si elle peut anticiper les résultats expérimentaux ou reproduire les
données déjà obtenues.
Mais l’efficacité d’une théorie mathématique peut aussi venir de ce qu’elle permet
d’expliquer un phénomène empirique. Comme l’a souligné Thom, dans Prédire
n’est pas expliquer (1991), un modèle prédictif peut parfaitement ne rien donner à
comprendre ; de plus, la capacité explicative d’une théorie permet de réduire la
diversité des phénomènes à un petit nombre de principes.
Enfin, l’efficacité des mathématiques peut être associée, comme chez Connes, à la
« générativité conceptuelle » des formalismes mathématiques : une théorie
mathématique est efficace si elle permet d’engendrer de nouvelles idées, de
nouveaux concepts ; les mathématiques sont la source principale des principes et
des concepts qui permettent d’élaborer de nouvelles théories physiques.
Les grands systèmes philosophiques ont toujours tenté de répondre à la question
de l’efficacité des mathématiques, donc à celle du lien entre mathématiques et
réalité.
Pour les pythagoriciens, le nombre est l’essence du monde et la structure profonde
de la nature est mathématique. Faire des mathématiques revient donc à emprunter
le langage même du monde. Le problème de l’efficacité des mathématiques ne se
pose pas. La principale objection au pythagorisme est la confusion qu’il impose
entre réalité et description de la réalité.
Pour les platoniciens, de Cantor à Connes en passant par Gödel, les mathématiques
sont un langage qui permet de passer du monde sensible au monde des Idées et qui
permet d’atteindre les structures profondes du monde ; les constructions
mathématiques obéissent à une nécessité interne aux mathématiques elles-mêmes,
les théorèmes étant à découvrir, pas à inventer. Le platonisme laisse une question
essentielle sans réponse : comment la pensée du mathématicien établit-elle le lien

5
avec le monde des Idées ; puisque ces deux mondes sont séparés (à défaut de quoi
on retomberait dans le pythagorisme), comment la jonction s’opère-t-elle.
Pour les aristotéliciens, les mathématiques ont une origine empirique, elles se
construisent uniquement à partir de l’observation ; la source des mathématiques
réside dans cette capacité de l’esprit humain à extraire des formes du monde
sensible et à les analyser. Ainsi l’efficacité des mathématiques vient-elle de ce que
nous nous servons de structures livrées par le monde physique lui-même.
L’objection qui est faite à l’aristotélisme est qu’il ne permet pas de rendre compte
d’une certaine autonomie dans la production de concepts mathématiques et de la
capacité des mathématiques à « prévoir » de nouveaux objets physiques.
Les kantiens proposent une autre approche de l’efficacité des mathématiques : tout
phénomène est constitué, pour nous, dans l’espace et dans le temps, qui sont des
formes a priori de la sensibilité ; il présente donc une structure immédiatement
homogène aux mathématiques. Le kantisme laisse également, concernant le
problème de l’efficacité des mathématiques, une question sans réponse : si les
concepts mathématiques ont leur origine dans l’entendement pur, comment rendre
compte du fait que les mathématiques procèdent, entre autres, de la nécessité
interne des formalismes.
Pour le formalisme (Frege, Hilbert), qui voit dans les mathématiques un pur jeu
formel défini à partir d’un certain nombre de symboles, le problème de l’efficacité
des mathématiques, à moins d’invoquer une mystérieuse « harmonie préétablie »,
est encore plus difficile à appréhender. Il est, en effet, impossible d’imaginer
qu’un jeu arbitrairement défini puisse avoir quelque chose à dire des sciences
empiriques. Cette conception des mathématiques comme manipulation aveugle
des symboles vides de sens, dont le cognitivisme constitue le dernier soubresaut, a
désormais vécu.
D’autres courants philosophiques peuvent être invoqués. Nous y reviendrons
lorsque nous aborderons le cœur de la question du continu.
La constitution de l’objectivité mathématique
Les réponses proposées par les grands courants de la philosophie des
mathématiques à la question de leur efficacité valent également, dans une certaine
mesure, pour la question de la constitution d’une objectivité mais doivent,
néanmoins, pour répondre à cette dernière, obéir à de formulations différentes et
faire droit à d’autres réponses plus directement liées à la dimension cognitive du
problème.
La question de l’apport des sciences cognitives à la philosophie des
mathématiques (ou, si l’on préfère, l’étude des fondements cognitifs des
mathématiques) concerne les différentes branches de la discipline, de
l’arithmétique à la géométrie, cette dernière, en tant que science transcendante,
assumant un rôle clé dès lors que l’on pose la question du sens.
Pour ce qui est de la contribution des sciences cognitives à la philosophie de
l’arithmétique, divers auteurs ont avancé des thèses concernant l’étude des
conditions cognitives de la constitution des théories mathématiques. Citons, pour
commencer, la thèse de Dehaene (1997, 2007) qui postule l’existence d’une
capacité innée de perception et de représentation des quantités numériques,
capacité qui ne se réduirait pas à celle permettant de procéder à un simple
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%