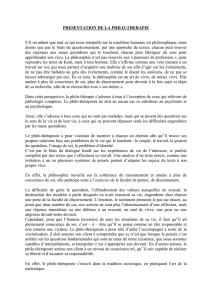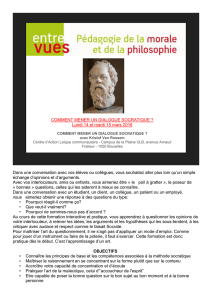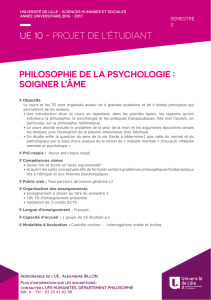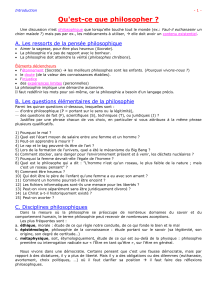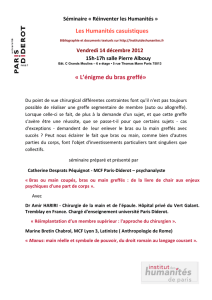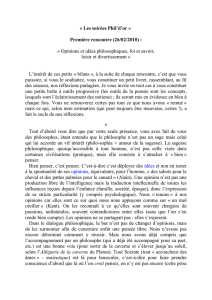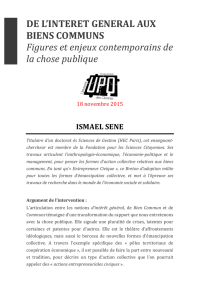pouvoir et limite du dialogue - Espace Numérique de Travail de l

1
Émancipation et autorité : pouvoir et limite du dialogue
Stéphanie Puységur
Université de Bordeaux 4
Jacques Quintin
Université de Sherbrooke (Can)
Jean-François Dupeyron
Université de Bordeaux 4
Introduction
Dans le cadre démocratique occidental, il est désormais presque impossible de penser à
une philosophie de l’éducation sans mettre à contribution la notion de dialogue
socratique, comme le montre par exemple la montée en puissance des pratiques à visée
philosophiques dans les écoles de plusieurs pays, autant pour les enfants que pour les
adultes. Si l’objectif d’introduire le dialogue socratique consiste à former des individus à
une plus grande autonomie et à une vie "adaptée" à notre société marquée par la
postmodernité, laquelle se caractérise par la faiblesse des fondements et l’érosion de
l’autorité, il n’en demeure pas moins que nous devons nous interroger sur la nature d’un
tel dialogue en regard de l’émancipation réelle des individus. Que recouvrent
exactement les termes que nous employons? Qu'est-ce que dialoguer? Quelles sont les
positions relatives de l'enfant et de l'adulte, du patient et du médecin, voire du citoyen et
du spécialiste dans un tel dialogue? Le risque d'un consensus "mou" visant à faire
disparaître sous une apparence démocratique des pratiques reposant en réalité sur une
conception discutable de l'autorité est réel. Ce qui oblige à analyser de très prés les
mots que nous employons - "dialogue socratique", "autorité démocratique" - et les
expériences qu'ils désignent.
Ainsi, on peut comprendre le dialogue en éducation comme une sorte de ruse, comme
un moyen de mener progressivement l'élève vers une réponse établie d'avance, qu'il
s'agit de lui donner l'illusion d'avoir trouvé par lui-même. Ici, le dialogue ne vise pas à
émanciper, mais à instruire et à transmettre un savoir déjà constitué à des esprits
conçus sur le modèle d’une tabula rasa ou d’une outre vide.
Or, Aristote montre bien que le dialogue n'a de sens, comme délibération, que dans un
contexte d'indétermination ou d'incertitude. Cette indétermination est aujourd'hui
exacerbée par le pluralisme des valeurs, l'absence de références ultimes. Pourtant, au-
delà de cette diversité de valeurs, nous pouvons grâce au dialogue, partager
l'expérience du questionnement quant au sens que nous devrions donner à notre
existence. Cet horizon herméneutique commun conduit à questionner des formes
d'autorité jusqu'ici admises et véhiculées par le langage. Face à l'inconnu, et au sens à
donner à l'existence, nous sommes tous égaux, il n'y a plus de savants et d'ignorants,
mais une communauté de recherche. Ainsi, Jacotot invite-t-il à considérer l'élève

2
comme égal en intelligence et Ricoeur parle-t-il de restituer l’égalité de parole entre le
patient et le médecin.
Dans cette optique, la discussion à visée philosophique dans un cadre scolaire permet
de faire une expérience de recherche authentique. L'accent est alors mis sur la
réflexivité, sur la capacité de l'élève à faire retour sur ce qu'il sait ou croit savoir, sur ce
qu'il pense ou expérimente et à affiner son jugement et son discours dans l'échange
avec d'autres. Pourtant, il ne s'agit pas d'opposer schématiquement réflexion et
connaissances car on risquerait de tomber dans un dialogue ou un jugement qui
tournerait "à vide". Le lien entre la pratique du dialogue et l'enseignement des humanités
est étroit dans la mesure où celles-ci transmettent des langages, des façons de vivre,
des discours faisant écho à nos expériences subjectives et permettant de les mettre en
forme pour les évaluer, les juger, les confronter et les discuter avec d'autres.
Cette expérience du dialogue adossé aux humanités se révèle également pertinente
dans un contexte d'enseignement ou de formation d'adultes. L’un de ces contextes est
celui de l’enseignement adressé aux médecins. Les médecins et leurs patients, plus que
toutes autres personnes, en raison de la crise existentielle qu’ils éprouvent à travers la
maladie, la souffrance et la mort doivent justement exercer leur jugement à propos des
meilleures décisions à prendre en regard du sens de l’existence.
C’est la raison pour laquelle l’apprentissage de la délibération ou du dialogue doit se
faire en classe sous la forme d’atelier pratique afin que les futurs médecins puissent
mieux saisir les enjeux et mieux accompagner par la suite leurs patients devant leur
désarroi. Pourtant, devant l’incompréhensible et notre ignorance, notre langage fait
souvent défaut. C’est la raison pour laquelle les humanités peuvent devenir un baume
sur notre difficulté à entendre ce qui cherche à se dire dans ces expériences de vie.
Celles-ci donnent une autre dimension au langage et à nos présupposés. Elles
nourrissent le dialogue et, par le fait même, évitent que celui-ci devienne une simple
expression d’opinions. Hegel et Vygotsky soulignent la consubstantialité de la pensée et
du langage. En ce sens, la pensée ne peut s’élaborer hors des humanités qui justement
nourrissent notre langage, et permettent un dédoublement, c’est-à-dire une distance
dans le rapport à soi et à autrui comme à l’ensemble de notre société. C’est pourquoi,
lorsqu’il s’agit de l’enseignement des humanités, il ne s’agit pas de culture de
divertissement, mais de culture d’émancipation.
Si le dialogue peut exercer un pouvoir d’émancipation, il faut que celui-ci s’émancipe
des faux dialogues. Dès lors, il serait peut-être plus juste de parler de dialogue
herméneutique qui devient un processus qui permet la médiation entre une approche
centrée sur le maître et une approche centrée sur l’élève dans la mesure où nous
sommes tous égaux devant l’ignorance. Comme le note le philosophe américain Richard
Rorty, la philosophie permet l’acquisition d’une culture élargie ou la création de
nouveaux langages.

3
Néanmoins, dans le cas du dialogue avec des enfants à l'école ou avec des étudiants en
médecine, cette égalité posée en principe et expérimentée dans l'échange n'exclut pas
l'existence d'un maître. Il serait celui qui a su développer une plus grande tolérance à
l’incertitude et devant l’ignorance. Il serait donc celui qui sait vivre et juger sans le
recours aux opinions. Il serait celui qui croit qu’il n’est pas nécessaire de savoir pour
juger comme Kant nous enjoint à le faire. Le maître est celui qui est passé maître dans
l’art de l’écoute et par conséquent du dialogue, qui peut offrir un espace où celui-ci peut
réellement se déployer.
Ces pratiques du dialogue en éducation et cette figure alternative du maître, de
l'enseignant, du formateur obligent à mettre en question certaines évidences concernant
le paradigme de l'autorité qui sous-tend de très nombreuses pratiques éducatives, en
particulier dans la tradition de la forme scolaire dominante en France. La prévalence de
ce vocable forme en effet le noyau d'un paradigme dont on peut se demander s'il ne
constitue pas le plus quotidien des obstacles à l'émergence d'une conception plus
émancipatrice de l'éducation. En effet, la déconstruction de certaines évidences
véhiculées par l'expression contemporaine "autorité démocratique" fait apparaître les
problèmes conceptuels aigus que pose l'autorité en éducation dès lors que l'on
questionne l'existence de la "chose" que ce vocable désigne, que l'on travaille sa
définition et que l'on examine les programmes pratiques d'éducation et de formation qui
en dérivent régulièrement. Ainsi, interpeller la pertinence de l'ancrage des modèles
pédagogiques dans l'autorité permet d'ouvrir un espace pour l'émergence d'autres
notions comme le respect, la reconnaissance, la confiance, la communication, le bien-
être. Ces termes ne sont-ils pas plus pertinents pour penser une éducation
émancipatrice ? S’il y a autorité, celle-ci émergera de la pratique dialogique et ne
trouvera sa légitimité que dans l’exercice même du dialogue, et non du pouvoir. Plus
que jamais, s’il existe une autorité, c’est celle des jeux de langage dans lesquels nous
sommes empêtrés. Alors autant choisir ceux qui nous rapprochent le plus de la chose :
l’éducation pour le développement humain.

4
Usages du dialogue en éducation :
de l'aliénation à l'émancipation.
Stéphanie Puigségur
Université de Bordeaux 4.
Introduction
Dans le champ éducatif, la notion de dialogue est souvent mobilisée, en un sens
relativement large, pour évoquer des pratiques visant à faire interagir les adultes et les
enfants ou à favoriser par le questionnement l’échange entre les enfants eux-mêmes.
Ce type de démarche constituerait un compromis entre une éducation ne faisant aucune
place à la parole de l’enfant et une autre, qui, laissant les enfants à eux-mêmes,
refuserait d’intervenir activement auprès d’eux. Nous allons évoquer un certain nombre
de « façons de faire » et de représentations qui mobilisent cette idée de dialogue dans
une perspective démocratique ou un souci d’émancipation des enfants. En effet, dans
une société démocratique, elle-même fondée sur l’échange public d’arguments, l’idée
d’utiliser le dialogue comme un moyen d’éducation des enfants peut paraître tout à fait
logique. L’objectif est alors de former des individus capables d’intervenir dans le débat
public, d’entendre de façon critique les différents discours échangés et d’exercer ainsi
leur citoyenneté de façon éclairée. Ce modèle d’éducation libérale est par exemple
étudié par Martha Nussbaum (2011) sous l’intitulé de « pédagogie socratique » pour en
signaler la pertinence mais aussi la fragilité dans un contexte peu favorable aux
humanités en général et à la philosophie en particulier. Mais au-delà de cette dimension
démocratique ou citoyenne, c’est la capacité du sujet de réfléchir son existence,
d’articuler l’expérience la plus intime à un questionnement universel qui est en jeu dans
ces pratiques. Le dialogue philosophique interroge le rapport du sujet à lui-même, à ses
propres déterminations ou aliénations, à ses façons de vivre.
Mais cette référence omniprésente au dialogue, souvent qualifié de « socratique » ou
philosophique mérite d’être interrogée. À la lecture de différents auteurs, ou
témoignages de praticiens, on s’aperçoit que le terme ne recouvre pas nécessairement
les mêmes significations, ne s’inscrit pas dans le même cadre conceptuel. Aussi
essaierons-nous de préciser ce que nous pouvons entendre par « dialogue » en
éducation et à quelles conditions celui-ci peut participer d’une réelle émancipation des
individus.
En quoi le dialogue se distingue-t-il d’autres formes de discussions comme le débat,
pourtant privilégié lorsqu’on évoque la scène publique, l’espace démocratique ?
Qu’entendent exactement les auteurs qui s’y réfèrent lorsqu’ils évoquent le « dialogue
socratique » ? A partir de quel âge une telle pratique est-elle envisageable ? Quel est le
rôle de l’enseignant dans ce dialogue ?
Autant de questions que nous essaierons de déployer en examinant les discours et
pratiques relatifs à la philosophie pour enfants (P4C, Philosophy for children, selon la

5
formule de Lipman, initiateur du genre) ou à la discussion à visée philosophique
(D.V.P.). Ces démarches actuellement de plus en plus présentes au niveau international
diffèrent quant aux finalités qu’elles affichent, aux modalités de travail qu’elles proposent
ou à la façon dont elles définissent le rôle de l’adulte et de l’enfant dans le dispositif.
Mais nous verrons qu’au-delà de cette diversité évidente, elles présentent quelques
points de convergence tout à fait significatifs portant notamment sur la place du dialogue
en éducation, la façon d’envisager la parole de l’enfant et sa relation à l’adulte
relativement au savoir.
Le dialogue socratique comme cheminement dialectique vers le vrai et
vecteur d’émancipation
Le dialogue est, en un premier sens, une discussion, un échange entre deux ou
plusieurs personnes. Mais l’histoire du terme témoigne de son lien initial à la pratique du
dialogue socratique telle qu’en rend notamment compte Platon. S’y révèlent plusieurs
conditions nécessaires à la réalisation de cette forme de discussion : il s’agit de
rechercher à deux ou plusieurs personnes la vérité, laquelle est transcendante,
d’énoncer sincèrement ses positions et d’en répondre, enfin, d’accepter les conclusions
du dialogue, même si elles nous mettent en contradiction avec nous-mêmes et nous font
perdre la face. Le dialogue se distingue ainsi du débat, lequel apparaît davantage
comme une logomachie, un affrontement de positions opposées, incompatibles a priori.
Ces caractéristiques générales précisées, voyons comment fonctionnent les premiers
dialogues de Platon pour comprendre les enjeux de cette pratique et son pouvoir
émancipateur.
Ces dialogues socratiques sont d’une extrême densité et il serait évidemment absurde
de prétendre résumer en quelques phrases leurs spécificités, mais nous allons
néanmoins expliciter quelques caractéristiques utiles pour nourrir notre réflexion
(Vlastos, 1994).
- Ils s’efforcent tous de répondre à la question « qu’est-ce que X ? » Il s’agit par exemple
de saisir l’essence du courage (Lachès), de la beauté (Hippias majeur), de la piété
(Euthyphron).
- Les interlocuteurs ne sont pas dans une position symétrique. Socrate n’est jamais mis
en position de répondant, c’est lui qui mène l’échange par son questionnement
infatigable, même s’il lui arrive dans certains cas très particuliers de développer un
discours plus long, qui peut-être emprunté à d’autres (mythes rapportés), prendre un
tour parodique (Ménexène) ou s’apparenter à un récit de vie (Apologie de Socrate).
- La position de Socrate dans ces dialogues est essentiellement réfutative : il ne propose
aucune doctrine constituée, mais s’efforce de pointer les incohérences du discours de
ses interlocuteurs.
- Les dialogues sont aporétiques. En fin de dialogue, aucune définition satisfaisante
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
1
/
34
100%