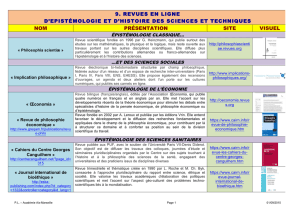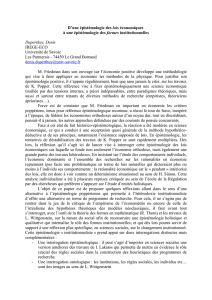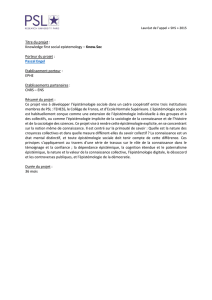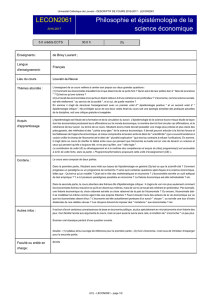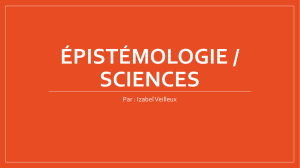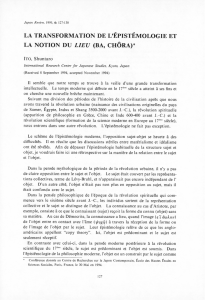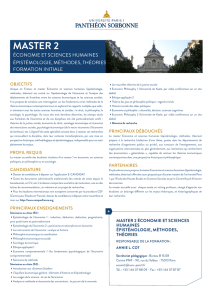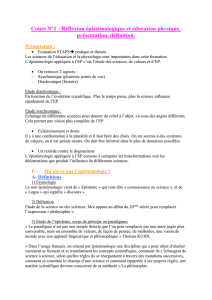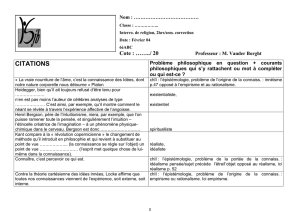1 Introduction En guise d`intro., on va se demander quel est l`objet

1
Introduction
En guise d’intro., on va se demander quel est l’objet du cours : qu’est-ce qu’un cours
portant sur l’épistémologie des sciences physiques ?
Série de distinctions à introduire :
1. Théorie de la connaissance et épistémologie d’une science particulière
2. Epistémologie française et philosophie de la science anglo-saxonne
3. De la physique, ou plus exactement des sciences expérimentales
1. Théorie de la connaissance et épistémologie d’une science particulière
Si l’on considère l’étymologie du terme « épistémologie », l’épistémologie est un discours
sur le savoir ou sur la connaissance en général, la connaissance étant distinguée d’autres
manières de se rapporter au réel, qu’on peut quant à elles rassembler sous le terme « cognition ».
En ce sens, lorsque Socrate demande dans le Théétète quelle est la différence entre science et
opinion, ce que c’est que connaître, comment nous pouvons justifier les connaissances que nous
avons, il fait de l’épistémologie. De même, quand Locke affirme que toutes les connaissances
viennent de l’expérience ou quand Kant pose qu’il existe des connaissances a priori, ils ont des
positions « épistémologiques ».
Cependant, notre idée commune de l’épistémologie peut être plus précise que cela —
quand nous parlons d’épistémologie, nous n’entendons pas toujours un discours sur la
connaissance en général, mais plutôt l’idée que nous allons, en philosophes, accompagner une
science particulière, pour comprendre quels sont les problèmes particuliers qu’elle rencontre ou
pour dégager la spécificité des méthodes auxquelles elle recourt. Cela peut valoir pour toutes
espèces de sciences, pour les sciences physiques ou pour les sciences humaines. C’est ainsi
qu’on parle d’épistémologie de l’histoire, d’épistémologie des sciences naturelles ou
d’épistémologie des mathématiques.
Autrement dit, si l’on considère l’étymologie et notre idée commune, l’épistémologie
semble être ou bien une théorie générale de la connaissance, ou bien un ensemble de théories qui
se rapportent spécifiquement à certaines sciences.
Cette hésitation se rencontre également dans les premiers usages qui furent fait du terme :

2
— Conformément à l’étymologie, J.L. Ferrier, Institutes of metaphysics, 1854 : première
occurrence du terme « epistemology », qui est opposé à « ontology », et assimilé à la théorie de
la connaissance en général.
C’est l’usage le plus courant dans les pays de langue anglaise, qui, par ailleurs, désigne
l’étude des philosophique des sciences par l’expression « philosophy of science »
— introduction en français du terme au début du XXe siècle, plus précisément dans une
traduction d’un ouvrage de Russell, l’Essai sur les fondements de la géométrie (1901).
Définition qui est alors donnée par Couturat, p. 257 : « l’épistémologie est la théorie de la
connaissance appuyée sur l’étude critique des sciences ». Le terme est intronisé dans ce sens là
lors des séances de la Société de Philosophie du 18 mai et du 8 juin 1905.
On voit bien dans cette définition quel était le projet des philosophes freançais du début du
XXe siècle : donner une théorie de la connaissance en général à partir de l’étude d’une espèce de
connaissance particulière, mais néanmoins tenue pour exemplaire, à savoir la connaissance
scientifique. On reviendra sur ce projet et ces enjeux en 2), il s’agit pour le moment de spécifier
notre objet à partir des premiers usages du terme « épistémologie ».
L’usage le plus courant en français : « épistémologie » ne désigne pas la théorie de la
connaissance en général, mais l’étude philosophique des sciences en particuliers, éventuellement
guidée par l’idée que cette étude va nous donner des renseignements sur la connaissance en
général.
On peut récapituler ce qui vient d’être dit en faisant une première distinction :
i) la « théorie de la connaissance » en général qui se demande, par exemple, comment
distinguer le savoir de la croyance, comment définir en général l’acte de connaître ou ce qu’il
suppose.
ii) l’épistémologie ou la philosophie des sciences, qui porte sur l’espèce particulière de
connaissance qu’est la science, voire se diversifie selon les sciences particulières. Les questions
sont ici variées selon qu’on regarde les sciences en général, ou telle ou telle science particulière ;
on peut par exemple se demander :
— si toute science a préférentiellement une structure formelle déductive,
— ce que veut dire l’énoncé que toutes les sciences traitant d’objets naturel sont
réductibles à la physique (les mêmes lois ? les mêmes objets ?),
— d’où vient que les mathématiques rendent si bien comptent du réel (le miracle : que ça
marche)

3
— quel est le statut des objets mathématiques,
— ce que signifie fonder une science sur l’expérience, etc.
Ce dont il sera question dans ce cours, c’est donc non pas de théorie de la connaissance,
mais d’épistémologie ou de philosophie de la science.
Pour compléter ce premier point, deux remarques :
— Question de vocabulaire : certains auteurs français, influencés par l’usage anglais
d’« epistemology », en viennent à désigner par « épistémologie » la théorie de la connaissance en
général. D’où l’idée que d’autres désignations seraient préférables pour en français « théorie de
la connaissance » : gnoséologie, épistémie.
français
anglais
théorie de la connaissance
Gnoséologie, épistémie
Epistemology
étude des principes d’une
science (au sens large)
Epistémologie
Philosophy of science
— L’essentiel n’est pas les mots. Le rapport entre i) et ii), autrement dit encore entre
connaissance en général et sciences en particulier, est lui-même l’objet de questions
philosophiques. On voit par exemple bien qu’il y a deux positions extrêmes possibles, selon
qu’on pense que les procédures à l’œuvre dans les sciences sont analogues aux procédures qui
nous permettent de connaître en général ou bien qu’elles sont radicalement différentes. On peut
se demander aussi si une théorie de la connaissance indépendante de toute science constituée est
possible, si finalement cela a un sens de se demander « à vide » ce que c’est que connaître.
2. Epistémologie française et philosophie de la science anglo-saxonne
A ce point, on pourrait avoir l’impression que « épistémologie » et « philosophy of
science » sont équivalents. En fait, il faut introduire une seconde distinction, qui n’est pas tant
une question d’extension qu’une question d’histoire et, pour ainsi dire, de style national :
i) l’épistémologie ou la philosophie des sciences française. Elle naît avec Auguste Comte
et le positivisme ; quelques noms qui reviendront :
A. Comte (1798-1857)

4
P. Duhem (1861-1916)
E. Meyerson (1859-1933)
G. Bachelard (1884-1962)
G. Canguilhem (1904-1995)
* Comme on l’a dit, l’objectif au début du siècle était de comprendre la connaissance en
général à partir des sciences. Cette manière de procéder venait d’une opposition à l’idée qu’on
pourrait comprendre ce qu’était la connaissance par introspection (Etym. = se tourner vers
l’intérieur soi-même. L’âge d’or de l’introspection « scientifique » : Maine de Biran et Co.)
A cette idée, des auteurs comme Comte ou Meyerson opposent que rien n’est plus vague,
plus indéterminé et moins « scientifique » que l’introspection psychologique. Pour comprendre
ce qu’est la connaissance, il vaut mieux procéder selon ce qu’ils appellent « méthode a
posteriori » (= méthode à partir des effets, qui va remonter des effets aux causes plutôt que de
prétendre saisir ces dernières d’elles-mêmes) : saisir les actes de connaître en tant qu’ils sont
objectivés, matérialisés dans l’histoire des théories scientifiques.
Comte, Cours de philosophie positive, leçon 1 : « L’étude de la philosophie
positive, en considérant les résultats de l’activité de nos facultés intellectuelles,
nous fournit le seul vrai moyen rationnel de mettre en évidence les lois logiques
de l’esprit humain qui ont été recherchées jusqu’ici par des voies si peu propres à
les dévoiler (…). Regardant toutes les théories scientifiques comme autant de
grands faits logiques, c’est uniquement par l’observation de ces faits qu’on peut
s’élever à la connaissance des lois historiques ».
Meyerson, Identité et réalité, “Nous analysons la science (...) comme la
matière brute du travail, comme un spécimen saisissable de la pensée humaine et
de son développement” (Préface de la deuxième édition, p. viii). “Il convient de
contrôler ses assertions celles du savant] en s’adressant non pas à la pensée
individuelle, mais à la pensée collective, en recherchant la genèse des
conceptions dans l’histoire, leur évolution” (Avant-Propos, p. xv).
L’idée est donc de remonter, pour ainsi dire, du produit à la production, du résultat au
processus lui-même. La manière de procéder dans les sciences constitue un terrain d’observation
pour le philosophe de la connaissance ; il pense trouver dans les sciences, éventuellement dans
les sciences du passé, de quoi comprendre comment nous connaissons en général.

5
* Ce qu’on appelle parfois la tradition épistémologique française, qui va de Comte à
Canguilhem n’est pas une école à proprement parler, il y a des divergences et des oppositions
terme à terme sur un certain nombre de thèses :
— Comte soutenait que l’existence de lois caractérise les sciences achevées : dans une
science comme la physique mathématique, il n’y a plus d’enquête sur les causes des
phénomènes, mais seulement des équations, autrement dit des fonctions qui mettent en rapport
plusieurs espèces de grandeur. Meyerson soutient au contraire que la légalité n’est pas le tout de
la science, et que les sciences ne progressent que parce qu’elles recherchent à expliquer, à
expliciter certaines causes, ou, plus généralement, à poser des identités. Lien identité/causalité
pour Meyerson : trouver une cause, c’est retrouver une identité fondamentale derrière la diversité
de deux évenements.
— Meyerson juge qu’il y a continuité entre théorie de la connaissance et philosophie des
sciences, que le savant, lorsqu’il entre dans son laboratoire, ne change pas sa raison d’homme
contre une raison de savant comme il troque sa chemise contre une blouse d’expérimentateur. En
particulier, pour Meyerson, les procédures qui conduisent les hommes en général à construire, à
partir des données immédiates de la sensation, les choses du sens commun (une salle avec des
individus assis, l’un d’eux a une mine partibulaire et s’approche de moi, un revolver à la main)
sont les mêmes procédures qui conduisent le savant à construire des choses de savant. Bachelard
s’oppose à Meyerson explicitement sur ce point et il insiste sur la discontinuité — discontinuité
entre le sens commun et la science, mais aussi, et c’est lié, entre différentes sciences particulières
ou entre différents épisodes dans les sciences particulières.
— Bachelard avait privilégié la physique mathématique, et vu dans la mathématisation
d’une discipline le signe qu’elle avait atteint ce qu’il appelait un « seuil de scientificité ».
Canguilhem fait une place à des disciplines qui n’étaient pas vraiment mathématisées à son
époque, la biologie et la médecine, et réaménage conséquemment certains aspects de
l’épistémologie bachelardienne que par ailleurs il affirme respecter.
Canguilhem, “Le rôle de l’épistémologie”, in Idéologie et rationalité dans
l’histoire des sciences de la vie,, p. 23-24 : Canguilhem note que Bachelard a
principalement travaillé sur l’histoire de la physique mathématique, dans laquelle
théorie et mathématique sont identifiées. Puis il ajoute « La méthode [prônée par
Bachelard] doit être élargie plutôt que généralisée. Elle ne saurait être étendue à
d’autres objets de l’histoire des sciences sans une ascèse préparatoire à la
délimitation de son nouveau champ d’application ».
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%