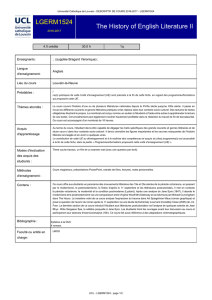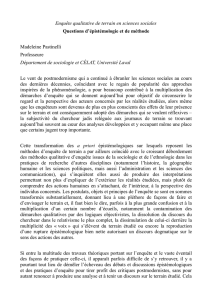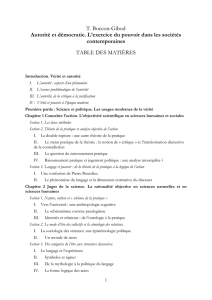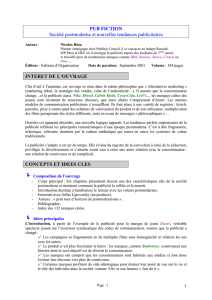1 Réflexions sur les futures orientations possibles de la recherche

1
Réflexions sur les futures orientations possibles de la recherche en marketing
par
Stefano Podestà et Michela Addis
A paraître dans :
Silva, F. Carù, A. et Cova, B. (eds.)
Marketing Méditerranéen et Postmodernité
Euromed, Marseille
2005

2
Résumé
Par l’examen de l’histoire du marketing et l’analyse épistémologique suivante, cet article
fait ressortir quelques limites concernant l’expression traditionnelle de la recherche. A partir
de cette évidence, l’adoption du postmodernisme provoque quelques effets stupéfiants dans le
domaine du marketing et plus particulièrement pour la recherche afférente au marketing.
Selon cette nouvelle perspective, il convient de reconsidérer un grand nombre de concepts
entérinés, parmi lesquels figurent la connaissance, le progrès scientifique, la méthodologie et
la rigueur. Ainsi apparaissent les plus probables orientations futures de recherche avec la
proposition d’une interprétation postmoderne de la recherche marketing : la recherche fondée
sur l’expérience.
Mots clés
Research, postmodernism, science

3
Introduction
Depuis que le « postmodernisme » a fait son apparition chez les chercheurs en tant que
nouveau concept philosophique et scientifique, un débat a également commencé dans le
secteur de l’économie d’entreprise, avec toutefois des divergences d’opinion entre les
intervenants, concernant une nouvelle interprétation du marketing et des thèmes évoqués,
ouvrant de nouveaux horizons aux chercheurs et des possibilités de développements
intéressants, comme cela se produit également dans d’autres domaines. Dans un cas extrême,
il se pourrait que la force de son impact nécessite de reconsidérer le contexte de l’économie
d’entreprise dans sa dimension académique ainsi que sa théorie et les méthodes de recherche
en vigueur. En effet, la prise en compte d’une vision postmoderne du monde met en
discussion le concept de vérité et de toute autre certitude ayant préalablement servi de base au
« modernisme » et nécessite une redéfinition complexe du processus de recherche.
Cette étude a pour objet une interprétation épistémologique du domaine particulier
d’entreprise « marketing », à partir de l’analyse de la littérature correspondante publiée
jusqu’à présent en créant régulièrement des liens entre le plan de conception philosophique et
celui de la recherche marketing.
L’examen de la littérature marketing et de son évolution depuis le début des années
Cinquante fait ressortir une nette tendance « moderne » – étant entendu que « moderne » se
réfère à une vision du monde bien précise, sans aucune signification positive habituellement
attribuée à ce terme – dont l’acceptation génère les principes et les concepts du marketing qui
sont à présent acceptés d’une manière générale. Bien que quelques auteurs se soient
distingués en critiquant les principes fondamentaux du marketing au fil des ans – les premiers
d’entre eux étant les chercheurs du marketing relationnel et ceux du marketing fondé sur
l’expérience –, leurs observations portent encore sur l’aspect principal d’une vision du monde

4
« moderne ». En effet, l’étude épistémologique du marketing offre l’occasion d’approfondir le
courant de pensée actuellement prédominant – précisément le « modernisme » - et du nouveau
courant de pensée « postmoderne ». La critique virulente de ces modes de pensée permet de
mieux en aborder les fondements épistémologiques en vue de proposer quelques premières
réflexions concernant leur impact dans le domaine du marketing, en considérant que
l’adoption d’un mode de pensée – qu’il soit moderne ou postmoderne – implique également
l’adoption de son épistémologie.
En effet, dans le cas où le postmodernisme s’affirmerait, le marketing ne pourrait plus
assumer ses principes actuels ni sa teneur tout en continuant à défendre ses positions qui se
sont renforcées lors des cinquante dernières années. Cette discipline s’est développée en
essayant d’apporter régulièrement aux entreprises les aides adéquates pour définir des
stratégies de marché gagnantes. Les concepts du marketing, perfectionnés au fil du temps,
étaient surtout destinés à servir de support à la gestion.
La présente analyse fait ressortir comment l’extrême sophistication du marketing a
partiellement détourné l’attention des chercheurs de la théorie, celle-ci étant surtout orientée
vers la méthode : il s’est ainsi développé un mécanisme pervers par lequel le caractère
scientifique de la discipline était garanti avec l’utilisation de méthodes scientifiques réputées
universelles et immuables. Le noyau de la méthode, découlant de la nécessité de faire du
marketing une discipline à caractère académique, a créé une distinction de plus en plus grande
entre une littérature de marketing destinée à la gestion et une littérature de marketing destinée
à l’environnement académique. Si la première tend à mettre en évidence les implications
managériales (donc opérationnelles et concrètes) de l’aide, par contre, la seconde insiste
principalement sur l’adoption d’une méthode scientifique qui, dans des contextes très
complexes, est souvent assortie d’une spécialisation excessive, bien que soutenue par une
modélisation sophistiquée. Donc, en poussant à l’extrême, l’adoption du postmodernisme

5
pourrait se traduire par une critique d’aspects importants du « caractère scientifique » du
marketing en tant que domaine d’enquête, au moins dans le sens admis jusqu’à présent. Une
telle critique, loin de menacer l’existence du marketing, génèrerait plutôt une singulière
réflexion de la discipline. En effet, la pensée postmoderne souligne le rôle de l’expérience
dans l’élaboration de la théorie : la méthode redevient un support de la théorie mais pas le
contraire. Ce rééquilibrage des rôles se traduit, pour les chercheurs, par une perte de
nombreux critères consolidés concernant l’évaluation et le jugement d’une théorie ; il s’avère
aussi nécessaire de reconsidérer la signification de leur travail et – non le moindre – de
redéfinir leurs responsabilités. Même lorsque le marketing change d’habit, il perd de son
prestige scientifique pour devenir un corps de connaissance créé par l’homme pour l’homme.
Les rôles respectifs du chercheur et de la discipline sont très risqués et représentent
parallèlement un grand challenge.
La non-considération de toute référence objective – ô pseudo-objective – de la méthode
dans le cadre de référence utilisée par le chercheur pour l’évaluation de toute recherche
implique la non-considération de tout support standard extérieur à l’activité de recherche. Le
chercheur, se trouvant ainsi privé d’ancrage à un standard, est impliqué dans un défi risqué.
En effet, l’ancrage à la méthode, à son caractère scientifique et à sa rigueur, a toujours
constitué un filet de protection pour le chercheur : le respect des filières standard, bien
considérés par la communauté académique, donnait une garantie de la qualité du travail
effectué et de son acceptation par le public de référence. Toutefois, ce même filet de
protection devenait aussi la cage du chercheur, au-delà de laquelle il ne pouvait pas aller, sous
peine de déconsidération académique du chercheur.
Par contre, le fait d’embrasser complètement le postmodernisme signifie l’abandon de tout
filet et de toute cage ; ainsi, il est demandé au chercheur de risquer davantage mais également
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
1
/
64
100%