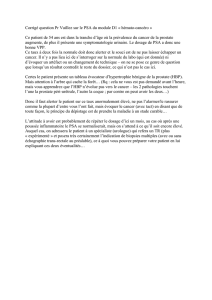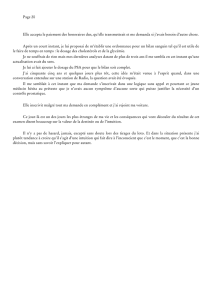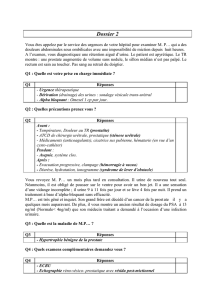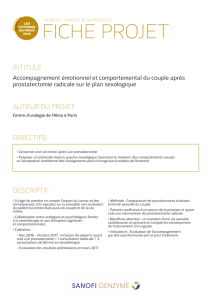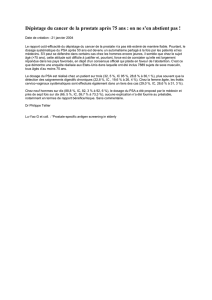Caractéristiques des cancers prostatiques chez les

ARTICLE ORIGINAL Progrès en Urologie (2000), 10, 231-236
231
Caractéristiques des cancers prostatiques chez les français
d’origine afro-antillaise
Vincent RAVERY(1), Isabelle JAVERLIAT(1), Marianne TOUBLANC (2), Liliane BOCCON-GIBOD (3),
Vincent DELMAS (1), Laurent BOCCON-GIBOD (1)
(1) Service d’Urologie, (2) Service d’Anatomopathologie, Hôpital Bichat, Paris, France
(3) Service d’Anatomopathologie, Hôpital Trousseau, Paris, France
Manuscrit reçu : décembre 1999, accepté : février 2000.
Adresse pour correspondance : Dr.V.Ravery, Service d’Urologie, Hôpital
Bichat, 46, rue Henri Huchard, 75018 Paris.
RESUME
Objectifs : Evaluer les caractéristiques cliniques, biologiques et anatomopatholo-
giques du cancer de la prostate au moment du diagnostic et après prostatectomie
radicale dans différents groupes de patients ethniquement différents.
Patients et Méthodes : 466 patients ont été consécutivement soumis à des biopsies
prostatiques, pour une anomalie du toucher rectal et/ou pour une élévation isolée du
PSA (au-delà de 3 ng/ml). Dans cette série, 40 patients étaient noirs et 426 caucasiens.
L’autre volet de l’étude intéresse 320 patients soumis à une prostatectomie radicale
pour une tumeur prostatique T1 T2 (25 noirs, 295 caucasiens). Dans le groupe biop-
sié, nous avons analysé l’âge moyen, le PSA moyen, la longueur moyenne de cancer
sur les biopsies et le score de Gleason moyen. Dans le groupe de patients opérés, nous
avons étudié les caractéristiques préopératoires, le stade anatomopathologique, le
statut des marges d’exérèse, la progression biologique (PSA au-delà de 0,05 ng/ml) et
le délai de progression.
Résultats : Au moment du diagnostic, l’âge moyen était de 61,4 ans (48-73) pour les
noirs et 65,2 ans (42-87) pour les caucasiens (p<0,05). Le score de Gleason médian
était de 7 dans les deux groupes. Le PSA était respectivement de 13,4 (1,7-105) ng/ml
contre 4,4 (0,4-600) ng/ml. Le pourcentage moyen de tissu envahi sur les biopsies était
respectivement de 24% contre 18,8%, le pourcentage moyen de biopsies positives
était de 53% contre 39%. Dans le groupe des patients opérés, les taux d’effraction
capsulaire étaient de 39% chez les noirs et de 48,1% chez les caucasiens. Les taux de
marges d’exérèse positives étaient respectivement de 21,7% contre 36,6%. Le taux de
progression biologique avec un recul moyen de 33 mois (6-126) était identique (42,1%
contre 41,1%) mais avec un délai de progression plus rapide pour les noirs (9 mois
contre 12,3 mois).
Conclusions : Dans ce groupe de patients, les noirs ont le même profil biologique que
les caucasiens au moment du diagnostic. Ils sont néanmoins plus jeunes au moment
de la découverte de la maladie, ont plus de biopsies positives et plus de tissu biopsique
envahi par la tumeur, et dans le groupe de patients soumis à la prostatectomie radi-
cale, la récidive biologique est plus rapide.
Mots clés : Cancer de prostate, diagnostic, pronostic, épidémiologie.

232
Les nord américains réalisent de manière récurrente
une description alarmiste des caractéristiques cliniques
et anatomopathologiques du cancer de la prostate dans
leur communauté [7, 16].
L’incidence du cancer de la prostate est ainsi 50% plus
élevée chez les noirs américains que chez les blancs du
même âge. En comparaison aux blancs, les noirs améri-
cains sont plus jeunes au moment du diagnostic, ont des
grades de différenciation plus élevés et des stades cli-
niques moins favorables, ainsi qu’un retard au diagnos-
tic. Les noirs ont également un taux de survie à 5 ans
moins élevé [2]. En cas de tumeur prostatique clinique-
ment localisée à la glande et au moment de la prosta-
tectomie radicale, le nombre d’effractions capsulaires et
de marges d’exérèse positives sont également en
nombre plus important que chez les caucasiens.
Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer de
telles différences [14]. Des facteurs hormonaux tout
d’abord : il semble que les noirs aient des taux de méta-
bolites des androgènes plus élevés que les blancs, et
notamment, la testostérone serait de 3.3% à 15% plus
élevée chez les noirs [9]. Bien que jusqu’à présent ces
différences hormonales n’aient pas fait la preuve de leur
responsabilité dans les différences raciales observées au
cours du cancer de la prostate, ces données prélimi-
naires justifient des investigations complémentaires.
Des facteurs nutritionnels ont également été étudiés
[12], car il semble que les noirs américains aient une
alimentation plus riche en graisse animale [17].
Parallèlement, il a été montré récemment qu’une réduc-
tion dans l’apport total alimentaire en graisses réduit
significativement les taux d’androgènes circulants [13].
La vitamine D pourrait également jouer un rôle, en ce
sens que les noirs ont une capacité réduite à produire de
la vitamine D3 en réponse à l’exposition aux ultra-vio-
lets [11] et plusieurs études ont montré que la vitamine
D3 avait un rôle à jouer dans la différenciation et la
croissance cellulaire [30] et pouvait être impliquée dans
la régulation de l’expression de certains oncogènes,
notamment c-myc [8]. Des facteurs génétiques enfin
sont possibles, mais on connaît encore peu de choses
sur les facteurs moléculaires et le rôle des gènes sup-
presseurs de tumeur et/ou des oncogènes dans la génè-
se du cancer de la prostate chez les noirs [15].
A l’évidence, les problèmes socio-ethniques nord
américains ne sont pas aussi importants en Europe, ce
qui explique en partie le peu de données disponibles de
ce côté de l’Atlantique, concernant les différences
d’histoire naturelle du cancer de la prostate dans les
différentes communautés. Néanmoins, les différences
de climat, d’alimentation, de pays africains d’origine,
de prise en charge médicale sont telles que l’on peut
légitimement s’interroger sur l’applicabilité du modè-
le noir américain aux noirs vivant en Europe. La
France est un des rares pays européen à disposer d’une
communauté noire suffisamment importante pour que
son étude apporte des données informatives sur ce
sujet.
Nous évaluons donc dans cette étude les caractéris-
tiques cliniques, biologiques et anatomo-pathologiques
du cancer de la prostate chez les français d’origine
afro-antillaise, au moment du diagnostic et au moment
de la prostatectomie radicale, en cas de tumeur T1 T2.
MATERIEL ET METHODES
Sur une période de deux ans, nous avons biopsié 466
patients, en raison d’une anomalie du toucher rectal
et/ou d’une élévation du PSA sérique au-dessus de 3
ng/ml et/ou l’existence de métastases osseuses. 40
patients étaient noirs, vivant en France depuis plusieurs
années, soit antillais d’origine, soit africains. 426
patients étaient de type caucasien.
Le protocole biopsique était le même pour tous les
patients. Il comprenait 10 biopsies de la glande : deux
à chaque base et à chaque milieu (une biopsie était pré-
levée à 45° selon la méthode initialement décrite par
HODGE, et une biopsie était prélevée à 30° plus à la
périphérie de la prostate); au niveau de l’apex, une
seule biopsie standard était réalisée.
Nous avons étudié et comparé dans deux groupes ethni-
quement différents (noirs versus caucasiens) : l’âge, le
PSA (en utilisant la trousse monoclonale TOSSOH, taux
de normalité 3 ng/ml), la densité du PSA (PSAD), le
volume de la prostate (en cm
3
), le nombre de cancers
détectés dans chacun des deux groupes, le pourcentage
de biopsies positives, le pourcentage de tissu biopsique
total envahi par la tumeur et le score de Gleason.
Nous avons également interrogé notre base de données
informatisée concernant les patients opérés de prosta-
tectomie radicale depuis 10 ans pour une tumeur clini-
quement localisée à la glande. Nous avons retrouvé 25
noirs d’origine antillaise ou africaine, vivant en France
depuis au moins dix ans et 295 patients d’origine cau-
casienne. Le métissage a été admis. Nous avons étudié
dans les deux groupes : l’âge, le PSA préopératoire
(trousse TOSSOH), la PSAD, le volume prostatique, le
stade clinique, le taux d’effractions capsulaires définies
comme la présence de glandes tumorales dans la grais-
se péri-prostatique de la pièce de prostatectomie radi-
cale ; le taux de marges d’exérèse positives définies
comme la présence de glandes tumorales au contact des
limites encrées de la pièce de prostatectomie radicale;
le taux de progression biologique défini comme un
PSA postopératoire plus de 0,05 ng/ml, ainsi que le
délai de progression biologique (défini en mois).
Les différences entre les deux groupes ont été analy-
sées sur le plan statistique par le test du chi-2 pour les
comparaisons d’effectifs et par le test non paramétrique
de Wilcoxon pour les données chiffrées moyennes.
V.Ravery et coll., Progrès en Urologie (2000), 10, 231-236

RESULTATS
Au moment du diagnostic de cancer de la prostate
( Tableau 1), les noirs étaient significativement plus
jeunes (64.8 ans contre 67.4 ans, p < 0.05 ; test de
Wilcoxon). Ils avaient significativement plus de
biopsies positives (53% contre 39%, p < 0.05; test de
Wilcoxon) et avaient également significativement
plus de tissu biopsique envahi (24% contre 18.8%, p
< 0.05 ; test de Wilcoxon) par la tumeur. 17 patients
étaient métastatiques d’emblée (3.7%) dont un seul
était noir.
Le Tableau 2 récapitule les taux de cancers et le PSA
moyen par tranche d’âge dans les deux communautés.
Le seul patient ayant un cancer prostatique avant 50
ans était noir.
Au moment de la prostatectomie radicale, en cas de
tumeur cliniquement localisée à la glande (Tableau 3),
les noirs étaient significativement plus jeunes (60.6 ans
contre 65.3 ans, p < 0.05 ; test de Wilcoxon). Le
nombre d’effractions capsulaires et le nombre de
marges d’exérèse positives étaient significativement
moins importants. Les noirs et les caucasiens ont pro-
233
Tableau 1. Caractéristiques cliniques, biologiques et anatomo -
pathologiques des patients des deux communautés au moment
du diagnostic.
Noirs Caucasiens
N = 40 N = 426
Age 61,4 (48-73) 65,2 (42-87)
Volume prostatique (cc) 40,8 (14-110) 44,3 (10-182)
PSA (ng/ml) 13,4 (1,7-105) 14,4 (0,4-600)
PSAD (ng/ml2)0,425 (0,09-3,5) 0,47 (0,02-20)
Stade clinique 80% T1c 65,3% T1c
B
Nombre de CaP 11 (27,5%) 174 (43,2%)
Age 64,8 (48-73) 67,4 (42-87)
Volume prostatique (cc) 47 (17-110) 37 (6-96)
PSA (ng/ml) 22,8 (3-76) 23,9 (1,2-600)
PSAD (ng/ml2)0,76 (0,16-3,5) 0,87 (0,04-20)
NBP* (%) 53 (20-90) 39 (10-100)
LTI° (%) 24 (5-40) 18,8 (1-87)
Gleason 7,4 (6-9) 7,2 (3-10)
*NBP = Pourcentage de biopsies prostatiques positives.
° LTI = Pourcentage de la longueur totale de tissu biopsique prélevé, envahi par la
tumeur.
Tableau 2. Pourcentages de diagnostics positifs et PSA dans les deux communautés en fonction de l’âge au moment du diagnos -
tic.
Noirs Caucasiens
N = 40 N = 426
Age (ans) 50 50-60 60-70 > 70 50 50-60 60-70 > 70
% CaP 33,3% 13,3% 22,2% 100% 0% 33% 36% 61,5%
(1/3) (2/15) (4/18) (4/4) (0/8) (29/89) (81/225) (64/104)
PSA (ng/ml) 11,6 11,6 9,5 614,4 12,8 19,9
(4,3-24) (4,3-21) (1,7-22) 38,1 (0,6-11,3) (0,4-600) (0,9-199) (1,2-360)
PSA si CaP 24 12,9 12,1 (13,3-105) 31 19,2 26,7
(ng/ml) (12-13,7) (6,5-22) (2-600) (1,2-199) (3,5-360)
CaP : cancer prostatique.
Tableau 3. Caractéristiques cliniques, biologiques et anatomo-
pathologiques des patients des deux communautés au moment
de la prostatectomie radicale.
Noirs Caucasiens
N = 25 N = 295
Age 60,6 (46,5-72) 65,3 (42,3-75)
Volume prostatique (cc) 28,3 (10-76) 41,2 (10-180)
PSA (ng/ml) 10,7 (3,6-41,6) 11,9 (0,6-88)
PSAD (ng/ml2)0,5 (0,12-2,8) 0,36 (0,04-2,4)
Stade clinique 4% T1c 49,5% T1c
pT3 39% 48,1%
Marges d’exérèse 21,7% 36,6%
positives (ME)
Gleason post-opératoire 7,7 (7-9) 7,3 (2-9)
Progression biologique (PB) 42,1% 41,1%
Délai de PB (mois) 9 (3-24) 12,3 (1-84)
Suivi (mois) 28 (3-75) 34,9 (3-126)
V.Ravery et coll., Progrès en Urologie (2000), 10, 231-236

gressé biologiquement après la prostatectomie radicale
dans les mêmes proportions, mais plus rapidement pour
les noirs (9 mois contre 12.3 mois, p < 0.05 ; test de
Wilcoxon).
DISCUSSION
Depuis déjà de nombreuses années aux Etats-Unis, plu-
sieurs auteurs se sont intéressés aux différences d’his-
toire naturelle entre les cancers de la prostate survenant
chez les blancs et chez les noirs [1, 4]. Bien que la lit-
térature soit très abondante sur ce sujet, on parvient à
établir certaines constantes dans les caractéristiques
retrouvées. Les américains d’origine africaine sont glo-
balement plus jeunes au moment du diagnostic de can-
cer de la prostate [5] et ont à âge équivalent des stades
de présentation clinique plus péjoratifs que les cauca-
siens [10, 20]. A âge identique, le PSA est également
plus élevé chez les noirs. Les tumeurs détectées sont de
plus haut grade. De même, en cas de tumeur clinique-
ment localisée à la glande et après prostatectomie radi-
cale, le nombre de tumeurs localisées à la glande (pT2)
est plus élevé, le taux de marges d’exérèse positives est
moins élevé et le taux de progression biologique est
moins important chez les caucasiens. Enfin, il semble
que le taux de mortalité dû au cancer chez les noirs
américains, soit plus élevé que chez les caucasiens.
Notre étude qui évalue ces mêmes caractéristiques dans
une population de français d’origine afro-antillaise
conclut à certaines différences par rapport aux données
nord-américaines. Le nombre de noirs soumis à un dia-
gnostic précoce dans notre étude représentent environ
10% de la totalité des patients, ce qui est le ratio actuel-
lement constaté entre les différentes communautés en
France. L’incidence du cancer de la prostate chez ces
patients est inférieure à celle de caucasiens, ce qui de ce
point de vue est déjà une différence importante par rap-
port aux données déjà publiées [5, 6]. Dans les séries de
dépistage nord-américaines, l’incidence du cancer de la
prostate chez les noirs est de 250 pour
100 000 alors que chez les caucasiens, elle n’est que de
179 pour 100 000 (en 1993) [6].
Dans notre étude, les noirs au moment du diagnostic et
au moment de la prostatectomie sont plus jeunes. De
même, aux Etats-Unis, l’âge médian au moment du dia-
gnostic chez les blancs est de 71 ans, alors qu’il n’est
que de 69 ans chez les noirs [19, 24]. Nous constatons
que la majorité des cancers sont diagnostiqués dans les
deux communautés après 60 ans, comme aux Etats
Unis où l’on constate que 75% des cancers de la pros-
tate sont détectés après 65 ans quelque soit leur origine
ethnique [18]. Néanmoins lorsque l’on analyse l’inci-
dence du cancer de la prostate par rapport à l’âge, l’in-
cidence de la maladie notamment chez les patients
noirs de moins de 50 ans est suffisamment importante
pour préconiser le dépistage ou au moins le diagnostic
précoce dès cet âge [18]. Nos données, malgré le faible
effectif, confirment ces données puisque le seul patient
diagnostiqué avant 50 ans est noir.
Le taux de patients métastatiques au moment du dia-
gnostic dans les deux communautés est particulière-
ment bas, ce qui peut témoigner du bon niveau d’infor-
mation des patients et des médecins constituant notre
réseau de proximité.
La majorité des patients se présente donc avec des
tumeurs cliniquement localisées ou localement avan-
cées et ces données rejoignent tout à fait celles consta-
tées aux Etats-Unis : pour les patients diagnostiqués
entre 1989 et 1994, 8% des patients blancs avaient des
métastases contre 14% chez les noirs [23].
De manière assez surprenante et alors que les
Américains constatent de manière récurrente des diffé-
rences très significatives des taux de PSA entre les
noirs et les blancs au moment du diagnostic de cancer
de la prostate [23, 25, 32] – les noirs ayant un PSA plus
élevé –, nous ne constatons pas de différence au
moment du diagnostic entre les taux moyens de PSA
dans les deux communautés ni même lorsque le PSA
est rapporté à l’âge. Encore que ce soit chez les patients
les plus jeunes (moins de 50 ans) que le taux de PSA
semble le plus significativement différent (11.6 ng/ml
pour les noirs contre 6 ng/ml pour les blancs). Il est dif-
ficile de trouver des explications rationnelles à ces dif-
férences puisque les raisons mêmes des taux de PSA
plus élevé chez les noirs américains ne sont pas connus.
Ceci pourrait néanmoins résulter d’une meilleure prise
en charge de la population afro-antillaise dans notre
pays menant à un diagnostic plus précoce [3, 26, 29].
Les données biopsiques au moment du diagnostic sont
originales et n’ont pas été étudiées dans les travaux
nord-américains. Nous constatons donc que même s’il
semble que la prise en charge globale du cancer de la
prostate à un stade précoce dans la communauté noire
française soit bonne compte tenu de l’âge et du niveau
du PSA au moment du diagnostic - les tumeurs détec-
tées sont de plus gros volume que chez les caucasiens.
En effet, le nombre moyen de biopsies positives et la
proportion moyenne de tissu biopsique envahi par la
tumeur sont plus importants chez les noirs que chez les
blancs. Le score de Gleason n’est quant à lui pas affec-
té par les différences ethniques alors que les données
nord-américaines vont dans le sens d’une plus mauvai-
se différenciation tumorale au moment du diagnostic
chez les noirs. De fortes variations individuelles d’ap-
préciation du score de Gleason sont sans doute à l’ori-
gine de ces contradictions [27].
Chez les patients ayant une tumeur cliniquement loca-
lisée à la glande et soumis à une prostatectomie radica-
le, les auteurs américains soulignent une plus forte
234
V.Ravery et coll., Progrès en Urologie (2000), 10, 231-236

proportion de tumeur localement avancée pT3 chez les
noirs, 69% versus 57% dans une étude récente de
POWELL [28] ainsi que la plus forte proportion de
marges chirurgicales positives chez les noirs (58%
contre 40% dans la même étude). Ces données sont
confirmées par plusieurs autres auteurs [21, 31] qui
décrivent une différence statistiquement significative
entre les deux communautés concernant les taux d’ef-
fractions capsulaires et de marges d’exérèse positives
sur les pièces de prostatectomie radicale [28], de même
qu’un score de Gleason plus élevé chez les noirs. Nos
données sont opposées puisqu’à l’inverse de ce qui est
constaté aux Etats-Unis le taux de tumeurs pT3 et le
taux de marges d’exérèse positives sont moins impor-
tants dans le groupe de patients noirs. Là encore, les rai-
sons de telles différences ne sont pas établies mais
résultent possiblement d’une différence de comporte-
ment biologique du cancer de la prostate à un stade pré-
coce dans les communautés noires des deux pays, due à
des facteurs environnementaux (climatiques ou alimen-
taires) voire même génétiques, en raison du métissage
antillais ou des pays africains d’origine des noirs.
Enfin, concernant l’échappement biologique après
prostatectomie radicale, nous ne constatons pas de dif-
férence significative entre les différentes communau-
tés, à l’inverse là encore de ce qui est constaté aux
Etats-Unis [22]. Néanmoins, lorsque les patients noirs
récidivent, ils le font plus précocement que les blancs
ce qui peut témoigner d’un comportement évolutif dif-
férent des tumeurs résiduelles après prostatectomie
radicale dans ces groupes ethniquement différents.
Nos données confirment donc que l’influence des races
sur l’histoire naturelle des tumeurs de la prostate est pro-
bablement variable d’un pays à l’autre et qu’aucun
modèle n’est strictement superposable à un autre. Le
comportement biologique des tumeurs prostatiques
détectées et opérées dans la communauté française d’ori-
gine afro-antillaise est certainement influencé par de
nombreux facteurs (environnementaux, comportemen-
taux ou génétiques) différents de ceux d’autres pays.
CONCLUSIONS
Cette étude, menée chez des français d’origine afro-
antillaise, vivant en métropole depuis plusieurs années,
ne confirme pas toutes les données nord américaines.
- Le score de Gleason n’est pas différent de celui des
caucasiens, ni sur les biopsies au moment du diagnos-
tic, ni sur les pièces de prostatectomie radicale en cas
de tumeur cliniquement localisée à la glande.
- Le taux de tumeurs localement avancées (pT3) est
même significativement plus élevé chez les caucasiens
en cas de prostatectomie radicale.
- Le taux de marges d’exérèse positives, qui certes ne
reflète pas complètement les caractéristiques de la
tumeur et comporte une part subjective liée à l’opéra-
teur, est plus élevé dans le groupe caucasien.
- Les noirs progressent après prostatectomie radicale
dans les mêmes proportions que les caucasiens.
Néanmoins, certaines caractéristiques sont identiques à
celles des Etats-Unis :
- Les noirs sont plus jeunes au moment du diagnostic et
au moment de la prostatectomie radicale.
- Les tumeurs prostatiques, détectées au moment du
diagnostic chez les noirs, semblent plus volumineuses,
car elles sont détectées avec plus de biopsies positives
et plus de tissu biopsique est envahi par la tumeur.
- Les noirs progressent biologiquement plus vite que
les caucasiens après prostatectomie radicale.
Ces données préliminaires donnent à penser que les his-
toires naturelles des tumeurs prostatiques chez les noirs
d’Amérique du Nord et de France sont possiblement
différentes, influencées par des facteurs d’environne-
ment (climatiques, alimentaires…) qui restent à étudier.
Les différences de flux migratoires entre les deux conti-
nents, c’est-à-dire les pays africains d’origine des
migrants, peuvent également expliquer certaines diffé-
rences génétiques, qui influenceraient les caractéris-
tiques du cancer de la prostate dans ces communautés.
Ces données, nouvelles en Europe, nécessitent incons-
testablement des investigations supplémentaires sur de
plus larges cohortes de patients et dans d’autres pays.
REFERENCES
1. ABDALLA I., RAY P. : Race and serum prostate-specific antigen
levels : current status and future directions. Sem. Urol. Onc., 1998,
16, 207-213.
2. AUSTIN J .P., AZIZ H., POTTERS L., THELMO W., CHEN P.,
CHOI K., BRANDYS M., MACCHIA R.J., ROTMAN M. :
Diminished survival of young blacks with adenocarcinoma of the
prostate. Am. J. Clin. Oncol., 1990, 121, 761-762.
3. BAQUET C.R., HORM J.W., GIBBS T., GREENWALD P. : Socio-
economic factors and cancer incidence among blacks and whites. J.
Natl. Cancer Inst., 1991, 83, 551-557.
4. BRAWN P.N., JOHNSON E.H., KUHL D.L., RIGGS M.W.,
SPEIGHTS V.O., JOHSON C.J., PANDYA P.P., LIND M.L., BELL
N.F. : Stage at presentation and survival of white and black patients
with prostate carcinoma. Cancer, 1993, 71, 2569-2573.
5. BRAWLEY O.W., KNOPF K., MERRILL R.: The epidemiology of
prostate cancer Part I : descriptive epidemiology. Sem. Urol. Onc.,
1998, 16, 187-192.
6. BRAWLEY O.W., KNOPF K., MERRILL R.: The epidemiology of
prostate cancer Part II : descriptive epidemiology. Sem. Urol. Onc.,
1998, 16, 193-201.
7. BRAWLEY O.W. : Prostate cancer and black men. Sem. Urol. Onc.,
1998, 16, 184-186.
8. BUTTYAN R.S., SAWCZUK I.S., BENSON M.C., SEIGAL J.D.,
OLSSON C. : Enhanced expression of the c-myc protooncogene in
high-grade human prostate cancers. Prostate, 1987, 11, 327-337.
235
V.Ravery et coll., Progrès en Urologie (2000), 10, 231-236
 6
6
1
/
6
100%