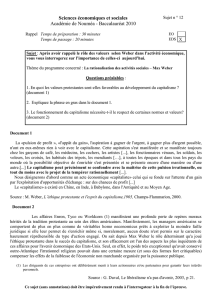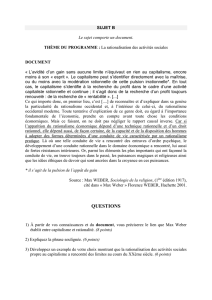Raberh ACHI, agrégé de sciences sociales, allocataire de

Raberh ACHI,
agrégé de sciences sociales, allocataire de recherche à
l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence et maître de
conférences pour le cours ‘Histoire économique de l’Europe et globalisation (1800-2000)’
à l’Institut d’études politiques de Paris.
Dossier de conférence n° 4 :
Max Weber et les facteurs ‘culturels’ du capitalisme.
________
De nombreux auteurs ont tenté d’analyser le capitalisme comme problème
historique (J. Baechler) et plus précisément de le restituer dans sa dimension
historique pour mettre en lumière son évolution et ses ruptures jusqu’à ses formes
contemporaines (I. Wallerstein). Cette tradition trouve dans l’œuvre de Max Weber
(1864-1920) une source majeure d’inspiration, notamment dans sa tentative de
comprendre le développement inégal du capitalisme dans le monde et ses
explications ‘culturelles’1.
L’approche historique, économique et sociologique du capitalisme est une des
principales entrées de l’œuvre prolixe de Max Weber. Elle se trouve développée
dans l’ensemble de ses textes. C’est dans L’éthique protestante et l’esprit du
capitalisme, dont les premiers résultats furent publiés en 1905, que se pose la
question de la singularité du capitalisme occidental moderne. L’auteur conçut ce
texte comme le développement préliminaire de toute son approche consistant à
repérer, par sa méthode comparative, les particularités de la rationalité du
capitalisme occidental par rapport aux formes historiques (non-occidentales) variées
que Weber repère dans les différentes religions à travers le bouddhisme,
l’hindouisme, le judaïsme, l’islam, le christianisme et le confucianisme2. C’est à partir
de l’éthique économique de ces religions que Weber infère les principales
caractéristiques des formes capitalistes observées pour en dégager une singularité
occidentale. Celle-ci a, selon Weber, pour facteur déterminant l’existence d’affinités
électives entre ce qui s’apparente dans le capitalisme et le protestantisme à une
quête de rationalité. Cette thèse fut très discutée pour apparaître finalement comme
la thèse de Max Weber. Aussi convient-il de revenir sur la définition que Weber
donne du capitalisme occidental moderne afin de sérier les facteurs qui ont contribué
à son développement. Cette démarche doit, dans l’œuvre wébérienne, toujours être
associée à l’exploration des formes non-occidentales du capitalisme et de leurs
déterminants pour préciser la question de la singularité occidentale et plus
précisément européenne. Cette dernière a suscité de nombreuses discussions et
controverses qui ont largement contribué à interroger les énoncés wébériens sur le
1 Par explication ‘culturelle’ il faut comprendre toute explication où la religion, et ses instrumentalisations
variées et parfois contradictoires, intervient dans une des causes de l’action, en l’espèce économique.
2 Cf. l’Introduction à L’éthique économique des religions mondiales in Sociologie des religions (1996).

2
capitalisme. Aussi c’est la raison pour laquelle il convient de faire un va-et-vient entre
ce qui relève, dans les textes de Max Weber, de l’économie ‘occidentale’, de la
particularité supposée de son capitalisme et des formes non-occidentales. Cela
permet à la fois la comparaison et apporte une réponse à la question de l’importance
des facteurs culturels pour le développement du capitalisme.
Il convient de partir de la définition wébérienne du capitalisme moderne (texte
n° 1) pour cerner les analyses situées ayant pour objet la singularité occidentale. En
outre, ces éléments permettent d’introduire la discussion de la question des facteurs
influençant le développement du capitalisme chez des auteurs s’étant fortement
inspiré des travaux de Weber pour en souligner à la fois le caractère pertinent de
l’analyse mais aussi, appliqué à des terrains historiques, pour relever certains contre-
exemples infirmant ou relativisant la théorie wébérienne (textes n° 2 et 3). Enfin,
certains se sont attelés à l’analyse de situations historiques capitalistes éludées en
partie par Max Weber pour montrer combien certaines ‘cultures’ étaient (et sont)
propices au développement de formes capitalistes (textes n° 4 et 5). Dans tous ces
textes c’est finalement ‘l’exception européenne’ vue par Max Weber qui est,
directement ou indirectement, interrogée.
______________

3
Texte n° 1 : Max Weber, ‘Qu’est-ce que le capitalisme moderne ?’, « Avant-
propos » au Recueil d’études de sociologie des religions, traduction de Jean-Pierre Grossein
in Sociologie des religions (pp. 493-501), 1996.
Le ‘désir du gain’, la ‘recherche du profit’, du profit monétaire, le plus élevé possible,
n’ont en eux-mêmes rien à voir avec le capitalisme. Cette recherche animait et anime toujours
les garçons de café, les médecins, les cochers, les artistes, les cocottes, les fonctionnaires
vénaux, les soldats, les brigands, les croisés, les piliers de tripot, les mendiants ; on peut dire
qu’on la retrouve chez all sorts and conditions of men, à toutes les époques et en tous lieux,
partout où il existe ou a existé, d’une manière ou d’une autre, la possibilité objective d’une
telle recherche. Cette conception naïve du capitalisme devrait être abandonnée une fois pour
toutes, dès les leçons d’histoire de la civilisation pour enfants. L’avidité d’un gain sans
aucune limite n’équivaut en rien au capitalisme, encore moins à son ‘esprit’. Le capitalisme
peut s’identifier directement avec la maîtrise, ou du moins avec la modération rationnelle de
cette pulsion irrationnelle. En tous cas, le capitalisme s’identifie à la recherche du profit, dans
le cadre d’une activité capitaliste rationnelle et continue ; il s’agit donc de la recherche d’un
profit toujours renouvelé : de la recherche de ‘rentabilité’. […]
Commençons donc par donner des définitions plus précises qu’elles ne le sont
souvent. Un acte économique sera dit ‘capitaliste’ avant tout quand il repose sur l’attente d’un
profit obtenu par l’utilisation des chances d’échange, quand il repose, donc, sur des chances
de gain (formellement) pacifiques. Le gain obtenu par la violence (formelle et réelle) suit ses
propres lois, et il ne convient pas (même s’il est bien difficile de l’interdire à quiconque) de le
ranger dans la même catégorie que l’activité orientée (en dernière analyse) en fonction de
chances de profit obtenu par l’échange. Lorsque la recherche du gain capitaliste est
rationnelle, l’activité correspondante est orientée en fonction d’un calcul du capital. […]
Pour la définition conceptuelle seul importe le fait que l’activité économique soit
orientée effectivement et de façon décisive en fonction d’une comparaison du résultat avec
l’investissement, tous deux évalués en termes monétaires, et si primitive que soit cette
comparaison. Or, aussi loin que les documents économiques remontent, on retrouve dans
toutes les civilisations du monde un ‘capitalisme’, entendu dans ce sens, et des opérations
‘capitalistes’, même si le calcul du capital y est l’objet d’une rationalisation assez médiocre.
[…]
Toutefois, c’est l’Occident qui a conféré au capitalisme une importance et, ceci
expliquant cela, en a produit une quantité de variétés, de formes et d’orientations qui n’ont
existé nulle part ailleurs auparavant. […] Le capitalisme d’affaires, celui de la grande
spéculation, le capitalisme colonial ainsi que le capitalisme financier moderne, même en
temps de paix, mais surtout le capitalisme orienté spécifiquement vers la guerre revêtent
souvent encore le visage du capitalisme aventurier, et une partie – mais une partie seulement –
du grand commerce international, aujourd’hui comme toujours, s’en rapproche. Mais dans les
temps modernes, l’Occident connaît en outre une forme de capitalisme tout autre, et qui ne
s’est développée nulle part ailleurs : l’organisation capitaliste rationnelle du travail
(formellement) libre. On n’en trouve ailleurs que des rudiments. […]
L’organisation rationnelle de l’entreprise, orientée en fonction des chances offertes par
le marché des biens et non en fonction des chances de spéculation politiques ou irrationnelles,
cette organisation rationnelle de l’entreprise n’est pas la seule particularité du capitalisme
occidental. Elle n’aurait pas été possible sans la présence de deux éléments importants de
développement : d’une part, la séparation de la gestion domestique et de l’entreprise,

4
séparation qui domine entièrement la vie économique actuelle ; et d’autre part, directement
liée à ce premier élément, la comptabilité rationnelle. […]
Toutes ces particularités du capitalisme occidental n’ont acquis, en dernier ressort, leur
signification actuelle que par leur liaison avec l’organisation capitaliste du travail. Même ce
que l’on a coutume d’appeler la ‘commercialisation’, c’est-à-dire le développement des titres,
ainsi que la rationalisation de la spéculation, c’est-à-dire la bourse, sont également liées à
cette organisation. En effet, sans l’organisation rationnelle du travail capitaliste, tout cela, y
compris le développement de la ‘commercialisation’ – pour autant que cela ait été même
possible – aurait été loin d’avoir la même portée ; surtout en ce qui concerne la structure
sociale ainsi que tous les problèmes propres à l’Occident moderne qui sont liés à cette
structure. Le calcul exact – qui est le fondement de tout le reste – n’est possible précisément
que sur la base du travail libre. […]
Par conséquent, pour une histoire universelle de la culture, le problème central – d’un
point de vue purement économique – n’est pas pour nous, en dernière analyse, le déploiement
de l’activité capitaliste en tant que telle, dont seule la forme changerait : capitalisme
aventurier ou commercial, ou bien capitalisme lié à la guerre, à la politique et à
l’administration. Le problème concerne, au contraire, l’apparition du capitalisme d’entreprise
bourgeois, avec son organisation du travail libre. Ou, exprimé dans l’optique de l’histoire de
la culture, le problème central est celui de l’apparition de la bourgeoisie occidentale dans sa
spécificité, laquelle est, à n’en pas douter, liée à l’apparition de l’organisation capitaliste du
travail, sans pour autant s’identifier simplement à cette dernière. En effet, l’existence de
‘bourgeois’, définis comme un corps social, a précédé le développement du capitalisme
spécifiquement occidental. Et cela ne s’est produit qu’en Occident. […]
Ce qui importe […] en premier lieu, c’est de reconnaître et d’expliquer dans sa genèse
la particularité du rationalisme occidental et, à l’intérieur de celui-ci, du rationalisme
occidental moderne. Toute tentative d’explication de ce genre doit, eu égard à l’importance
fondamentale de l’économie, prendre en compte avant toute chose les conditions
économiques. Mais, ce faisant, on ne doit pas négliger le rapport causal inverse. Car, si
l’apparition du rationalisme économique dépend d’une technique rationnelle et d’un droit
rationnel, elle dépend aussi, de façon certaine, de la capacité et de la disposition des hommes
à adopter des formes déterminées d’une conduite de vie caractérisée par un rationalisme
pratique. Là où une telle conduite de vie a rencontré des entraves d’ordre psychique, le
développement d’une conduite de vie rationnelle dans le domaine économique a rencontré, lui
aussi, de fortes résistances intérieures. Or, parmi les éléments les plus importants qui ont
façonné la conduite de vie, on trouve toujours, dans le passé, les puissances magiques et
religieuses ainsi que les idées éthiques de devoir qui sont ancrées dans la croyance en ces
puissances. C’est de ces éléments qu’il est question dans les études que nous avons
rassemblées et complétées dans les pages qui suivent.
Nous avons placé en tête de ce recueil deux études déjà anciennes (L’éthique
protestante et l’esprit capitalisme suivi de Les sectes protestantes), qui tentent d’aborder, sur
un point important, l’aspect du problème généralement le plus difficile à appréhender :
comment certains contenus de croyances religieuses ont conditionné l’apparition d’une
‘mentalité économique’, autrement dit l’ethos d’une forme d’économie, et ceci en prenant
l’exemple des relations de l’ethos économique moderne avec l’éthique rationnelle du
protestantisme ascétique. Nous ne nous occupons donc ici que d’un versant de la relation
causale. Les études suivantes, qui portent sur l’éthique des religions de civilisation les plus
importantes avec l’économie et la structure sociale qui les environnent, tentent de suivre les
deux relations causales aussi loin qu’il le faut pour trouver les points de comparaison avec le
développement occidental, lequel restera ensuite à analyser. Il n’y a, en effet, pas d’autre
moyen pour établir une imputation causale un tant soit peu univoque des éléments de

5
l’éthique économique religieuse de l’Occident qui sont propres à celle-ci et l’opposent ainsi à
d’autres. Ces études ne prétendent donc pas constituer – même avec concision – des analyses
culturelles qui feraient le tour de leur objet. Au contraire, c’est de propos tout à fait délibéré
qu’elles soulignent dans chaque domaine de civilisation ce qui était et demeure en opposition
avec le développement de la culture occidentale.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%