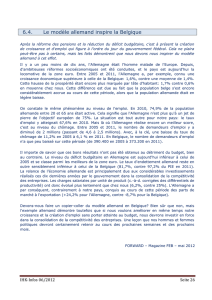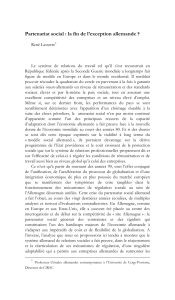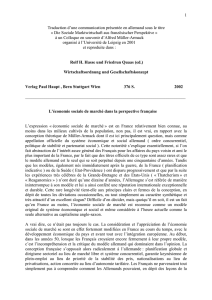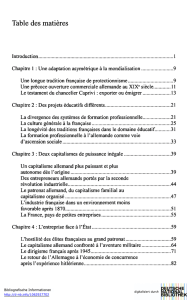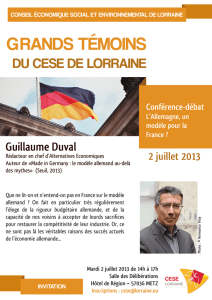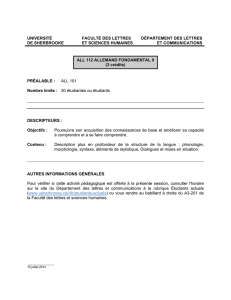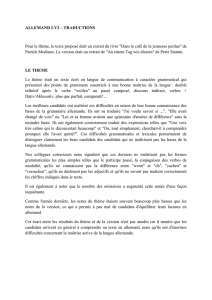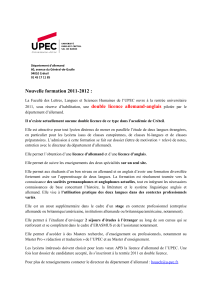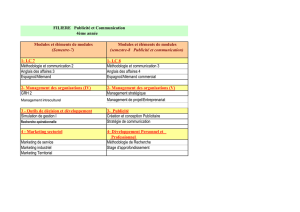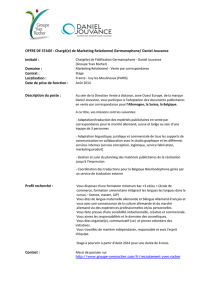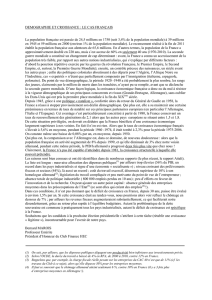Test PDF

1
Séminaire « Initiation à la philosophie politique »
4-8 février 2013
« L’Allemagne »
Edouard Jourdain
L’Allemagne est un Etat riche d’un héritage complexe qu’il est nécessaire d’appréhender
pour comprendre son rôle moteur dans la construction européenne contemporaine. Ses
relations avec la France ont été tumultueuses et sont encore souvent l’objet d’incompréhensions
réciproques. A l’occasion des cinquante ans du traité de l’Elysée, cela a été l’occasion pour
l’Institut des hautes études sur la justice de revenir sur l’histoire politique, juridique et
philosophique de ce pays lors du séminaire de philosophie politique, qui a eu lieu du 4 au 8
février 2013 dans le cadre de la formation continue des magistrats à l’Ecole nationale de la
magistrature. Il s’agissait d’appréhender l’Allemagne dans ses diverses composantes juridiques,
philosophiques, historiques et politiques, sans oublier ses relations complexes avec la France.
Dans cette perspective, ce séminaire s’est articulé autour de cinq grands axes : la pensée
juridique allemande, la philosophie allemande, le nazisme, le fédéralisme et le patriotisme
constitutionnel et enfin les perspectives croisées entre France et Allemagne.
I / La pensée juridique allemande
Olivier Jouanjan : Une histoire de la pensée juridique allemande
Hans Kelsen postule que le droit « n’existe pas » en tant que tel : seules existent des
manifestations juridiques avec des masses de textes. Nous pouvons ainsi émettre l’hypothèse
suivante : le droit ne peut pas fixer son propre fondement. Les juristes ont besoin d’une
justification théorique qui n’est pas dans le droit. Cette justification théorique se retrouve
notamment avec la norme fondamentale de Kelsen : il nous faut tenir pour valide cette norme
suprême qui se traduit pas la constitution et est en quelque sorte hors du droit. Il nous faut un
point de départ qui est une idéologie fondamentale nous permettant de mettre de l’ordre dans le
droit.
Le problème fondamental de la dogmatique allemande du XIXème siècle tourne autour du droit
subjectif et donc du sujet de droit. Les théories de Georg Jellineck, dans la lignée du néo-
kantisme, vont contribuer à développer ces théories du droit subjectif. Le droit subjectif est un

2
pouvoir de la volonté. Gellineck va introduire dans le droit subjectif une dimension matérielle :
l’intérêt, concept qui n’est pas kantien.
Ce qui caractérise un sujet, c’est la conscience de soi. L’histoire de la philosophie du droit en
Allemagne va être aussi une histoire du sujet, élaboré par des philosophes successifs comme
Kant, Schelling ou Savigny. Le kantisme ne franchit pas la barrière entre le sujet et l’objet. Or
pour Schelling le sujet est un processus de production de soi : dans le sujet est inscrit une
histoire. C’est dans l’inconscient collectif qu’il faut chercher les racines les plus profondes de
notre rapport à l‘Histoire. C’est le début d’une idée de la conscience historique. « Le siège
véritable du droit est la conscience populaire ». L’histoire d’un peuple est l’histoire complexe du
rapport à soi-même. Selon Savigny, les juristes sont un sujet actif, la science juridique est
l’expression de la conscience juridique d’un peuple. Comment le droit subjectif vient s’insérer
dans l’historicisme ? Pour Savigny, le rapport entre sujets est premier et fondamental.
Il s’agit de déterminer ce qu’est la volonté publique. La volonté publique domine les volontés
privées. Le problème, c’est qu’il n’y a pas de théorie de la volonté des dominés : le dominant
évacue la volonté des dominés en excluant toute possiblité de contre-pouvoirs des dominés.
Quel type de personne juridique est l’Etat ? Otto von Gierke, en développant le droit des
corporations et le système des droits publics subjectifs, entend montrer que l’Etat n’est pas
uniquement extérieur à l’individu et que son intérêt ne doit pas tout dominer.
Rainer Maria Kiesow : Le monde de Joseph K. : Le droit est-il une science (allemande) ?
Le monde de Joseph K. renvoie au roman de Kafka, Le procès. Il s’agit de quelqu’un de
complètement perdu dans un système juridique opaque propre au monde bureaucratique
moderne.
Joseph K. est aussi un professeur de droit allemand, il s’agit de Joseph Kohler. C’est une figure
phare de la science juridique allemande. Joseph Kohler a énormément écrit (170 ouvrages, 2700
publications) car il n'était pas uniquement juriste. Né en 1847 et décédé en 1919, il a inventé de
nombreux sujets de droit (comparatisme, droit des brevets,…), publié carnets de voyage, pièces
de théâtre et romans.
Les travaux de Joseph Kohler synthétisent et en même temps apportent une touche finale à un
siècle de controverses juridiques allemandes, marquées par trois principales querelles : 1-En
1814, une controverse oppose Savigny à Thibaud qui est aussi une controverse entre la France
et l’Allemagne. Thibaud opte pour le code civil des Allemands (il opte pour le peuple qui aurait le
droit de faire sa loi, pour un droit politisé). Savigny opte pour un peuple qui n’est pas représenté
à l’Assemblée mais par la voie scientifique. C’est le professeur allemand qui dit ce que le peuple
pense. Il fait des emprunts à la science naturelle et à la biologie. C’est Savigny qui remporte la
querelle.
2-En 1847, Kiershman, qui était un procureur de gauche, est intervenu sur l’ « inutilité de la
science du droit en tant que science », en d’autres termes le droit n’est pas scientifique. « Le
juristes sont des vers qui se nourrissent de bois pourri » (allusion aux livres). Il compare la
science du droit aux sciences naturelles : les sciences naturelles n’ont rien à faire avec le hasard
mais avec la nécessité. L’incertitude (et donc le hasard) est la mère du droit. Dans ce cas, le droit
ne peut être une science.

3
3-En 1872, Jhering affirme que le droit est régi par la lutte. La loi n’est rien d’autre qu’une
proposition. Qui est destinataire de la loi ? Les juges, les magistrats. Au centre des systèmes
juridiques ne se trouve ni le peuple, ni les parties mais le juge. Le droit n’est pas une affaire
d’intérêts, c’est une affaire de sentiments. L’énigme juridique de tous temps est que les juges ne
prennent jamais la même décision pour un cas similaire.
Kohler parle de Shakespeare et de son ouvrage Le marchand de Venise. Au XVème siècle, Shylock,
un juif, prête de l’argent et exige une sûreté (s’il ne paie pas il doit prélever un livre de la chair,
puis du cœur, d’Antonio). Antonio ne peut pas payer sa dette. Le Doge, à la Cour, fait appel à un
expert juridique qui confirme la possibilité de prélever la livre de chair. Par contre, s’il est versé
une goutte de sang, le juif est considéré comme un assassin potentiel (tentative de meurtre).
Jhering affirme que ce conte est horrible en ce qu’il rend compte de l’interprétation littérale de la
loi. Or Kohler soutient que cette assertion de Jehring est erronée : il ne voit pas que l’évolution
du droit va vers davantage d’humanité.
Robert Jacob : Le prétendu « droit germanique »
La tradition juridique allemande est marquée par la valorisation du peuple allemand entendu
comme ethnie. Ce « génie ethnique » correspond aux trois volets de l’œuvre des frères Grimm : la
langue, le droit (non textuel) et le mythe. Leurs contes pour enfants constituaient une
ethnographie du peuple allemand.
Pour les juristes allemands du XIXème siècle , le droit évolue en trois étapes : 1-La coutume, 2-La
législation (produit d’une autorité politique qui ne peut pas bien comprendre l’âme du peuple),
3-La science (il s’agit de reconstituer un droit primordial pour en faire un droit positif moderne).
Le juriste est un organe du peuple habilité à créer la norme, c’est la science qui crée sa légitimité.
Les juristes vont alors créer une sorte de mythe historiographique. Ce qu’il y a de faux dans le
postulat de départ, c’est l’identité entre le droit et la langue, or le droit germain n’existe pas au
Moyen-âge, il est essentiellement issu du droit romain. Pourtant, pour les juristes comme
Savigny l’existence d’un prétendu droit germanique va permettre de forger le mythe d’un
peuple allemand luttant contre les influences étrangères, notamment via le droit. . Le défi posé
aux savants allemands est de dépoussiérer les textes juridiques. Une des caractéristiques de la
pensée juridique allemande est qu’il y a un ensemble de maillons qui s’enchaînent, des contes
des frères Grimm au nazisme.
Agnès Antoine : Le droit maternel de Bachofen
Le droit maternel est le titre, en 1861, d’un ouvrage de Bachofen. C’est un auteur au mieux cité,
rarement lu. Nietzsche notamment a été influencé pour son ouvrage sur la tragédie. Engels a
comparé son ouvrage au Capital ou à L’origine des espèces.
Bachofen a tenté d’explorer un nouveau continent, le droit maternel. Bachofen est un juriste
suisse originaire de Bâle. Il s’intéresse à l’antiquité et plus particulièrement au droit de la famille.
Son voyage en Italie va l’inciter à s’intéresser de plus en plus aux mythes. Selon lui il faut se
laisser saisir par l’histoire plutôt que l’enfermer dans des concepts. Dans quelle mesure les
mythes ont valeur de vérité ? Bachofen va généraliser le schème de la civilisation primitive qui
est selon lui gynécocratique. Il repère ce droit dans des sources comme le droit de la famille
(lignage avec la mère, attachement à une conception de la terre comme « matrie » (opposée à la
patrie),…

4
Qu’est-ce que le droit maternel ? C’est un droit naturel et premier, un matérialisme
(mater-ialisme), c’est la matière créatrice. Il existe un rôle civilisateur de la femme. La base
éthique du droit maternel valorise l’amour, la paix, l’attachement, le soin.
Bachofen va mettre en avant l’idée de religion primitive avec des déesses-mères qui enfantent,
des femmes initiatrices. La conception de l’histoire de Bachofen l’amène à montrer le
dépassement du droit maternel par le droit paternel qu’il juge positif. Le droit paternel est pensé
comme un inversement total du droit maternel. Il va mettre en exergue un autre côté de la
nature humaine. Le détachement physique par rapport au père (contrairement à la fusion que
l’on retrouve dans le droit maternel) va contribuer à la supériorité du droit paternel. Cela va
donner lieu à la métaphysique, au symbolique, à l’indépendance vis-à-vis de la mère, qui va
donner lieu à la déification du père. C’est le droit romain qui va notamment contribuer à réaliser
la transition des sociétés dominées par le droit maternel à des sociétés dominées par le droit
paternel.
II / La philosophie allemande
Gérard Rolet : Les paradoxes du romantisme politique
Il existe deux destins contradictoires du romantisme : l’un conservateur et l’autre
révolutionnaire. Le premier est un romantisme maternel et tourné vers le passé, alors que le
second est masculin et tourné vers le futur. Il n’y a pas de fatalité réactionnaire du romantisme :
à ses débuts nous observons davantage un engagement libéral en opposition au pouvoir. Pour
les romantiques, la révolution s’entend comme le rétablissement du bon ordre des choses.
Le premier romantisme est ancré dans l’idéalisme a allemand, avec un refus de la conception
abstraite de la représentation. Le député doit incarner l’homme du peuple, qu’il soit élu ou non.
Il y a toujours au sein du romantisme allemand une autre façon de concevoir les Lumières. Le
siècle nouveau doit être celui de l’imaginaire, des liens organiques contre un rationalisme froid
incarné par les machines mécaniques. L’Etat est parfois considéré comme une machine
mécanique (Novalis). Le romantisme se développerait alors en réaction au capitalisme d’Etat
(allemand) et contre l’individualisme quantitatif du libéralisme anglo-saxon (et non le
libéralisme allemand dont ils se considèrent comme des contributeurs). Entre l’individu et l’Etat,
les romantiques cherchent des liens organiques. Le désenchantement du monde s’accompagne
d’un intérêt pour l’ésotérisme, l’imaginaire, etc. Le souvenir du passé peut servir d’arme pour
lutter pour le futur. Les romantiques n’avaient pas une philosophie politique du droit naturel.
Plus que le nationalisme, ce qui se développe est la défense des individualités. Il n’y a pas de
programme politique du romantisme, il y a davantage une posture vis-à-vis de la modernité qu’il
faut dépasser avec l’ancien concept de République. La modernité est le temps de l’ébranlement
des certitudes. Le religieux constitue la fondation du corps social et la raison a besoin d’une
mythologie. Ce qui intéresse les romantiques, ce n’est pas tant le dogme que le point de
référence. Le romantisme, en raison de son instrumentalisation, va être accusé de tous les maux
en 1945 en ce qu’il aurait conduit au nazisme (c’est par exemple le propos de Norbert Elias).
Jean-Marc Durand-Gasselin : L’Ecole de Francfort
L’Ecole de Francfort est née dans les années 1930 dans la perspective d’un renouvellement de la
pensée marxiste. Dans cette perspective, cette école, avec des auteurs comme Horkheimer,
Neumann ou Adorno, va tenter notamment de renouveler la pensée du droit, parfois trop laissé

5
de côté dans les courants marxistes orthodoxes. Quelle est la place virtuelle du droit dans le
projet de Max Horkheimer ? Le premier grand axe est le rapport au marxisme qui pense le droit
subordonné à la structure économique. Le droit pour Marx est un instrument et une illusion
efficace. Avec Horkheimer, l’Etat de droit est revalorisé dans le cadre de la lutte sociale. Ce
courant social-démocrate va venir se coller à la théorie critique. Un autre mouvement va
s’opposer à cette dimension sociale-démocrate (de Rosa Luxembourg à Lukács). Lukacs va
considérer l’Etat de droit comme une aliénation, une réification. Lukacs s’appuie sur les travaux
de Max Weber qui affirme que le droit social a tendance à se bureaucratiser. Horkheimer ne
cultive pas le marxisme dans sa dimension dogmatique. Il est très éclectique et va tenter de
composer avec deux grands courants de son époque : la philosophie de Heidegger et le Cercle de
Vienne (animé principalement par des scientifiques, avec notamment Carnap, Friege et
Wittgenstein).
Polock est un spécialiste d’économie politique planifiée. En 1932, il affirme que le propre du
capitalisme de la fin du XIXème siècle est la formation des monopoles : ce qui prend fin ce n’est
pas le capitalisme mais sa phase libérale. La seconde personne à jouer un grand rôle est le
psychanalyste Eric Fromm, qui va dresser le portrait psychologique de l’individu dans le
capitalisme tardif. La troisième est Adorno qui développe la critique de la culture de masse.
Pour Adorno, le nazisme est une sorte de théâtre « kitsch » et répressif. La défaite du nazisme
n’est pas une rupture, il insiste avant tout sur les continuités. Herbert Marcuse va parler de la
culture de masse comme sublimation régressive. L’Ecole de Francfort se renouvelle avec
notamment Ottö Kircheimer (Peine et structure sociale, 1939) et Franz Neumann (Behemoth,
Structure et pratique du national-socialisme, 1942). Les premiers rédigent leur livre dans le
cadre des émeutes qui ont lieu aux Etats-Unis lors de la grande dépression des années Trente.
Dans Peine et structure sociale ils établissent une fresque historique du rapport entre droit et
marché du travail. Neumann, dans Béhémoth, s’appuie quant à lui sur Carl Schmitt pour montrer
la distorsion de l’Etat de droit avec l’armée, le capital et l’administration.
Michaël Löwy : Max Weber et la cage d’acier
Au début du XXème siècle se développe chez les intellectuels allemands une certaine critique de
la modernité. Le pessimisme culturel a lieu dans le prolongement de la critique romantique
allemande. Ce courant romantique se divise entre conservateurs et utopistes. Max Weber
appartient à un troisième pôle qui est le romantisme résigné (on ne peut revenir en arrière et on
ne peut créer un autre monde). Son livre L’Ethique protestante et l’esprit du capitalisme est
purement historique mais sa conclusion constitue un jugement de valeur. Il commence avec une
référence à Goethe qui a compris que l’économie moderne est désormais dominée par la
spécialisation et que nul retour en arrière n’est envisageable. Aux yeux des théologiens
protestants, les biens sont devenus une cage d’acier, comme une fatalité. Le prophète est une
figure importante chez Weber : avant les prophètes, la religion se réduit à la magie alors qu’avec
eux la religion devient éthique. Ce qui nous attend est un monde sans esprit et sans cœur lié à la
mécanisation. Nous sommes désormais dans le vide, dans le néant.
La cage d’acier est parfois liée à la bureaucratie mais surtout à l’ordre économique capitaliste.
Weber se réfère à l’Egypte ancienne comme la maison de la servitude (telle qu’elle fut pour le
Juifs). La cage d’acier est ainsi une allégorie qui est le visage malade de l’histoire : elle évoque
l’idée d’un enfermement, d’une perte de liberté, d’un esclavage sans maître. C’est le système qui
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%