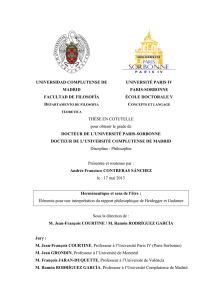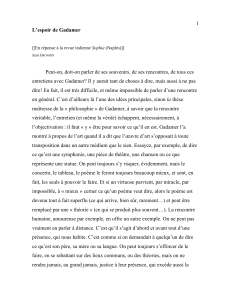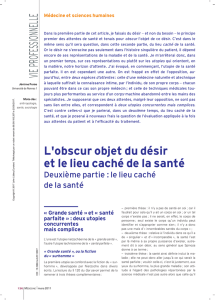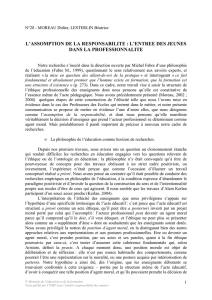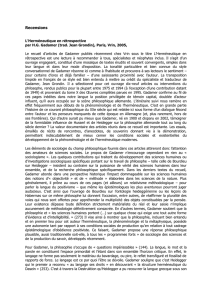La structure dialogique du comprendre et son modèle


ii
Université de Montréal
Le dialogue herméneutique et ses sources platoniciennes
Étude sur la place de Platon dans l’herméneutique de Gadamer
Par
Rudolf Boutet
Département de philosophie
Faculté des arts et des sciences
Mémoire présenté à la Faculté des Études supérieures en vue de l’obtention du grade
de M.A. en philosophie
Août 2014
© Rudolf Boutet, 2014

iii
Résumé
Avant tout réputé pour avoir hissé l’herméneutique au premier plan du paysage philosophique
contemporain, H.-G. Gadamer est aussi reconnu pour l’originalité de ses écrits en histoire des
idées et notamment pour la grande singularité des travaux qu’il a consacrés à la philosophie de
Platon. Mais s’agit-il là de deux registres théoriques distincts, l’herméneutique d’un côté et
l’exégèse de Platon de l’autre ? Ou bien s’agit-il de deux facettes d’un même projet concerté, deux
ouvertures sur un même objet philosophique ? C’est cette deuxième option que notre étude a pour
objectif de défendre. Pour ce faire, nous approfondissons, à la lumière de ses écrits sur Platon, les
raisons qui poussent Gadamer à développer, dans Vérité et Méthode, son idée de dialogue
herméneutique en référence constante à la dialectique platonicienne, pour ensuite montrer
comment l’ontologie herméneutique qu’esquisse la dernière partie de Vérité et Méthode est solidaire,
voire tributaire, de l’interprétation de la pensée platonicienne que défend généralement Gadamer,
et ce, malgré l’instrumentalisme du langage qu’il dénonce chez Platon.
Mots-clés : Philosophie, herméneutique, ontologie, dialectique, Gadamer, Platon.
Abstract
Known above all to have raised hermeneutics in the foreground of contemporary philosophy, H.-
G. Gadamer is also renowned for his original contributions to the history of ideas, notably because
of his characteristic reading of Plato. However, a question arises: are these two distinct parts of his
thought, with his philosophical hermeneutics on the one hand and his exegesis of Plato on the
other? Or are they the two facets of a same project, two perspectives on a same philosophical
object? Our study aims to defend this second option. In the first place, we present, in light of
Gadamer’s reading of Plato, the reasons why in Truth and Method Gadamer develops his own idea
of hermeneutical dialogue in reference to Plato’s dialectic. Then we will show how the
hermeneutical ontology sketched in the last chapter of Truth and Method remains strongly related to
Gadamer’s general reading of Plato, even if Gadamer refuses the instrumentalism of language that
he finds in Plato’s thought.
Keywords : Philosophy, hermeneutics, ontology, dialectic, Gadamer, Plato

iv
TABLE DES MATIÈRES
ABRÉVIATIONS vi
REMERCIEMENTS vii
Introduction 1
Chapitre 1 : Les grandes lignes d’une herméneutique philosophique de Platon 8
1. Principes et applications de l’interprétation phénoménologique 8
1.1. L’influence du jeune Heidegger 8
1.2. La mimèsis dialogique de Platon : une réorientation de la destruction 12
herméneutique
1.3. La destruction gadamérienne du chorismôs des Idées 17
2. La dialectique platonicienne selon Gadamer 21
2.1 Le caractère paradigmatique du Philèbe 21
2.2. La réponse dialectique au problème de l’un et du multiple 25
2.3. La dialectique comme « disposition »… anti-sophistique 30
Chapitre 2 : La structure dialogique du comprendre et son modèle platonicien 37
1. Le problème de la vérité herméneutique et le recours au dialogue 37
2. Compréhension, dialogue et sophistique 40
2.1. L’art de questionner, l’art de comprendre 40
2.2. La réactivation dialectique de l’écriture 43
2.3. Le paradigme socratique et l’expérience herméneutique 44
2.4. L’enjeu du dialogue 47
3. L’épreuve dialectique de la vérité 50
3.1. Le problème des préjugées 50
3.2. Le cercle du tout et des parties ou la dialectique immanente 54
3.3. Maïeutique et anamnèsis herméneutique 57
4. Le tournant linguistique du dialogue herméneutique 63
4.1. L’entente langagière 63

v
4.2. L’entente dialogique, une « simple métaphore » ? 66
4.3. Identité de la chose et différence d’application 68
Chapitre 3 : Dialectique, spéculation et langage 73
1. L’ambivalence de Platon quant à la question du langage 73
1.1. La dialectique platonicienne, un anti-modèle ? 73
1.2. La « décision » recouvrante du Cratyle 74
1.3. Quelques limites de la critique adressée à Platon 80
2. La nature spéculative de l’herméneutique 82
2.1. Le spéculatif philosophique 82
2.2. L’élément spéculatif du langage 85
2.3. La dialectique de l’interprétation et l’objet de l’herméneutique 92
3. Les sources platoniciennes de l’ontologie herméneutique 96
3.1. L’ontologie du logos 96
3.2. L’herméneutique, une métaphysique du Beau ? 99
BIBLIOGRAPHIE 105
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
1
/
119
100%
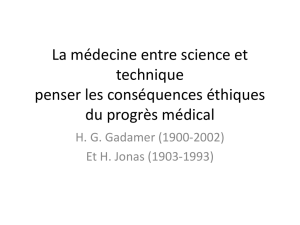
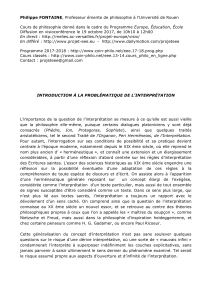

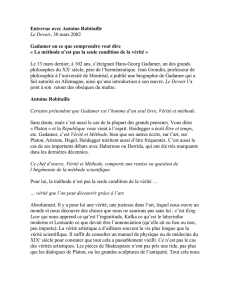
![Un pape philosophe [La Presse, 3 avril 2005] Jean Grondin](http://s1.studylibfr.com/store/data/004602676_1-91381956bcf4047a8f22ff5ea2c9d984-300x300.png)