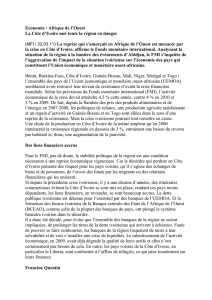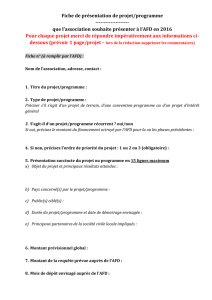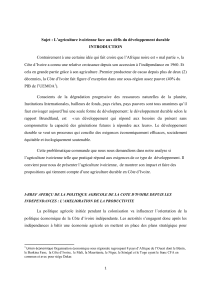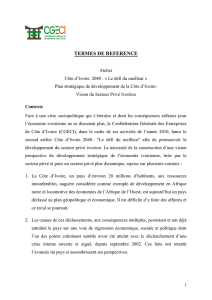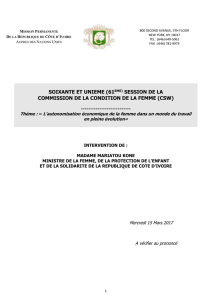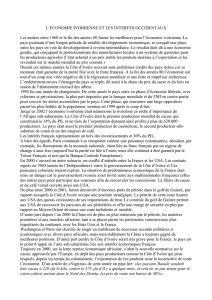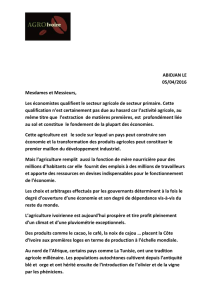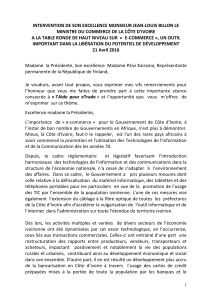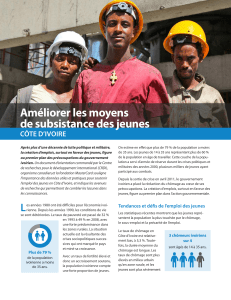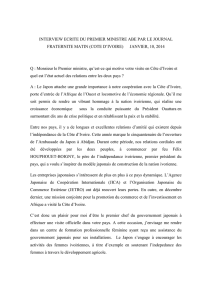image

au Sud
DU SAHARA
LA LETTRE DU DÉPARTEMENT AFRIQUE SUBSAHARIENNE DE L’AFD
N°01
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2011
Bienvenue Au sud du Sahara ! Voici le premier numéro de cette lettre bimestrielle, qui est celle des profession-
nels du département Afrique subsaharienne de l’AFD, qu’ils soient à Paris ou dans l’une de ses trente agences
ou représentations africaines. Dans le jargon si riche en acronymes de l’AFD on parle d’AFR. Trois lettres pour
qualifier une équipe qui travaille quotidiennement au plus près des réalités économiques et sociales du continent,
à travers un réseau qui couvre aujourd’hui la totalité de l’Afrique subsaharienne. Cette expertise fait autorité, et
par là même, constitue une des richesses de l’AFD. Au sud du Sahara souhaite proposer un éclairage régulier sur
l’actualité et les défis de l’émergence africaine.
On a déjà beaucoup écrit sur les mutations démographiques inédites en cours, la croissance forte et résiliente du
continent ou l’essor de ses villes et de sa classe moyenne. Succédant à des décennies d’images le plus souvent
catastrophistes, pessimistes ou résignées, voici qu’arrive progressivement une Afrique en mouvement, “nouvelle
frontière” de la croissance mondiale et porteuse des forces vives de demain. Ce mouvement un peu fort de ba-
lancier traduit bien l’évolution rapide de la perception symbolique qui s’opère : l’Afrique n’est déjà plus cantonnée
à la marge du monde, puisqu’elle est au centre des enjeux globaux actuels et de ceux des décennies à venir. C’est
une bonne nouvelle. Que cette vision soit partagée le plus largement possible !
Mais l’ampleur des défis ne doit pas être sous évaluée pour autant. L’Afrique devra d’abord loger et nourrir un
milliard de femmes et d’hommes supplémentaires d’ici 2050. L’accès aux services de base que sont l’eau, l’énergie,
les transports, la santé ou l’éducation devra dans le même temps être assuré pour deux milliards de personnes, alors
qu’ils ne suffisaient pas, ni hier, ni aujourd’hui à satisfaire les besoins des 850 millions d’habitants. Enfin, l’évolution
favorable d’un indicateur macroéconomique, fût-il le PIB par habitant, ne fera pas, à lui seul, le décollage du continent,
notamment en raison des disparités qui existent entre les économies et surtout à l’intérieur des pays. Pour réussir,
la croissance devra être inclusive, portée notamment par un secteur privé formel fortement créateur d’emplois et
générateur de ressources pour les Etats. L’Afrique doit pour cela gagner la confiance des investisseurs, tant continen-
taux qu’internationaux.
Au sud du Sahara tentera d’enrichir, en fonction de l’actualité africaine, la perception que l’on peut avoir des dyna-
miques à l’œuvre sur le continent. Trois rendez-vous structureront chaque numéro : un dossier thématique ou
géographique, un regard sur notre action, et un agenda africain pour le trimestre à venir.
Le premier numéro d’Au sud du Sahara revient notamment sur la sortie de crise en Côte d’Ivoire et tente d’apporter
un éclairage sur les défis de la relance ivoirienne et sur ses enjeux régionaux. Les contributeurs de cette lettre sont les
femmes et les hommes qui font la richesse de notre réseau africain, et pour tout cela je les en remercie.
Je vous souhaite une très bonne lecture et vous remercie par avance pour vos critiques et vos conseils bien entendu.
Akwaba ! A ni sé ! Karibu !
02
DOSSIER
Les défis de la relance ivoirienne
06
FOCUS ACTIVITÉ
L’AFD en zone franc
07
AGENDA AFRICAIN
4ème trimestre 2011
l’Editorial
Dov Zerah DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AFD

02
AU SUD DU SAHARA - N°1 LA LETTRE DU DÉPARTEMENT AFRIQUE SUBSAHARIENNE DE L’AFD
défis et enjeux de la relance ivoirienne
LES IVOIRIENS ONT SU ÉVITER LE PIRE. LE PAYS EST FRAGILE, MAIS DEBOUT. QUE RESTE-T-IL DU MIRACLE
APRÈS QUINZE ANS DE CRISE ÉCONOMIQUE, BUDGÉTAIRE, SOCIALE, POLITIQUE, ET APRÈS PLUSIEURS ANNÉES DE CONFLIT
ARMÉ DONT LE PAROXYSME FUT ATTEINT AU MOIS DE FÉVRIER 2011 ? LES FORMES ET LE RYTHME QUE PRENDRA
LA RELANCE IVOIRIENNE SE POSENT AU PAYS, À LA SOUS-RÉGION ET À LEURS PARTENAIRES.
Dès 1960, la Côte d’Ivoire mise sur ses atouts
et fait des cultures d’exportation (cacao,
café, hévéa, palmier à huile...), le moteur de son
développement. La jeune république s’appuie sur
l’avancée d’un front pionnier, aux dépens de la fo-
rêt, grâce à une importante main d’œuvre en pro-
venance de différentes régions et des pays voisins.
DU MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT
À SON ESSOUFFLEMENT
Ce modèle a fort bien fonctionné jusqu’au dé-
but des années 1980. La croissance économique
ivoirienne est alors soutenue, générant une
rente importante, accaparée et gérée par l’Etat.
Elle a notamment permis d’équiper le pays en
infrastructures, d’améliorer l’accès aux services
sociaux et d’amorcer le développement des ré-
gions septentrionales.
Le modèle s’est pourtant vite essoufflé. Sur le
plan conjoncturel, deux évènements ont for-
tement fragilisé l’édifice. Au retournement des
cours mondiaux des produits qu’exportait la
Côte d’Ivoire, s’est ajouté le recours à un en-
dettement excessif pour pallier la contraction
induite de ses ressources financières. Faute de
pouvoir honorer le service de la dette, le passage
obligé par les institutions de Bretton Woods en
échange de leurs concours financiers, imposa
des programmes d’ajustement structurel qui
contraignirent plus encore les capacités d’inter-
vention de l’Etat.
Structurellement, le modèle de développement
ivoirien a achoppé sur deux points. Le pays n’a pas
su créer une industrie compétitive tournée vers
l’exportation lui permettant un meilleur équilibre
entre secteurs primaire et secondaire.
Le pays n’a pas non plus anticipé l’épuisement
progressif du stock de terres disponibles pour la
poursuite d’une mise en valeur agricole exten-
sive, sans que soit substitué à cette dernière un
modèle plus intensif. Ainsi, au début des années
quatre-vingt, l’économie ivoirienne s’essouffle
et la rente agricole ne suffit plus aux besoins de
redistribution.
EXPLOSION DÉMOGRAPHIQUE
ET TENSION FONCIÈRE
Dans le même temps, et en deux générations
seulement, la population ivoirienne a quintuplé.
A ce rythme, le simple maintien du niveau de PIB
par tête aurait supposé un taux de croissance
annuel moyen supérieur à 3 %. Mais la magie
des mots, sous le vocable de “miracle ivoirien”,
a trop longtemps occulté ce risque majeur. Cette
tendance lourde a provoqué une double tension
en ville et dans les campagnes.
À Abidjan, dont la population est passée de
300 000 habitants en 1960, à plus de quatre mil-
lions aujourd’hui, est arrivé sur le marché du tra-
vail un volant de main d’œuvre qui dépassait, et
de loin, les capacités d’absorption de l’économie
urbaine. Une population de jeunes chômeurs ou
de personnes en situation de grande précarité
s’est alors rapidement développée.
Dans les campagnes, l’appel à la main d’œuvre
(allogène ou allochtone) pour la mise en valeur
des terres et des cultures d’exportation débute
dès l’entre deux guerres et s’accroît significa-
tivement à partir des années 1950. Les conflits
agraires liés à ces mouvements de population
sont au moins aussi vieux.
Mais le mouvement massif, impulsé à l’indé-
pendance par Félix Houphouët Boigny, pour
conquérir de nouveaux espaces à cultiver en
faisant appel à la force de travail étrangère à qui
l’on proposait en retour un accès à la terre, s’est
heurté au rapport contradictoire entre diminu-
tion des surfaces cultivables et explosion démo-
graphique.
De nombreux affrontements dans l’ouest et le
sud-ouest du pays autour du contrôle du fon-
cier rural, ont eu lieu bien avant l’éclatement de
la crise politique des quinze dernières années.
L’ÉTINCELLE POLITIQUE
L’invention du concept d’“ivoirité” par le Président
Henri Konan Bédié, puis l’emploi qu’en fit Laurent
Gbagbo, dans le but d’écarter de la course à la
présidence le candidat Alassane Dramane Ouat-
tara accusé de n’être pas un véritable Ivoirien, a
pour origine ce contexte. Une croissance insuffi-
sante, la paupérisation de la population urbaine, la
présence importante de travailleurs immigrés et
la tension foncière ont fait converger les discours
politiques vers les questions identitaires.
La jeunesse urbaine désœuvrée a été un réservoir
de recrutement tant pour des activités illégales
que pour servir les ambitions d’entrepreneurs po-
litiques. Ils y ont recruté de “Jeunes Patriotes” pour
les uns ou le “Commando Invisible” pour les autres.
La crise ivoirienne,
du miracle consumé à l’étincelle
Les récents affrontements armés à Abidjan furent le point d’orgue d’une crise politique de succession qui débute au milieu des années 1990.
Elle prend racine bien au-delà, dans un temps plus long, celui du décollage économique et de la transition démographique.
0,6 %par an
C’est la croissance
moyenne du PIB en Côte d’Ivoire
depuis 2000.
CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
EN CÔTE D’IVOIRE
d’habitants en 2010
21 millions
d’habitants en 1960
3,4 millions
JeaN-BerNarD vÉroN RESPONSABLE
DE LA CELLULE CRISES ET CONFLITS DE L’AFD
lE doSSiEr DÉFIS ET ENJEUX DE LA RELANCE IVOIRIENNE

03
AU SUD DU SAHARA - N°1 LA LETTRE DU DÉPARTEMENT AFRIQUE SUBSAHARIENNE DE L’AFD
Les luttes politiques et militaires fratricides
ont eu des conséquences désastreuses
pour la population, la cohésion nationale et la
compétitivité de l’économie ivoirienne. Tout
en s’attelant à la construction de l’avenir de
leur pays à travers la mise en œuvre de l’ambi-
tieux programme du Président Ouattara pour
les cinq années à venir, les Ivoiriens doivent
d’abord gérer le lourd héritage des deux der-
nières décennies.
TOURNER LA PAGE
D’UN DÉCLIN ANNONCÉ
La Côte d’Ivoire, si souvent montrée en
exemple et promise à un statut de pays
émergent il y a trente ans déjà, est classée à
l’Indice de Développement Humain (IDH) en
2010 au 149ème rang, sur 169 pays, loin der-
rière le Cameroun, après le Bénin, le Togo
et le Sénégal. Le taux d’alphabétisation des
15-24 ans et le taux net de scolarisation pri-
maire ont chuté à respectivement 53% et
56% en 2008, tandis que la poliomyélite et le
choléra ont fait leur réapparition dans la ca-
pitale. L’atteinte des Objectifs du Millénaire
pour le Développement n’y est pas envisa-
geable d’ici 2015.
En réalité, les principaux indicateurs de
développement de la Côte d’Ivoire décli-
nent régulièrement depuis la fin de l’âge
d’or des années 1970, avec la chute des
cours des matières premières agricoles et
la détérioration des termes de l’échange
conjuguée à la surévaluation du franc CFA
au milieu des années 1980, puis du fait de
quinze années de crise politico-militaire et
d’impéritie. Le taux de pauvreté est ainsi
passé de 10 % de la population en 1985 à
49 % en 20081.
Le bilan de cette longue parenthèse de crise
latente et de conflits ouverts est lourd. Il faut
d’abord bâtir une cohésion nationale. La moi-
tié nord du pays doit être réintégrée dans la
vie économique, le réseau des infrastructures,
des institutions et des services sociaux. Il faut
également construire un Etat moderne doté
de pouvoirs et d’institutions intègres et trans-
parentes, en mesure de fournir aux popula-
tions des services de qualité. Le pays devra
se doter de services publics marchands pro-
fessionnels et nouer des partenariats avec le
secteur privé pour redonner sa place à l’éco-
nomie. Le chemin est encore long qui mènera
la Côte d’Ivoire au statut de pays émergent.
RELANCER UNE ÉCONOMIE
QUI PÉRICLITE...
Le coup d’Etat de 2002 a provoqué la parti-
tion de fait de la Côte d’Ivoire. L’économie
de sa moitié nord a vu son accès au port
d’Abidjan et au poumon économique qu’est
la capitale brutalement fermé. Si les grandes
entreprises ont réussi à maintenir leur activité,
notamment dans la filière cotonnière et le
négoce de produits agricoles, la friche indus-
trielle qu’est devenue Bouaké, la capitale du
Nord ivoirien, témoigne du choc économique
induit par la crise politique.
Au Sud, l’économie ivoirienne s’est réor-
ganisée autour de la ville d’Abidjan. Même
amputée de sa moitié nord, la Côte d’Ivoire
a conservé alors son statut de première éco-
nomie de l’UEMOA. Le pays est demeuré le
premier producteur mondial de cacao et le
premier producteur africain de caoutchouc,
et a continué d’héberger un nombre élevé
d’industries et de commerces à vocation
sous-régionale, voire internationale. Dans
ce contexte, la Côte d’Ivoire a toujours été
reconnue pour la compétence de ses élites
économiques.
Toutefois, son développement a été contraint
par la situation de crise latente. Les taux des
prêts bancaires demeurent élevés et leur ma-
turité limitée en raison du risque pays. L’en-
vironnement des affaires s’assombrit, avec
une administration (notamment fiscale et
douanière) prédatrice et une justice partiale.
Globalement, les politiques publiques sont
peu claires et donnent le sentiment d’un pilo-
tage court-termiste peu propice à l’investisse-
ment de long terme. La qualité de l’éducation
et de la formation se dégrade, de même que
les infrastructures routières et ferroviaires. Le
déficit des secteurs de l’eau et de l’électricité
se creuse, empêchant la réalisation des inves-
tissements de capacité nécessaires à la crois-
sance économique.
... MAIS QUI CONTINUE DE
DISPOSER D’UN SOCLE SOLIDE
ET D’ATOUTS INÉGALÉS DANS
LA SOUS RÉGION
Malgré cela, le socle économique de la Côte
d’Ivoire a fait preuve de résilience et demeure
une base solide. Aujourd’hui, avec un prési-
dent légitimement élu, la Côte d’Ivoire re-
trouve politiquement la place qui lui revient
au cœur de la sous-région et au sein de la
communauté internationale. Pour que ce re-
nouveau se traduise aussi économiquement,
le gouvernement doit faire preuve d’une vo-
lonté politique forte.
Peu de pays d’Afrique subsaharienne possè-
dent autant d’atouts que la Côte d’Ivoire
Côte d’Ivoire,
à la recherche du temps perdu
Le miracle ivoirien a fait long feu et le pays vient de traverser près de deux décennies de conflits plus ou moins ouverts.
Pourtant, le socle économique du pays a fait preuve d’une grande résilience et la Côte d’Ivoire conserve un potentiel économique inégalé au sein de l’UEMOA.
Est-ce à dire que le décollage longtemps retardé de la Côte d’Ivoire peut être à nouveau envisagé ?
L’ÉVOLUTION DE L’INDICE
DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN
IVOIRIEN PAR RAPPORT
À CELUI DE SES VOISINS
1990
0,3
0,32
0,34
0,36
0,38
0,4
0,42
0,44
0,46
0,48
1995 2000 2005 2010
Sénégal Cameroun Benin
Côte d’Ivoire Togo
Source : Rapport sur le développement humain 2010, PNUD
“ Le taux de pauvreté
est passé de 10%
de la population en 1985
à 49% en 2008.”
LE DOSSIER DÉFIS ET ENJEUX DE LA RELANCE IVOIRIENNELE DOSSIER

04
AU SUD DU SAHARA - N°1 LA LETTRE DU DÉPARTEMENT AFRIQUE SUBSAHARIENNE DE L’AFD
pour réussir le pari de redressement à
marche forcée qu’il s’est fixé. Sa position
géographique de hub économique au sein
de la communauté sous-régionale (UEMOA
et CEDEAO) dynamise le tissu économique
ivoirien. Le pays bénéficie également de la
richesse de ses sous-sols, avec un potentiel
minier et pétrolier conforté par les récentes
découvertes dans le golfe de Guinée.
Sa position dominante sur le marché mon-
dial du cacao est complétée par des com-
plexes agro-industriels performants in-
sérés dans l’économie mondiale (hévéa,
palmier à huile, coton, etc). Le pays est éga-
lement reconnu pour son savoir faire en
matières de services publics marchands et
de services sociaux. La Côte d’Ivoire possède
en effet une longue expérience des partena-
riats public privé (PPP) dans des domaines très
divers (BOT et concessions dans les services
publics marchands, délégation de service pu-
blic dans la santé et l’éducation, universités pri-
vées, jumelages universitaires, etc.). Enfin, si son
réseau d’infrastructures de base est à rénover,
il a une densité supérieure à la moyenne des
pays de la région (zones industrielles, aéroport,
ports autonomes, réseau revêtu, artère inter-
net haut débit, etc.).
La volonté de la nouvelle équipe au pouvoir
à redresser le pays semble, sous réserve de
confirmation dans la durée, bien présente. Trois
mois après la fin de la crise, de premiers élé-
ments significatifs allant dans ce sens peuvent
être relevés. Chaque ministre dispose doréna-
vant de sa feuille de route, d’un cadre logique
et d’une matrice de résultats à valider d’ici fin
2011. Par ailleurs, la transparence et l’éthique
sont mises en avant, dans la presse notamment,
comme nouvelles normes de gouvernance et
chaque ministre a signé la charte d’éthique du
gouvernement.
INCITER SES PARTENAIRES
AU DÉVELOPPEMENT À ÊTRE
À LA HAUTEUR DE L’ENJEU
Le succès de l’entreprise de reconstruction du
pays engagée par la nouvelle équipe reposera
avant tout sur le degré de confiance des opéra-
teurs économiques et des investisseurs, source
de croissance potentielle à deux chiffres dans
la mise en œuvre du programme présidentiel. Il
s’agira pour le gouvernement de multiplier les
partenariats public-privé et de mener conco-
mitamment un dialogue public-privé nourri
et l’assainissement visible et durable du climat
des affaires. C’est la clé pour attirer les Inves-
tissements Directs Etrangers dans le pays et
permettre à l’Etat d’emprunter sur les marchés
pour financer son programme économique.
Les partenaires techniques et financiers que
sont la Banque Mondiale, la France, et l’Union
Européenne, devraient compter dans cet effort
de redressement, ayant ensemble les capacités
et la volonté d’intervenir massivement et sur le
long terme.
L’enjeu sera de ne laisser aucun secteur orphe-
lin de l’aide extérieure lorsque les ressources
nationales ne permettront pas d’atteindre les
objectifs fixés. Ainsi, de façon assez classique,
les bailleurs devront répondre présents pour
le financement des infrastructures et des sec-
teurs sociaux, notamment pour rattraper le
dramatique décrochage des indicateurs de
l’éducation et de la santé durant les deux der-
nières décennies.
Mais ils devront également avoir le courage
d’accompagner l’Etat ivoirien sur des problé-
matiques plus complexes, requérant expertise
et ingénierie. Le financement de l’agriculture,
sinistré en Côte d’Ivoire, l’emploi et la réinser-
tion dans un contexte post-crise, les PPP pour
le financement des infrastructures les plus
ambitieuses (notamment dans les domaines
de l’énergie et des transports) et l’intégra-
tion sous-régionale, afin de rendre à la Côte
d’Ivoire son rôle de moteur de la croissance de
l’hinterland, sont au premier rang de ces défis
posés aux bailleurs par la relance ivoirienne.
Côte d’Ivoire, à la recherche du temps perdu (suite)
1 Source : Ministère ivoirien du Plan et du Développement,
Institut national de la statistique, Enquête sur le niveau de vie
des ménages 2008, p.5
EVOLUTION DE LA PART
DES INVESTISSEMENTS DIRECTS
ÉTRANGERS DANS LE PIB IVOIRIEN
ET DANS LA SOUS-RÉGION
Côte d’Ivoire UEMOA 1/ Afrique subsaharienne 2/
Source : FMI, juin 2011
1
2
3
4
5
2007 2008 2009 2010
PhiliPPe-Cyrille BertoN DIRECTEUR
DE L’AGENCE AFD D’ABIDJAN
aNNe-lise rêve CHARGÉE DE MISSION
À L’AGENCE AFD D’ABIDJAN
ageNCe aFD D’aBiDJaN
Bd. François Mitterrand 01
Abidjan 01
CÔTE D’IVOIRE
PAYS COUVERTS
CÔTE D’IVOIRE, LIBÉRIA
DIRECTEUR Philippe-Cyrille Berton
TÉL (225) 22 40 70 40
FAX (225) 22 44 21 78
“En 2010, l’indice
de développement
humain de la Côte
d’Ivoire classe le
pays au 149ème rang
sur 169.”
LE DOSSIER DÉFIS ET ENJEUX DE LA RELANCE IVOIRIENNELE DOSSIER

05
AU SUD DU SAHARA - N°1 LA LETTRE DU DÉPARTEMENT AFRIQUE SUBSAHARIENNE DE L’AFD
Malgré plusieurs années de croissance atone
voire de récession durant les années de
crise les plus sombres, la Côte d’Ivoire conserve
un poids économique important en Afrique de
l’Ouest. Deuxième économie derrière le géant
nigérian en termes de PIB, elle devance toujours
ses deux concurrents, le Ghana et le Sénégal.
Plus de 50% des exportations agricoles de la
sous-région sont ivoiriennes et le pays accueille
plus des deux tiers des industries régionales. Ain-
si, aux pires moments de la crise, les autres pays
ont dû trouver des palliatifs aux blocages liés aux
péripéties ivoiriennes.
UNE CIRCULATION DES HOMMES,
DES BIENS ET DU CAPITAL
CONTRAINTE PAR LA CRISE
Depuis 2002, date de la scission du pays, on es-
time à 360 000 le nombre de burkinabés rentrés
au pays (10% des travailleurs installés en Côte
d’Ivoire). Il est difficile de quantifier la perte de
ressources en termes de transferts financiers
(remises de migrants) occasionnée par ces mi-
grations, tant la part des flux informels est impor-
tante. En revanche, ces mouvements de popula-
tions ont déjà un effet sur la densité des régions
d’accueil et y renforcent les tensions foncières,
sociales et économiques 1.
La crise ivoirienne a également affecté les échanges
commerciaux au sein de l’Afrique de l’Ouest. Non
seulement parce que le pays est une terre de des-
tination pour les exportations des pays voisins
et une terre d’origine pour les importations (les
importations du Burkina Faso en provenance de
Côte d’Ivoire représentent presque 20% des im-
portations totales de ce pays selon les données
sur le commerce formel), mais également parce
que la Côte d’Ivoire est un chemin d’accès vers ou
depuis le reste du monde pour les pays enclavés
que sont le Burkina Faso, le Mali ou le Niger. Ceux-
ci ont ainsi été contraints de trouver des voies
de contournement, lors de la coupure physique
du lien avec Abidjan et le Golfe de Guinée. Les
ports de Téma, de Lomé et de Dakar ont alors
servi de débouché, mais au prix d’une hausse des
coûts de transaction, ce qui a renchérit le coût
des échanges intra-régionaux et avec le reste du
monde. Egoume et Nayo (2011)2 montrent ainsi
que la crise ivoirienne s’est traduite par une baisse
du potentiel commercial de l’UEMOA. Pour la
seule Côte d’Ivoire, ils estiment à 40% la perte des
échanges avec l’UEMOA occasionnée par la crise.
Au paroxysme de la crise, le Trésor ivoirien était
le premier émetteur sur le marché monétaire
régional, avec un encours de près des deux tiers
des bons du Trésor détenus par les banques de la
région, soit 600 milliards de FCFA. Les banques du
Bénin, du Sénégal et du Burkina Faso, en sus des
banques ivoiriennes, étaient alors exposées, avec
environ 15% de l’encours détenu par les banques
dans chacun de ces trois pays. Une crise persis-
tante aurait créé une accumulation d’impayés sur
les titres publics ivoiriens et une désorganisation
du marché monétaire et financier de l’Union.
Des mécanismes de refinancement, en accord
avec la banque centrale (BCEAO), ont permis de
rééchelonner les bons et les obligations du Trésor
ivoirien. De même, les banques de l’Union ont bé-
néficié d’une injection importante de liquidités de
la BCEAO pour pallier la fermeture des banques
commerciales privées en Côte d’Ivoire de février
à fin avril 2011.
MAIS QUELS LIENS AVEC LES
PERFORMANCES DE CROISSANCE ?
Les stratégies de contournement, de nouvelles al-
liances et l’existence de solutions alternatives ont
sans doute permis aux économies de la région les
plus liées avec l’économie ivoirienne et poten-
tiellement les plus fragiles d’éviter d’être aspirées
par le marasme économique ivoirien. On pourra
ainsi constater que le Burkina Faso, dont les rela-
tions économiques avec la Côte d’Ivoire sont sans
doute les plus étroites au sein de la région, est
finalement le pays de l’UEMOA qui a connu les
meilleures performances de croissance ces der-
nières années. Performances qui le rapprochent,
selon le FMI, des meilleurs performeurs d’Afrique
subsaharienne3. En 2001, le pays réalisait 6,6% de
croissance alors que l’économie ivoirienne sta-
gnait ; en 2003, il réalisait 7,8% de croissance alors
que le PIB ivoirien se contractait de 1,7%. Le Mali,
autre économie fortement liée à la Côte d’Ivoire,
suit juste derrière en termes de performances
macroéconomiques au cours de ces dix dernières
années. Est-ce à dire que la croissance entre les
pays de la région n’est pas liée, sûrement pas, une
analyse quantitative serait nécessaire. Et nous ne
mesurons pas encore l’impact régional de cette
nouvelle crise de 2011, bien plus profonde que les
crises passées (les dernières prévisions tablent sur
une récession de 5,8%).
Et puis, sans aucun doute, une reprise vigoureuse
de l’économie ivoirienne ne pourrait avoir qu’un
effet positif d’entrainement sur la région. Une re-
lance de l’activité économique par une poussée
de la demande intérieure ivoirienne conduirait les
entreprises à créer davantage de richesses dans la
région. Le niveau des recettes fiscales afficherait
ainsi une meilleure position, permettant la mise
en œuvre de véritables programmes d’investisse-
ment, dans les infrastructures notamment, dont
l’ensemble de la région pourrait tirer des bénéfices.
Il convient ainsi d’identifier les secteurs d’intégra-
tions fortes, permettant aux économies régionales
d’être complémentaires et non dépendantes. Cela
passe avant tout par une volonté politique, moné-
taire et financière affirmée. Les bailleurs sont aux
côtés des Etats et des institutions pour financer les
meilleures synergies de développement régional.
Les économies sous-régionales
et la crise ivoirienne
La Côte d’Ivoire accueille plus de sept millions de ressortissants étrangers, soit 35% de sa population totale,
en provenance des pays frontaliers. Cette proportion dit à elle seule le rôle central que joue le pays dans les dynamiques d’échanges
en Afrique de l’Ouest. La crise ivoirienne a-t-elle changé la donne ?
2/3
des Bons du Trésor détenus par les
banques de l’UEMOA sont ivoiriens.
1 F. Courtin, F. Fournet, P. Solano, : “La crise ivoirienne et les migrants
burkinabés”, Afrique contemporaine n° 236, pp. 13-26, 2011
2
P. Egoumé-Bossogo, A. Nayo : Feeling The Elephant’s Weight:
“The Impact of Côte d’Ivoire’s Crisis on WAEMU Trade”, Avril 2011 ;
IMF, Working Paper
3
Perspectives économiques régionales, FMI, octobre 2010
CROISSANCE COMPARÉE
DES PIB AU BURKINA, MALI ET RCI
DEPUIS 10 ANS
-10
-5
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
(prev)
0
5
10
15
Burkina Faso Mali RCI
emmaNuelle roumÉgous ÉCONOMISTE
AU DÉPARTEMENT AFRIQUE SUBSAHARIENNE DE L’AFD
oumar sylla CHARGÉ DE PROJETS À L’AGENCE
AFD D’ABIDJAN
LE DOSSIER DÉFIS ET ENJEUX DE LA RELANCE IVOIRIENNELE DOSSIER
 6
6
 7
7
1
/
7
100%