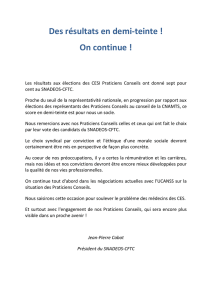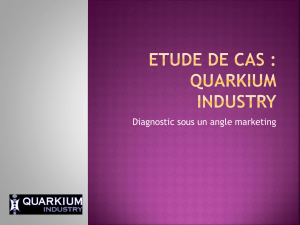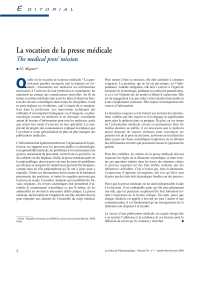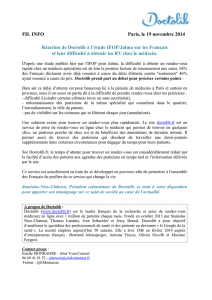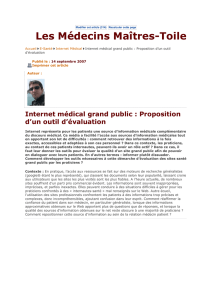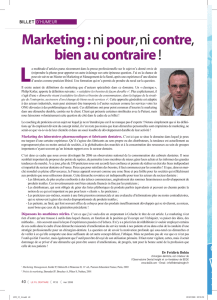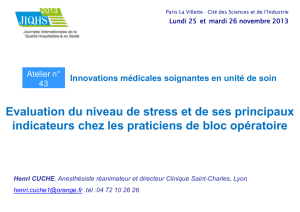Relations médecins/cliniques

Session professionnelle 307
RELATIONS MEDECINS/CLINIQUES
G. Bazin. Les Poriettes, 72530 Yvre l’Evêque.
INTRODUCTION
Il n’est pas question, dans ce document, de traiter de manière exhaustive les rela-
tions médecins-cliniques telles qu’elle se pratiquent à ce jour. Ces relations reposent
sur un formalisme juridique maintes fois traitée par tous les juristes spécialisés. Nous
avons répété sans cesse depuis de très nombreuses années que l’accompagnement par
un professionnel était un préalable fondamental avant toute installation. Le temps n’est
plus à ces rappels. Par contre, nous traversons une époque dans laquelle de profondes
mutations se produisent autant dans les établissements privés que dans notre exercice
professionnel.
A l’occasion de congrès ou réunions dans le cadre des CHU, mes nombreuses inter-
ventions auprès des jeunes praticiens qui doivent faire un choix d’installation entre les
trois secteurs publiques privés et PSPH m’ont permis de mesurer leur désarroi leurs
méconnaissances des mécanismes qui orienteront leur carrière. Cette actualisation mé-
rite d’être traitée.
1. PREAMBULE
La bonne santé financière d’une clinique suffisait pour avoir l’assurance d’un ave-
nir confortable. Aujourd’hui, les nouveaux modes de régulations de la santé, les freins
prévisibles aux dérives passées, le conservatisme comportemental des praticiens en
général, le vieillissement de la population médicale et le maintien d’une dichotomie
excessive entre les praticiens et la clinique sont autant d’éléments qui peuvent détruire
un établissements dans un délai très court.
La qualité des relations médecin clinique est directement corrélée avec l’assu-
rance d’un exercice professionnelle en harmonie avec les impératifs de gestion de
l’établissement.
Les anesthésistes installés ont considérablement vieilli. La pénurie est l’explication
la plus plausible. Elle ne paraît pas suffisante. L’augmentation des besoins, justifiés ou
non, la mauvaise répartition sont des explications tout aussi plausibles.
Par ailleurs, nous pourrions également constater que la moyenne d’âge des candi-
dats à l’installation a également considérablement augmenté. Il n’est pas rare de trouver

MAPAR 2001308
des équipes, parfois anciennes, accepter la candidature de collègues plus proches de la
cinquantaine qui ont erré d’échec en espoir, sachant que ceux-ci sont souvent peu réac-
tifs et ne s’impliqueront pas forcément dans l’évolution de la clinique. La plupart des
praticien qui s’installent sont mobilisés par trois impératifs à part égal :
1-
Gagner sa vie correctement
Les prétentions financières, souvent excessives, sont du domaine du passé. Chacun
est conscient que les niches mirobolantes sont rares et peu pérennes. Néanmoins les
taux de redevances, la présence ou non dans le capital de l’établissement peuvent
créer des différences de revenus notables qui ne seront plus tolérées à terme. La pénu-
rie probablement relative des anesthésistes a apporté la conviction que ceux-ci ne
doivent pas investir. Ce constat s’est traduit par une course aux installations sans
investissement. La plupart des prétendants aux rivages enchanteurs ont quitté des po-
sitions qui leur paraissaient intolérables pour se jeter sur les routes et commencer une
errance qui se termine toujours par des désillusions tant les situations se ressemblent.
2- Disposer d’un cadre de travail en cohérence avec les connaissances acquises
La fuite des hiérarchies pesantes et la lenteur (moins évidente) des décisions hospi-
talières sont des motivations fortes pour quitter le secteur public. Pourtant la qualité
de l’exercice reste une référence que les praticiens veulent retrouver dans le secteur
libéral. La qualité et le cadre de vie extra professionnel ne semblent plus dominants.
3- Avoir la garantie que la clinique soit pérenne
Les différences de revenus entre deux catégories de praticiens pourraient se justifier
par le niveau et la nature d’un risque dont le plus important est l’absence de péren-
nité. Depuis vingt ans, ce risque n’a fait que croître. Pour beaucoup, intuitivement,
la diminution de ce risque se compense par un engagement financier légitime dans la
structure.
Le prix à payer pour disposer de cette pérennité est la préoccupation la plus forte.
La qualité de la relation des praticiens avec leur clinique est à la fois ce qui a déclen-
ché les pires débâcles et ce qui constitue, en même temps, le préalable essentiel au
maintien d’une forme d’exercice indispensable pour répondre à des besoins sanitai-
res de proximité.
La forme que peut prendre cette relation est encore à définir. Nous savons que celle
qui prévaut aujourd’hui n’est plus adaptée autant sur le plan juridique que financier.
2. APPROCHE JURIDIQUE
La relation médecin clinique dépend de trois composantes qui sont liées et qui tou-
chent les contrats, l’organisation juridique des soins et le statut des biens
2.1. CONTR ATS
La forme des contrats traditionnels n’est plus adaptée à l’évolution juridique qui ne
différencie plus clairement les responsabilités incombant strictement aux praticiens et
à la clinique. L’activité libérale est confrontée à l’apparition d’incohérences et de con-
tradictions qui ne sont pas seulement juridiques et qui s’étendent au versant social et
fiscal du dispositif.
Un praticien peut être tenu pour responsable de faute de la clinique. Une clinique
peut être tenu responsable de fautes médicales en relation directe avec une mauvaise
organisation médicale.
La loi portant réforme hospitalière de 1991 s’inscrit pleinement dans cette évolu-
tion en donnant une base réglementaire aux obligations des cliniques dans le domaine

Session professionnelle 309
de l’organisation médicale. Les obligations énumérées, bien qu’elles relèvent pour leur
exécution de la responsabilité essentielle des praticiens, sont mises à la charge de l’éta-
blissement.
Cette obligation qui est faite aux cliniques, en matière d’organisation médicale,
suppose indiscutablement un certain pouvoir d’autorité sur l’activité des médecins
libéraux exerçant en leur sein. Ces textes qui confirment une évolution inéluctable,
redimensionne la sacro-sainte indépendance du praticien et place le principe de sécuri-
té appréhendé globalement par l’établissement au centre du dispositif. La médecine
évolue vers plus de scientificité et donc d’organisation. Le rapport au risque des socié-
tés modernes, alors même que les progrès de la médecine la rendent plus
interventionnelle, est donc plus contraignant.
La qualification et la compétence, la capacité à s’intégrer dans une organisation
seront exigées aux praticiens par les cliniques, éloignant ainsi ceux dont les comporte-
ments seraient trop exclusifs et s’éloigneraient des principes de cohérence et de
coordination qui doivent prévaloir dans un cadre collectif.
Ces évolutions ne peuvent que se confirmer à l’avenir et modifier en profondeur la
nature des relations.
2.2. ORG ANISA TION JURIDIQUE DE L A PRODUCTION DE SOINS
La prestation de soins n’est pas un service banalisé, le patient n’est pas un objet, la
médecine n’est pas un commerce. Les composantes spécifiques de l’exercice médical
renforcent l’importance de la prise en compte de la logique de métier dans le cadre
d’une logique d’organisation qui prévaut en matière de gestion dans les structures.
Au-delà du code de déontologie, il semble que la maîtrise par le médecin de son
outil de production contribue à son indispensable indépendance en élevant la pérennité
comme facteur essentiel. Il paraît raisonnable de penser que les cliniques devront se
doter d’une personnalité morale pour répondre à ces nouvelle exigences remise en cau-
se par les divergences et les sommes d’individualités.
Les cliniques sont actuellement gérées soit dans le cadre associatif, soit dans le
cadre de sociétés commerciales classiques. Aucune de ces formes juridiques ne permet
la constitution d’entités économiques totalement cohérentes en matière de prestation
de santé hospitalière.
Elles ne permettent pas de surmonter l’antagonisme juridique praticien-clinique,
source de problèmes constants et de risques croissants.
Elles n’incitent ni ne permettent l’implication des praticiens, à la compréhension du
fonctionnement de la clinique et des règles de régulation.
Sous la pression croissante de la réglementation sanitaire et de la jurisprudence en
matière de responsabilité, elles garantissent de moins en moins l’indépendance des
praticiens comme professionnels libéraux.
Les praticiens et les cliniques se trouvent aujourd’hui face à deux logiques, pour ne
pas dire face à un conflit de droits : code de la santé et de la sécurité sociale d’une part ;
code du commerce d’autre part. Responsabilité médicale d’une part ; responsabilité de
mandataire social d’une société commerciale d’autre part.
3. STATUT DES BIENS
L’actif social d’un établissement de santé privé à but lucratif, outre les biens corpo-
rels aisément identifiables (immeuble, matériel commun, mobilier) comprend des
éléments rarement identifiés autrement que regroupés sous la rubrique «Fonds de com-
merce», et qui consiste dans la valorisation des droits d’hospitaliser ou d’exercer des
activités substitutives à l’hospitalisation, qui résultent des autorisations.

MAPAR 2001310
Celles-ci ne sont pas considérées aujourd’hui comme fiscalement amortissables, alors
qu’elles sont à durée limitée, et que leur droit à renouvellement n’est jamais acquis.
Ces autorisations, historiquement ou ponctuellement, voient leur régime d’attribu-
tion, de transfert, de renouvellement, de suppression, totalement encadré par la carte
sanitaire et le Schéma Régional d’Organisation Sanitaire, lequel résulte d’un acte ad-
ministratif unilatéral à caractère obligatoire de la planification hospitalière.
Pour le dirigeant social, il en résulte une incohérence comptable. Face à un droit de
nature administrative donc incessible, chacun, y compris l’Etat qui perçoit les Droits
d’enregistrement, pratique la cession des lits, souvent répercuté dans les transactions
avec les médecins sans que l’entreprise de santé puisse fiscalement amortir une valeur
incorporelle.
3. FINANCIERS
Le financement du système de santé est partout l’objet d’une attention particulière
du fait de l’affirmation du droit à la santé d’une part, de sa nécessaire régulation d’autre
part. Les impératifs de saine gestion sont largement étrangers aux questions relatives
au rapport qualité/coût de leurs prestations.
Les rapports financiers entre la clinique et le praticien ont toujours été vécus com-
me complexes et peu clairs. Les URSSAF, l’administration fiscale ont toujours été
suspicieuses. Les Tutelles ont souvent considéré que les difficultés financières d’une
clinique devaient être au moins en partie prises en charge par les praticiens qui y exer-
cent. Les praticiens eux-mêmes acceptent parfois une conception de la redevance peu
acceptable du point de vue du droit, ou, parfois, face aux difficultés de leur clinique, ils
souhaitent comme les Tutelles déjà évoquées, contribuer au soulagement de la charge
financière de la clinique, au risque d’une requalification de leur contribution.
Plus de clarté et plus de logique médicale sont nécessaires en matière de finance-
ment des cliniques.
Par ailleurs chacun s’accorde sur la nécessaire approche «globale» du patient, y
compris du point de vue des circuits financiers.
Dans tous les pays on cherche à mettre les financements en cohérence avec cet
impératif. Ni l’approche, par budget global, ni celle du paiement à l’acte et d’une rému-
nération proportionnelle de la structure n’apportent la réponse souhaitée.
Partout les recherches se tournent au plan microéconomique vers des budgets à
orientation clinique rattachés à des groupes de patients cohérents du point de vue médi-
cal, et régulés au sein d’enveloppes globales par des systèmes de concurrence organisée.
Dans tous les cas les spécificités de l’activité médicale rendent incontournable l’impli-
cation des professionnels. Cette implication devra se traduire dans un mode de relation
fondamentalement différente de ceux qui sont constatés aujourd’hui.
Comme de nombreuses PME, les cliniques souffrent d’une sous-capitalisation chro-
nique.
Indépendamment du taux de profit des cliniques (régulier mais particulièrement
faible et quasiment nul voir structurellement négatif sur les années présentes), la ques-
tion du capital des cliniques a longtemps été résolue par la faible intensité capitalistique
de l’activité hospitalière et par le recours à des financements externes. Or l’intensité
capitalistique requise va croissant compte tenu du développement des plateaux techni-
ques et du développement des contraintes administratives et de gestion du risque.
Le relais espéré du côté des groupes d’investisseurs autres ne se réalisa que diffici-
lement compte tenu du faible taux de profit, ou il se fait dans la dépendance de logiques

Session professionnelle 311
externes au secteur, accroissant par là sa vulnérabilité et rendant plus complexe l’impli-
cation du corps médical.
Pourtant la participation en capital des médecins qui veulent s’impliquer dans la
marche de leur outil de travail n’est pas facilitée.
La contradiction entre le principe d’une médecine qui n’est pas un commerce mais
qui s’exerce dans des structures à but «lucratif» ne pose plus de problème aux citoyens
grâce au système de remboursement collectif mis en place avec la Sécurité Sociale,
mais demeure.
Cette contradiction, quoi qu’on en dise, continue à alimenter troubles, suspicions et
confusions, au moins dans les rapports entre professionnels et entre Tutelles et clini-
ques.
Le secteur et l’activité hospitalière privée en cliniques sous OQN, est, de l’avis
commun et de façon objective depuis l’instauration du système de mesure à partir du
PMSI, reconnu comme étant substantiellement plus productif que les autres, en France
comme dans les comparaisons internationales. Sa survie est donc indispensable en pé-
riode de régulation forte des financements publics.
Il convient donc, à qualité égale, de préserver cette productivité qui est une des
conditions du maintien de l’accessibilité et de la solidarité de nos systèmes de santé. En
France c’est surtout un avantage en termes de coût pour la collectivité, à l’étranger la
création d’un secteur privé, soumis aux contraintes et à des régulations de type service
public comme c’est le cas en France, est de plus en plus souhaité pour une raison sup-
plémentaire, de productivité : résorber les files d’attente.
CONCLUSION
On le voit, il existe actuellement un divorce complet au sein des cliniques privées
entre deux logiques:
1- Celle d’une entreprise de type capitaliste de droit commercial dont le moteur princi-
pal ne peut être que la rémunération du capital par le versement de dividendes ou la
réalisation de plus-value.
2- Celle d’une entreprise de production de soins soumise à de multiples contraintes,
certes légitimes pour la plupart, mais souvent totalement antagonistes du système de
droit commercial.
Les actionnaires de ces structures, lorsqu’il s’agit de médecins, ont investi dans leur
outil de travail et non dans un but premier de rentabilité financière de leur investis-
sement.
Pourtant, ces structures démontrent tous les jours qu’elles offrent, malgré tout, la
meilleure productivité du système de santé.
Il faut donc «inventer» un nouveau socle juridique pour les établissements de santé
privés, en gardant les moteurs de leur productivité et en supprimant des antagonismes
juridiques financiers et économiques de plus en plus mortifères pour ces établissements.
Il faut également que les médecins comprennent que la dichotomie entre eux et la
clinique n’est plus de mise. Les relations d’interdépendance vont devenir la règle et les
contrats qui ont articulé par le passé médecins et établissement, selon le vieux principe
de partie et contrepartie, seront à terme de doux souvenirs. Une relation nouvelle sera
mise en œuvre. Elle n’est pas clairement définie. Le risque de passer à un régime dur de
sous-traitance n’est pas exclu. Tout opposition et guerre de tranchée contribueront, en
même temps que les mesures inconscientes et peu favorables au maintien du secteur
privé, à faire disparaître les établissements et augmenter le désarroi de tous les prati-
ciens qui cherchent leur voie.
1
/
5
100%