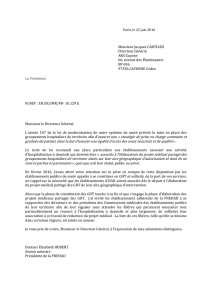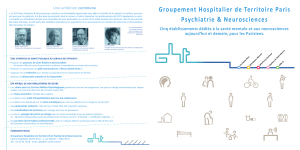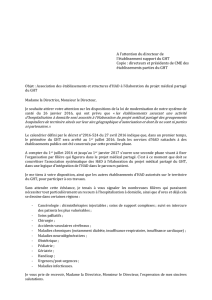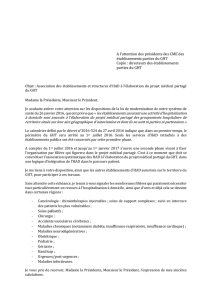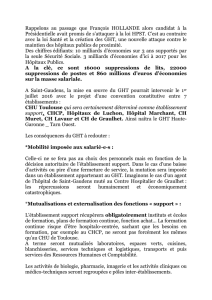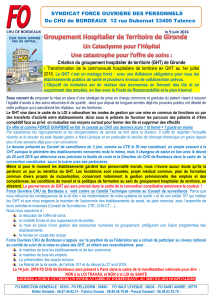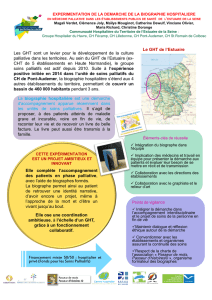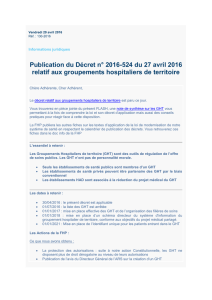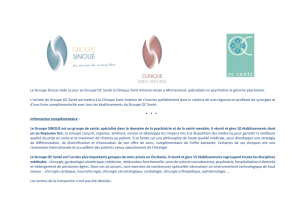Itinéraire d`un GHT singulier - Centre Hospitalier Sainte Anne

Groupement hospitalier de territoire
Paris-Psychiatrie & Neurosciences
Itinéraire d’un GHT singulier
Lazare reyes Adjoint au directeur du groupement hospitalier de territoire
Paris-Psychiatrie & Neurosciences, directeur du site Maison-Blanche
Florence Patenotte Directrice de la communication
Sophie sabIn Responsable de la communication
Anastasia strIzyK Responsable des affaires générales,
CH Sainte-Anne, EPS Perray-Vaucluse
La communauté hospitalière de territoire pour
la psychiatrie parisienne est devenue, le 1er juillet
2016, le GHT Paris-Psychiatrie & Neurosciences.
Quels choix, arbitrages et motivations ont présidé
à sa constitution ? Comment se potentialisent-ils ?
Cet article esquisse des réponses et formule
plusieurs questions relatives à la transition opérée
vers un GHT. Il y est affaire d’héritage, celui de
la sectorisation, d’échelle, celle de la métropole,
et de parcours, celui du patient.
GHT PARIS – PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
D
ans le domaine de la psychiatrie, la
sectorisation instaurée par la circu-
laire du 15 mars 1960 prévoyait une
organisation territoriale proche de
celle prescrite par les lois de santé
de 2009 et 2016. À Paris, l’articulation entre hos-
pitaliers et partenaires, au premier titre, la Ville,
a déjà fait l’objet d’une acculturation positive via,
notamment, les conseils locaux de santé mentale.
Il en va de même pour la collaboration avec le
CHU de référence, en l’occurrence l’Assistance
publique-Hôpitaux de Paris, dont les établisse-
ments de la CHT assurent les activités d’urgences
psychiatriques avec une présence au sein de dix
services d’accueil et d’urgence parisiens. Ils réa-
lisent par ailleurs 100 % de l’activité de proximité
dans les centres médico-psychologiques et près
de 70 % de la psychiatrie infanto-juvénile.
Une histoire
et un environnement
propices à la coopération
Sectorisation :
une territorialisation avant la lettre
Assez naturellement, les établissements
1
en santé
mentale à Paris ont uni leurs forces pour réfléchir
à une offre de soins harmonisée. Sous l’impulsion
de leurs médecins psychiatres, une communauté
d’établissements a vu le jour en 2002. Mais c’est la
création de la CHT pour la psychiatrie parisienne,
dix ans plus tard, qui a transformé l’intention en un
projet médical commun apte à repenser, notamment,
l’organisation des soins de proximité à l’échelle de
la capitale.
AU SERVICE DES PARISIENS
Cinq établissements dédiés à la santé mentale et aux neurosciences
Centre hospitalier Sainte-Anne :
hôpital emblématique de la psychiatrie et des neurosciences
• Psychiatrie : 800 lits et places, 24 structures extrahospitalières,
2 400 agents dont 250 médecins, deux services hospitalo-universitaires.
• Neurosciences : le pôle Neuro Sainte-Anne de l’université Paris Descartes
comprend quatre services hospitalo-universitaires et sept filières
spécialisées (neurochirurgie, neurologie, neuroréanimation/neuroanesthésie,
neuroradiologie diagnostique et interventionnelle, médecine physique et de
réadaptation neurologique, neuropathologie, neurophysiologie, stomatologie).
Établissement public de santé Maison-Blanche : laboratoire de la proximité
• Plus de 1 100 lits et places en psychiatrie adulte, infanto-juvénile et addictions
• 70 structures ambulatoires et 8 sites d’hospitalisation
• 2 600 agents dont 200 médecins
Groupe public de santé Perray-Vaucluse :
expert dans le continuum sanitaire/médico-social
• 40 lits et 156 places d’hébergement médico-social
• Un site unique regroupant les unités sanitaires pour adultes au long cours
et les structures médico-sociales (EHPAD et MAS)
• 500 agents dont 10 médecins
Les établissements associés ou partenaires
• Hôpitaux de Saint-Maurice, inscrits dans la cité parisienne
• Association Santé mentale 13e arrondissement, berceau de la sectorisation
1. Le centre hospitalier Sainte-Anne (CHSA), l’établissement public
de santé mentale Maison-Blanche (EPSMB), le groupe public de santé
Perray-Vaucluse (GPSPV), hôpitaux de Saint-Maurice et l’association
Santé mentale 13e arrondissement.
REVUE HOSPITALIÈRE DE FRANCE # 571 Juillet -Août 2016 39
WWW.REVUEHOSPITALIERE.FR

De fait, l’offre de soins de la CHT s’est construite
en cercles concentriques : depuis les soins de
proximité (assurés par les secteurs autour des
CMP) en passant par un niveau intermédiaire de
coordination (pour les recours concernant certaines
populations et dispositifs de soins) jusqu’à l’or-
ganisation du parcours patient (du diagnostic aux
soins spécialisés) à l’échelle de la Ville de Paris.
Sans oublier, bien entendu, la fonction de recours
et d’expertise dédiée aux Franciliens. L’articulation
entre la psychiatrie parisienne et l’offre de soins
du pôle Neuro Sainte-Anne (au CHSA) prendra son
essor dans un second temps.
Dotées de la plus importante file active d’Europe
avec 76 400 patients pris en charge 2, dont 63 500
suivis exclusivement en ambulatoire (soit 87 %
de l’ensemble de la file active
3
), les structures
de la CHT prennent en charge l’équivalent d’un
Parisien sur 40 4.
Une métropole-territoire
La région parisienne a pour réputation de bénéficier
d’un environnement sanitaire favorable. Mais elle
présente de réels problèmes d’inégalités de santé
et de prévalences pathogènes.
Paris occupe une place particulière dans le paysage
sanitaire français, à commencer par des effets de
masse, qui appellent une réponse sanitaire structu-
rée : Paris est la ville d’Europe la plus « habitée » (21
347 habitants au km²) avec pour cinq de ses arrondis-
sements5 une densité supérieure à 30 000habitants…
et à celle du borough de Manhattan. Le 15e abrite à
lui seul l’équivalent des habitants de Bordeaux. Les
cinq établissements regroupés au sein de la CHT
ENCADRÉ 1 couvrent la totalité de la capitale, soit les
vingt arrondissements parisiens et une population
de 2 250 000 habitants6.
La proportion de personnes en situation précaire,
atteintes du VIH, ou souffrant d’addictions, y excède
la moyenne nationale. Dans le quart nord-est de la
capitale, qui accueille le tiers de la population pari-
sienne, deux patients sur trois n’ont pas de médecin
traitant et 40 % de la file active est sans logement.
Une carte territoriale redéfinie
En matière d’accès aux soins et d’implantation, il y
a un avant et un après-sectorisation à Paris, soit,
en schématisant, la période durant laquelle ont été
créés les asiles de la Seine, hors de la ville, puis la
relocalisation près des lieux de vie des Parisiens
dans la mouvance de la désinstitutionnalisation. En
résulte une atomisation patrimoniale difficilement
lisible en termes de parcours de soins, loin de faire
la preuve de son efficience.
La CHT a mis à profit l’organisation sectorielle
pour la rendre plus lisible en réalisant, le 1er juin
dernier, le transfert des secteurs
7
parisiens du GPS
Perray-Vaucluse vers le CHSA et l’EPSMB. Une
opération d’ampleur avec la migration de près de
600 000 données d’identités patients, l’intégration
de 700 personnels au sein des deux établissements
d’accueil et la redistribution d’un budget de 56 M€.
La CHT devenue GHT s’équilibre désormais en deux
grands ensembles au nord et au sud de la Seine
ENCADRÉ 2. Une offre de soins médico-sociaux et au
long cours pour tous les Parisiens, située sur le site
essonnien du Perray, les complète.
Des priorités établies
avec l’agence régionale de santé
En juillet 2013, l’agence régionale de santé d’Île-
de-France a précisé les axes prioritaires8 qu’elle
souhaitait voir développer, à court terme, au sein
du projet médical de la CHT. Pour chacun, la dyna-
mique à l’œuvre au sein des groupes
de travail (pas moins de douze pour
l’ensemble du projet médical com-
mun) a permis l’essor de projets
structurants. Citons la charte des
CMP parisiens qui pose le principe
d’une accessibilité et d’une lisibilité
accrue, grâce à une ouverture sans rendez-vous
jusqu’à 20 h 00 au moins deux fois par semaine.
Autre exemple : le projet d’unité d’hospitalisation
pour adolescents de 10 à 15 ans. Citons encore les
travaux du groupe Recherche et épidémiologie,
qui met à disposition des professionnels de santé
un ensemble de données pertinentes pour l’étude
de la population (recensement des déterminants
sociodémographiques à Paris).
Une gouvernance commune
Un projet médical avant tout
L’impulsion de la communauté médicale fut déter-
minante dans la mise en œuvre de cette coopération
territorialisée. La mise en musique de la réforme
– avec une certaine latitude dans la définition des
règles du jeu au sein des instances – l’a sans doute
été tout autant.
La clé de voûte du dispositif repose
sur une très forte délégation du management:
les directeurs de site bénéficient
d’une délégation complète.
40 # 571 Juillet -Août 2016 REVUE HOSPITALIÈRE DE FRANCE
WWW.REVUEHOSPITALIERE.FR
DOSSIER TERRITORIALITÉS

GHT PARIS-PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Le dispositif CHT avait comme seule instance
la commission de communauté. La CHT pour la
psychiatrie parisienne s’est construite sur un
projet médical commun : des instances médicales
et de personnels sont devenues indispensables.
Trois instances ont été créées : une commission
médicale commune (CME-C) ; une commission
des soins infirmiers, de rééducation et médico-
techniques commune (CSIRMT-C) ; un comité
technique commun (CTC). De plus, un bureau
exécutif, non prévu par les textes, a été instauré.
À l’instar de la CME-C, la CSIRMT-C a initié une
réflexion sur les pratiques soignantes et jeté les
bases d’un projet de soins partagé. Ces organes
de concertation ont facilité l‘acculturation entre
les équipes, avec pour objectif d’aboutir à un projet
parisien. Néanmoins, ce dispositif se surajoute aux
instances locales et s’avère chronophage.
Le CTC n’a pu prendre l’importance souhaitée pour
diverses raisons. En effet, les projets de mutualisa-
tions concernaient davantage la direction commune,
et donc les trois établissements fondateurs et non
les associés. Par ailleurs, l’effet « doublon », avec les
CTE locaux, voire avec les CHSCT, a rendu complexe
la gestion des dossiers.
2. Somme de la file active des établissements.
3. À titre de comparaison, au niveau national, en 2012, la proportion de patients suivis
en ambulatoire est de 68%. Source: M. Coldefy, « L’évolution des dispositifs de soins
psychiatriques en Allemagne, Angleterre, France et Italie: similitudes et divergences »,
Irdes, Question d’économie de la santé, n°180, octobre 2012.
4. Taux de pénétration des établissements de 2,8%.
5. Les 3e, 11e, 10e, 18e et 20e arrondissements de Paris.
6. Rapport commun des départements d’information médicale de la CHT pour la
psychiatrie parisienne, 2014.
7. Correspondant aux 7e, 8e et 17e arrondissements.
8. La proximité, les urgences, la pédopsychiatrie, la précarité et l’épidémiologie.
DE LA CHT AU GHT:
REDÉFINITION DE LA CARTE DES SECTEURS DE PSYCHIATRIE PARISIENS ENCADRÉ 2
CHT PSYCHIATRIE PARISIENNE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014-2015 | PAGES 4-5
5 établissements dédiés à
la prise en charge en santé mentale
et en neurosciences des Parisiens
Site d’hospitalisation (8)
Urgences (dont 14 pour la CHT)
Centre médico-psychologique (30)
Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (22)
Hôpital de jour (15)
Foyer de post-cure (7)
Structure d’addictions (4)
Structure pour la précarité (4)
Psychiatrie
Secteurs
Adulte
Psychiatrie
Secteurs
Enfant
Neuro-Sainte-Anne
Site d’hospitalisation (2)
Urgences
Centre médico-psychologique (19)
Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (9)
Hôpital de jour (5)
Unité petite enfance (9)
Espace ado (3)
Urgences, hospitalisations, consultations,
plateau technique de pointe, télé expertise
Neuilly-sur-Marne
Saint-Maurice
Épinay-sur-Orge
Soisy-sur-Seine
La cartographie présente les structures de prise en charge en psychiatrie adulte
et infanto-juvénile, mais le découpage des secteurs correspond à celui de la
psychiatrie adulte. Certains secteurs de psychiatrie infanto-juvénile sont pris en
charge par d’autres acteurs sanitaires : AP-HP, Institut Mutualiste Montsouris.
CHT PSYCHIAT RIE PARISIENNE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014-2015 | PAGES 4-5
5 établissements dédiés à
la prise en charge en santé mentale
et en neurosciences des Parisiens
Site d’hospitalisation (8)
Urgences (dont 14 pour la CHT)
Centre médico-psychologique (30)
Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (22)
Hôpital de jour (15)
Foyer de post-cure (7)
Structure d’addictions (4)
Structure pour la précarité (4)
Psychiatrie
Secteurs
Adulte
Psychiatrie
Secteurs
Enfant
Neuro-Sainte-Anne
Site d’hospitalisation (2)
Urgences
Centre médico-psychologique (19)
Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (9)
Hôpital de jour (5)
Unité petite enfance (9)
Espace ado (3)
Urgences, hospitalisations, consultations,
plateau technique de pointe, télé expertise
Neuilly-sur-Marne
Saint-Maurice
Épinay-sur-Orge
Soisy-sur-Seine
La cartographie présente les structures de prise en charge en psychiatrie adulte
et infanto-juvénile, mais le découpage des secteurs correspond à celui de la
psychiatrie adulte. Certains secteurs de psychiatrie infanto-juvénile sont pris en
charge par d’autres acteurs sanitaires : AP-HP, Institut Mutualiste Montsouris.
LA CHT
AU 1er JUILLET 2016, LE GHT
REVUE HOSPITALIÈRE DE FRANCE # 571 Juillet -Août 2016 41
WWW.REVUEHOSPITALIERE.FR

Dans l’ensemble des instances, le choix d’un
système de représentativité proportionnel avait
été retenu (eu égard aux densités populationnelles
des territoires des établissements et à leurs
offres de soins spécifiques). Pour une concertation
unilatérale entre acteurs, les établissements
associés ont été inclus en tant que membres
invités au sein de l’ensemble de ces instances.
Espérons que la législation applicable aux GHT
apportera un correctif au paradoxe actuel : les
établissements associés au temps des CHT ne
peuvent être impliqués de manière aussi étroite
au sein du GHT, au motif qu’ils ne sauraient
appartenir simultanément à deux groupements.
Une direction commune
La création d’une direction commune entre les
trois établissements fondateurs, en 2014, a été
fortement encouragée par l’agence régionale
de santé d’Île-de-France. La clé de voûte du
dispositif repose sur une très forte délégation du
management : les directeurs de site bénéficient
d’une délégation complète. Par ailleurs, chaque
directeur de site, respectivement celui de Maison-
Blanche et de Perray-Vaucluse, assure une mis-
sion d’appui auprès du directeur du groupement
(le directeur du site Sainte-Anne). Ce triumvirat
respecte le positionnement de chaque compo
-
sante du groupe, dans une répartition des rôles
pacifiée. On peut néanmoins s’interroger sur le
caractère très centralisateur, dans la nouvelle
législation, de l’établissement siège. Que les
pôles interétablissements lui soient exclusive-
ment rattachés risque de s’avérer contre-produc-
tif à l’égard de projets appuyés sur les ressources
d’autres établissements parties.
Le fonctionnement de la direction commune
illustre un management le plus transversal pos-
sible. Symboliquement, c’est la nouvellement
nommée « direction des parcours et de l’inno-
vation9 » qui a initié cette dynamique. Faire de la
direction support du projet médical la première
à œuvrer en commun était une évidence, alors
même qu’elle n’était pas inscrite dans la loi. La
direction des parcours et de l’innovation travaille
en lien étroit avec la direction des soins, pilotée
par un coordinateur des activités paramédicales
de la CHT. Il a été décidé plus largement de doter
chaque direction fonctionnelle d’un périmètre
transversal. Chaque exécutif support (douze au
total) a été chargé de concevoir une organisation
à l’échelle des trois établissements. A aussi été
créé un département santé publique, systèmes
d’information et prospective.
En l’espace de dix-huit mois, en trois salves,
l’ensemble des directions s’est doté d’un orga-
nigramme et a mutualisé son fonctionnement.
Pour faire travailler des équipes
ensemble, tout en poursuivant une
capacité d’intervention in situ, la
question de la localisation se pose
inévitablement. La loi Touraine,
qui fait de l’établissement siège
l’épicentre du groupement, pourrait
inciter à la centralisation. De nombreuses direc-
tions ont d’ailleurs fait le choix du regroupement
géographique (comme la direction des systèmes
d’information). D’autres ont opté pour le maintien
de points d’ancrage sur sites (la communication
par exemple). La question essentielle relève de
la capacité des équipes à œuvrer pour le groupe :
c’est la création d’un groupement de coopération
sanitaire, en mars 2016, qui a rendu viable la
dynamique en construction. Plus de 800 per-
sonnels y sont mis à disposition, avec moyens et
locaux associés, au sein de multiples activités10.
Ces aménagements ne sont pas sans conséquence
sur la vie des agents. La découverte de nouveaux
environnements et l’adaptation des rythmes per-
sonnels avec des lieux de travail plus distanciés
appellent un accompagnement.
Toutes les unités fonctionnelles sont-elles
solubles dans une direction commune?
La question mérite d’être posée,
ainsi du champ des ressources humaines.
42 # 571 Juillet -Août 2016 REVUE HOSPITALIÈRE DE FRANCE
WWW.REVUEHOSPITALIERE.FR
DOSSIER TERRITORIALITÉS

GHT PARIS-PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
D’un point de vue systémique, les mutualisations
prescrites par les GHT n’apportent pas encore
de réponses opérantes en matière d’outils de
coopération. Le GCS ajoute une strate adminis-
trative et financière peu lisible dans un contexte
complexe, néanmoins incontournable pour le
« faire ensemble ». Toutes les unités fonction-
nelles sont-elles par ailleurs solubles dans
une direction commune ? La question mérite
d’être posée, dans le champ des ressources
humaines par exemple. Les GHT peuvent être
perçus comme des « armes de restructuration
massive 11 ». Si tel était le cas, il conviendrait
de les doter de dispositifs réellement efficaces
pour ne pas démotiver les acteurs.
Les instances du GHT
La loi Touraine rend obligatoires six instances.
Elles sont peu ou prou le reflet des instances
locales. On peut regretter que le
comité territorial des élus locaux
n’ait pas de compétences équiva-
lentes aux conseils de surveil-
lance. La conférence territoriale
du dialogue social détient des com-
pétences fixées par le décret. Ce sont les projets
de mutualisation, qui concernent notamment
la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences, les conditions de travail et la
politique de formation au sein du GHT. Il aurait
été souhaitable d’aller plus avant avec l’accord
des communautés de personnels. Enfin, saluons
la création d’une commission des usagers.
Un maillage partenarial
étroit avec les autres acteurs
du territoire
Une gouvernance adaptée implique, au-delà du
management et des instances, une politique
volontariste de coopérations avec l’ensemble
des acteurs du territoire. En 2015, la CHT a signé
une convention avec le centre d’action sociale
de la Ville de Paris. Elle vise à faciliter l’accès
de nos patients aux EHPAD parisiens et à amé-
liorer l’évaluation psychiatrique des résidents.
Rappelons que la Ville de Paris, partenaire natu-
rel du GHT, s’est dotée d’une « mission santé
mentale ». Celle-ci est notamment chargée de
coordonner les CLSM qui mobilisent bon nombre
de professionnels au sein des secteurs, aux côtés
des usagers. Si le partenariat avec les associa-
tions d’usagers peut encore se renforcer, leur
rôle a été majeur dans la construction du projet
médical commun.
Comment passer de la mise
en commun au faire ensemble ?
La loi enjoint à coopérer, à construire ensemble,
à appliquer une stratégie de groupe garante de la
pérennité d’une offre de santé publique qui compte
parmi les meilleures, et ce dans un paysage hos-
pitalier où la concurrence médico-économique
domine. Cette tension se ressent au sein des
institutions et chez les personnels, fortement mis
à contribution par les restructurations. Celles-ci
engagent un travail considérable dont les effets
vertueux ne sont pas toujours perçus immédia-
tement. La construction d’un GHT pose question
en termes d’identité, de valeurs, d’histoire. Le
bouleversement patrimonial lié aux relocalisations
de structures dans Paris intra-muros, le cham-
boulement des modes de travail résultant des
mutualisations d’activités, la complexification des
instances avec un supra-système où le dialogue
social peine encore à trouver une place adaptée :
autant de changements susceptibles de générer
inquiétude, réticence, voire incompréhension.
Des résultats objectivant
le bénéfice au patient
Ces évolutions sont pourtant porteuses de pro-
messes qu’il s’agit d’objectiver. La direction
commune a donc affiché la transformation des
gains issus des mutualisations en financements
de projets médicaux et soignants structurants
pour le tout-Paris.
Le GHT Paris-Psychiatrie & Neurosciences sera en
effet l’écrin d’une seconde phase du projet médical,
dédiée à la réalisation d’opérations d’envergure.
Parmi les plus emblématiques figure la création
d’un hôpital de jour en soins somatiques dédié
aux patients psychiatriques les plus fragiles du
territoire, qui peinent à accéder au dispositif de
droit commun. Il impliquera, au-delà des établis-
sements parties et associés, les centres de santé
associatifs, les médecins libéraux et l’AP-HP. Ce
9. Elle rassemble la stratégie, les affaires médicales, les partenariats, l’action sociale et
médico-sociale, la recherche et les relations internationales.
10. Ingénierie, travaux et maintenance, achats et logistique, systèmes d’information,
communication, qualité et gestion des risques, formation, service des majeurs protégés,
activités médico-techniques.
11. Cf. colloque «Réinventer la fonction publique hospitalière», Adhress, 10 mai 2016, Paris.
Un hôpital de jour en soins somatiques
dédié aux patients psychiatriques
les plus fragiles du territoire sera créé.
REVUE HOSPITALIÈRE DE FRANCE # 571 Juillet -Août 2016 43
WWW.REVUEHOSPITALIERE.FR
 6
6
1
/
6
100%