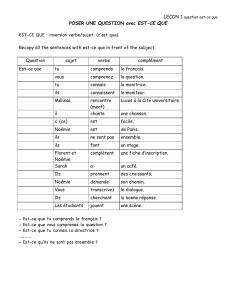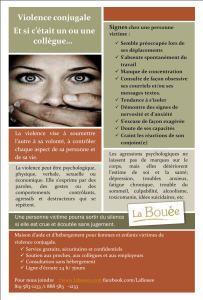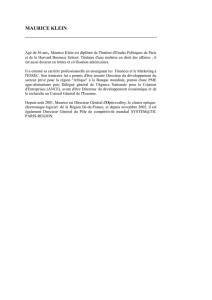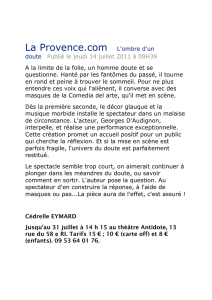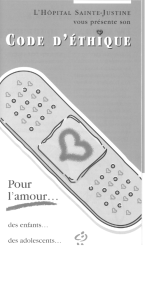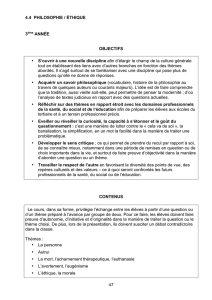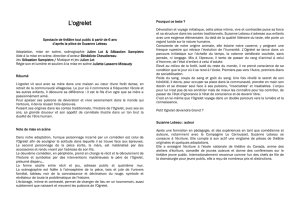Apprivoiser les monstres par le théâtre : analyse du traitement des

Apprivoiser les monstres par le théâtre :
analyse du traitement des sujets difficiles
dans le théâtre jeune public contemporain au Québec
Jennifer Turgeon Charest
Thèse soumise à la
Faculté des études supérieures et postdoctorales
dans le cadre des exigences
du programme de maîtrise en lettres françaises
Département de français
Faculté des Arts
Université d’Ottawa
© Jennifer Turgeon Charest, Ottawa, Canada, 2013

ii
« [C]e n’est pas le texte qui est violent, c’est l’existence elle-même... »
- Evelyne de la Chenelière, Bashir Lazhar

iii
RÉSUMÉ
Cette thèse propose une analyse des représentations de sujets considérés difficiles,
tels que la violence et la mort, dans la dramaturgie jeune public des années 1990 au Québec.
De nombreux dramaturges de l’époque souhaitent parler de tout à l’enfant et établir une
relation égalitaire avec lui, tout en s’éloignant du « théâtre à message » des années 1980.
Nous cherchons plus particulièrement à mettre en lumière la poétique de l’évocation que
partagent les auteurs du corpus (Michel Marc Bouchard, Suzanne Lebeau et Jasmine Dubé),
de même que la façon dont ils s’appuient sur un imaginaire tant mythologique que propre à
l’enfance afin d’inclure le jeune spectateur, sans négliger leurs ambitions artistiques et
dramaturgiques.

iv
REMERCIEMENTS
Tout comme Noémie dans sa petite barque, j’ai dû moi aussi faire face à plusieurs moments
d’angoisse avant d’en arriver à la conclusion de cette thèse. Heureusement, j’étais entourée
d’un équipage à l’épreuve de tout.
Je tiens à remercier grandement…
Mon directeur de thèse, Monsieur Michel Fournier, pour sa patience, sa confiance, sa
rigueur, sa grande générosité et ses encouragements qui ne s’épuisent jamais. Il a été un
véritable phare dans cette aventure.
Mes collègues et amis du 302 qui ont su m’écouter, me conseiller. Un merci tout particulier à
Jonathan Desrosiers et Alexandre Gauthier pour les précieux moments partagés et les rires
échangés.
Mes amis du Département de théâtre et du Théâtre de Dehors. Grâce à votre appui, j’ai
vaincu les lutins de la peur…
Ma famille et ma belle-famille qui m’ont soutenue, encouragée et qui ont chaque fois
compris mes nombreuses absences.
Enfin, merci à toi, Francis, pour ton soutien, ton écoute attentive et ta présence essentielle à
l’accomplissement de ce projet. Toi, qui réussis toujours à trouver des possibilités en moi
que je ne soupçonnais plus, merci pour tes délicates attentions qui ont su embellir les
journées de pluie.
À la mémoire de Kelly-Ann
Pour Laurence et ceux qui viendront

1
INTRODUCTION
Depuis ses premières manifestations dans les années 1950, le théâtre pour enfants au
Québec a bien changé tant dans les formes proposées que dans l’audace de ses contenus. Si
l’évolution de ce jeune théâtre est constamment marquée par la recherche d’un « quoi dire »,
qui se manifeste par une remise en cause continuelle du contenu et de la forme de ses
productions, ce sont les années 1990 qui repoussent le plus les limites des sujets abordés,
s’engageant sur les territoires dangereux que sont l’inceste, la violence et même la mort. Ces
nouvelles propositions sont d’abord le fait d’une dramaturgie forte, s’éloignant peu à peu du
simple divertissement ou, à l’opposé, du didactisme absolu. En effet, les pièces destinées aux
enfants vers la fin des années 1980 ne tentent plus de camoufler la réalité d’un monde abîmé.
Davantage dans la décennie 1990, s’étant éloignés des exigences scolaires, les auteurs
abordent des sujets qui touchent petits et grands, à commencer par eux-mêmes, et ne tiennent
pas les enfants à l’écart des préoccupations existentielles. C’est ainsi que les années 1990
vont voir naître des textes complexes, portant sur des problématiques qui le sont tout autant.
Certains adultes sont stupéfaits en constatant que les artistes osent présenter « ça » aux
enfants. « "Ça" voulait dire une situation émotivement chargée et exceptionnelle
1
», explique
Suzanne Lebeau, en pensant au traitement de l’inceste dans sa pièce inédite Petite fille dans
le noir (1991). Vient alors la lourde question : peut-on parler de tout aux enfants par le biais
du théâtre ? Peut-on aborder des sujets dits « difficiles » devant un jeune public ? En réponse
à ces questions, de vives polémiques se soulèvent. Pour notre part, nous ne chercherons pas à
prendre position dans ces débats, pour plutôt nous concentrer sur l’étude de ce répertoire.
1
Joël Jouanneau, Itinéraire d’auteur no 6, Suzanne Lebeau, Villeneuve-lez-Avignon, Édition Centre National
des Écritures du Spectacle–La Chartreuse et Lanctôt, coll. « Itinéraire d’auteur », 2002, p. 38.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
1
/
120
100%