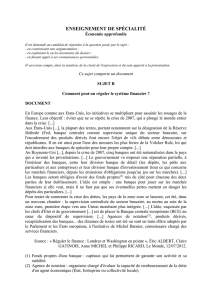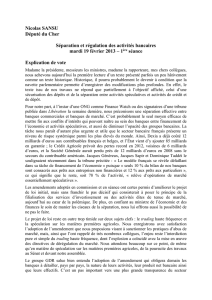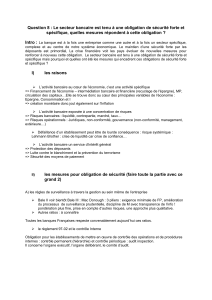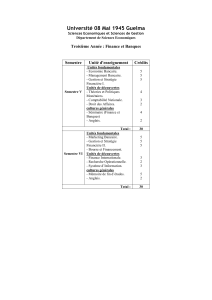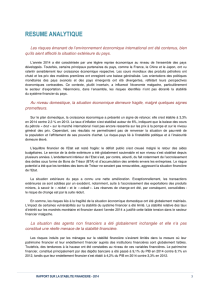Mémoire 1994 D.E.A. Monnaie, Finance, Banque

UNIVERSITE DE PARIS I PANTHEON-SORBONNE
U.F.R 02
THEORIE DES SYSTEMES
COMPLEXES ET INSTABILITE
FINANCIERE
Mémoire pour le Diplôme d' Etudes Approfondies de
Monnaie, Banque, Finance
présenté par Jérôme SOULAT
à la session d' Octobre 1994
Mémoire dirigé par Mme -Thérèse CHEVALLIER
L' Université de Paris I PANTHÉON-SORBONNE
n'entend donner aucune approbation, ni improbation,
aux opinions émises dans ce mémoire; ces opinions doivent être
considérées comme propres à leur auteur

" Le savoir économiste qui s'enferme dans l'économique devient
incapable d'en prévoir les perturbations et le devenir, et devient
aveugle à l'économique lui-même."
Edgar Morin, Terre-Patrie
" L'homo-oeconomicus apparait comme un être vide et sans âme, mu par
des mobiles rudimentaires et tout juste capable de s'adapter
passivement aux «forces» du marché.
René Passet, L'économique et le vivant
" Entre 1e probable et le possible, se situent aussi bien la volonté
que l'aléatoire, la catastrophe, la crise globale ou la
révolution "
Joël de Rosnay, Le macroscope

THEORIE DES SYSTEMES COMPLEXES
ET INSTABILITE FINANCIERE
SOMMAIRE
INTRODUCTION ........................................
PARTIE I LA NOTION DE SYSTEME COMPLEXE ..............
I.1 ORDRE, DESORDRE ET ENTROPIE ..................
1- L'ordre comme paradigme ..........................
2- L'entropie .......................................
3- Le désordre organisateur .........................
I.2 ORGANISATION ET AUTO-ORGANISATION ............
1- L'organisation ...................................
2- Le jeu élément-tout ..............................
3- La complexité ....................................
4- De l'auto-organisation à la causalité complexe ...
I.3 INFORMATION ET NEGUENTROPIE ..................
1- De l'information ..................................
2- ...A la néguentropie .............................
CONCLUSION ..........................................
PARTIE II REDEFINIR LE RISQUE .......................
II.1 DU RISQUE PARTIEL ............................
1- Risque de crédit ou de défaut ....................
2- Risque de marché .................................
3- Risque de liquidité / solvabilité ................
4- Risque de remboursement anticipé .................
5- Risque technique .................................
6- Risque juridique et/ou réglementaire .............
7- Risque de gestion ................................
8- Fraudes ..........................................
9- Risques liés au hors-bilan .......................
II.2 ...AU RISQUE GENERAL ........................
1- Le risque de run bancaire ........................
2- La déflation par les dettes ......................
3- Emballements spéculatifs .........................
4- L'interbancaire ..................................
5- Risques de la concurrence ........................

CONCLUSION .........................................
PARTIE III LE RISQUE SYSTEMIQUE .....................
III.1 LE JEU DES INTERACTION .....................
1- Les risques deux à deux ..........................
2- Du rationnement du crédit .........................
3- ...Au surendettement des ménages .................
III.2 LE JEU DE LA COMPLEXITE ....................
1- Le fonctionnement des marchés ....................
2- Vers des théories multidimensionnelles ...........
-a- Anatomie des crises (Lacoue-Labarthe) ...........
-b- Myopie au désastre (Aglietta) ...................
-c- La synthèse de Davis ............................
III.3 OU L'ON RETROUVE L'INFORMATION .............
1- L'illusion patrimoniale ..........................
2- Prophéties auto-réalisatrices ....................
-a- Bulles rationnelles .............................
-b- Comportements mimétiques ........................
-c- Vers un réexamen de l'efficience ................
3- La fin d'un paradigme ............................
CONCLUSION ..........................................
PARTIE IV CONSEQUENCES POUR LES AUTORITES MONETAIRES .
IV.1 LE PRETEUR EN DERNIER RESSORT ...............
IV.2 L'ASSURANCE DES DEPOTS ......................
IV.3 LA REGLEMENTATION ...........................
IV.4 LA SURVEILLANCE .............................
IV.5 LA CREDIBILITE ..............................
CONCLUSION ..........................................
CONCLUSION GENERALE .................................
BIBLIOGRAPHIE ......................................

INTRODUCTION
Les deux dernières décennies ont été marquées par de nombreuses
crises financières, de nature et d'ampleur diverses. C'est ainsi
que l'on a pu observer dans plusieurs pays, des krachs boursiers,
des défaillances bancaires, des crises de change ou des
contractions du crédit.
Les récents problèmes de la BANESTO en Espagne, du Crédit-
Lyonnais en France ou l’actuel "krach rampant" poussent à
s'interroger.
Il est difficile de dire si ces manifestations sont des
phénomènes isolés ou si, au contraire, elles témoignent d'une
instabilité du système. Néanmoins, l'existence de canaux de
transmission, de facteurs de propagation et d'auto-entretien de
ces crises rend nécessaire l'étude du risque systémique.
De plus, l'environnement bancaire et financier a connu de
profondes mutations dans la période récente. Nouveaux produits,
déréglementation, accroissement de la concurrence, ne sont que
quelques exemples des bouleversements observés. Dés lors, on peut
considérer les crises comme de simples troubles passagers liés à
ce changement des règles du jeu. Mais ce serait préjuger de
l'aboutissement des mutations qui sont encore à l'œuvre.
Par la multiplicité de ses activités, la firme bancaire est
concernée par toutes les formes de ces crises. C'est pourquoi
elle constituera le point focal de notre analyse.
Mais les autorités économiques et monétaires sont les entités
les plus directement concernées par l'étude du risque systémique.
Elles sont en effet les garantes de la stabilité du cadre
d'activité des agents économiques. En effet, comme le souligne
Bordes [1991], les faillites bancaires génèrent des couts sociaux
multiples qui dépassent les effets privés habituels d'une
faillite.
Ce sont elles, de plus, qui ont les moyens de renforcer le
filet de sécurité constitué entre autre par la réglementation
prudentielle, la surveillance et le contrôle.
Mais un problème se pose pour comprendre le risque systémique.
D'abord, le concept de système en finance est souvent un concept
pauvre, un concept fantôme, se résumant à une collection
d'élément ayant des relations entre eux. Du coup, la présentation
des risques s'apparente à une liste, un catalogue des difficultés
que peut rencontrer la firme bancaire.
Ainsi, afin de comprendre le risque systémique, nous
chercherons dans une première partie à définir un concept de
système; forts de la conviction que la théorie des systèmes
complexes fournit des éléments d'analyse utiles.
Dans une deuxième partie, nous verrons comment la littérature
économique fournit une typologie des risques, qu'ils soient
basiques ou globaux.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
1
/
110
100%