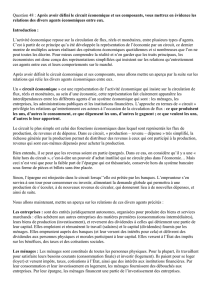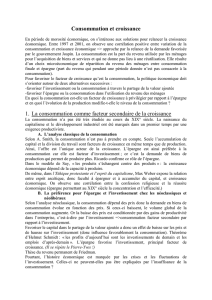SES 2e - Thème 1


SES 2e Magnard - Extrait (Thème 1 - Question 1) - Reproduction interdite

Enseignement d’exploration
Sciences économiques et sociales
P
R
O
G
R
A
M
M
E
2
0
1
0
2e
Coordination
Mireille NIVIÈRE
Professeur au lycée Jean-Aicard, Hyères (Var)
Catherine BEDDOCK-DIET
Professeur au lycée de l’Empéri, Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône)
Dominique BEDDOCK
Professeur au lycée de l’Empéri, Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône)
Laurence BENAÏM
Professeur au lycée Lavoisier, Paris (Île-de-France)
Florence DELFORT
Professeur au lycée Marseilleveyre, Marseille (Bouches-du-Rhône)
Thierry FERNANDEZ
Professeur au lycée Gambetta, Tourcoing (Nord)
Aïssa GRABSI
Professeur au lycée Antonin-Artaud, Marseille (Bouches-du-Rhône)
Jean-Pierre GUIDONI
Professeur à l’IUFM, Université de Provence (Bouches-du-Rhône)
Les auteurs ont réalisé ce manuel en l’absence et en mémoire de leur co-auteur des ouvrages précédents, Nicolas ROUANET,
professeur au lycée Edmond Perrier de Tulle-Issel, disparu en octobre 2009. Le Prix de SES que la Chambre de Commerce
de Tulle-Issel attribue aux élèves les plus méritants de Terminales ES porte aujourd’hui son nom.
SES 2e Magnard - Extrait (Thème 1- Question 1) - Reproduction interdite

2
Aux termes du code de la propriété intellectuelle, toute reproduction ou représentation intégrale
ou partielle de la présente publication, faite par quelque procédé que ce soit (reprographie,
microfilmage, scannérisation, numérisation…), sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants
droit ou ayant cause, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2
et suivants du code de la propriété intellectuelle. L’autorisation d’effectuer des reproductions par
reprographie doit être obtenue auprès du Centre Français d’exploitation du droit de Copie (CFC),
20 rue des Grands-Augustins – 75006 Paris – Tél. : 01 44 07 47 70 – Fax : 01 46 34 67 19.
© Magnard – Paris, 2010
5, allée de la 2e DB, 75015 Paris
ISBN : 978-2-210-10503-4
Cet ouvrage a été imprimé sur du papier provenant de forêts durablement gérées et par un imprimeur labellisé Imprim’Vert.
SES 2e Magnard - Extrait (Thème 1 - Question 1) - Reproduction interdite

3
Préface aux élèves
130
Hommes, femmes, des mondes parallèles ?
Doc. 2
3. Commentez la question « Le cerveau a-t-il un
sexe ? ».
4. Donnez les raisons scientifi ques qui permettent
d’affi rmer que les comportements ne sont pas
innés, mais résultent d’un apprentissage.
EXPLOITER
UN
DOCUMENT
THÈME 5
Question 1
Monde des hommes,
monde des femmes ?
ZOOM
Doc. 1
Doc. 2
TOUS LES BONHEURS DU MONDE
TRIDENT – COLLECTION PRINTEMPS-ÉTÉ 2010
TOUS LES BONHEURS DU MONDE
DÉCOUVERTE
Doc. 1
1. Que révèle cette publicité des stéréotypes
associés aux hommes et aux femmes ?
2. Les personnages de ces publicités sont-ils
interchangeables ? Pour quelles raisons ?
EXPLOITER
DES
DOCUMENTS
L
e cer veau a-t-il un sexe ? […] On serait ainsi
parvenu à comprendre pourquoi les femmes
sont bavardes mais incapables de comprendre
une carte routière, et pourquoi les hommes sont
naturellement doués pour les maths et compétitifs.
[…] Le volume, la forme, le mode de fonctionnement
diff èrent tellement entre individus d’un même sexe,
qu’il est impossible de dégager des traits propres à
un cerveau masculin ou féminin.
[…] Nos circuits de neurones sont largement
fabriqués au gré de notre histoire personnelle.
Seules 10 % des connexions sont présentes à la
naissance. Les 90% restantes vont se construire
progressivement en fonction des infl uences de la
famille, de la culture, de la société. Il en résulte
que nous avons tous des cerveaux diff érents. Cette
plasticité cérébrale, très prononcée chez l’enfant, est
toujours à l’œuvre chez l’adulte. Il s’agit là d’une
notion importante à considérer pour éviter de
tomber dans le piège de certaines interprétations
hâtives : voir des diff érences, entre les individus ou
entre les sexes, ne signifi e pas qu’elles sont inscrites
dans le cerveau depuis la naissance et qu’elles y
resteront.
Catherine Vidal, « Cerveau, sexe, idéologie », Féminin Masculin,
Mythes et idéologies, Catherine Vidal dir., Belin, 2006.
2210105034_126-139_SES2_TH5_1.indd 130 1/06/10 13:37:46
Vous venez d’entrer en Seconde, au lycée, et parmi les surprises et nouveautés
qui vous attendent, la découverte d’une nouvelle matière, les Sciences
Économiques et Sociales (SES).
Il s’agit d’un enseignement dit d’« Exploration » qui a pour objectif de vous
faire découvrir le monde qui vous entoure, à le comprendre et à décrypter
les mots employés par les journaux, la radio ou la télévision.
Ne vous y trompez pas, toute exploration demande vigilance
et travail, ne confondez pas « exploration » et « balade » !
En concevant ce manuel, nous avons voulu vous offrir un support
efficace qui part de cas concrets (ce sont les pages « Zoom »), vous
met les outils intellectuels en main (ce sont les pages « Analyse »)
et sollicite, en conclusion, votre esprit d’initiative et de déduction (ce
sont les pages « Application »).
Des « Bilans » vous permettront de faire le point sur vos nouvelles
connaissances – ce sont en quelque sorte les étapes de votre parcours
d’explorateur.
À la fin de chacun des cinq thèmes, vous trouverez des « Ateliers TICE »
qui reposent sur des technologies que vous connaissez souvent mieux
que vos aînés et qu’il s’agit maintenant de mettre au service de votre
formation et de votre culture économique et sociale.
Les « Fiches-outils » enfin vous aideront à util iser les premiers
instruments d’analyse économique et sociale. Elles vous
serviront en Première et en Terminale si vous choisissez la série
ES, (à découvrir pages 172-173).
Quelle que soit votre orientation future, cet apprentissage des SES
vous sera très utile pour votre culture générale et dans votre vie de
citoyen.
Nous vous souhaitons une belle année de découverte
et d’exploration.
Les auteurs
THÈME 1 Question 2 La consommation, un marqueur social ? 35
BILAN
NOTIONS
Consommation
ostentatoire ...................29
Imitation et distinction .. 29
A. Consommation ostentatoire, imitation et dis-
tinction
La c ons om m at i on n e s e ré du it p as à d e s ca ra c té ri s-
ti qu e s é co n om iq u es , e l le co mp o rt e é g al em e nt un e d i -
me n si o n s o ci a le . Le s in d iv id u s n e co n so mm e nt p as s eu le -
me nt l e s pr o du it s po u r le s ut i li se r m ai s au s si p ou r s ig ni fi er
le ur a pp a r te na n ce à u n gr ou p e so ci a l do n né . On évoque
al or s l a c on s om m at io n o s te n ta t oi re : c et « eff et de s i gn e »
pousse les catégories supérieures à se distinguer, alors que
les autres catégories cherchent à les imiter.
C e p en d a n t d a ns n os s o c i é t és c on t e mp o r a i n e s e t v i ei l l is -
s a n te s , o n c h e r c h e é g al e m en t à i mi t e r d ’ a u t r es g r ou p e s s o c i au x
tels les jeunes dans le domaine vestimentaire ou langagier.
Le s pr é fé re n ce s ne s e d iff us e nt d on c p as e xc lu s iv em e nt
du h au t v e rs l e b as d e l a hi é ra rc h ie so c ia le . Le s co ns o m-
ma te u rs co mb i ne n t ai n si pl us i eu rs as p ir at i on s e n v ou l an t
êt re l a f oi s or ig i na u x e t si n gu l ie r s, to u t e n c h er ch a nt la
co n fo rm i té et l a r ec o nn a is s an c e du groupe de référence.
La mo de ré su l te d e c e d ou b le m o uv em e nt d’ im i ta t io n e t
de d i st i nc t io n ; el le d o it p er p ét u el le m en t ch an g er p o ur
ma in t en i r sa fo n ct io n d is t in c ti ve . L es en t re pr is e s u ti li s en t
ma ss i ve me n t la p u bl i ci t é pour orienter les choix de
co ns o mm a te ur s e t a cc ro î tr e l eu rs ve nt e s.
B. Facteurs sociaux et consommation
D’ au t re s fa ct e ur s s o ci a ux v on t e nc or e c on di t io n ne r
le s co mp o rt em e nt s de s c on so m ma te u rs . L’â ge et le l ie u
de r és i de n ce , l e ni ve au d ’ in s tr u ct i on , la p r o fe s si on
orientent la structure et les choix de consommation.
Le c a ra c tè re e x tr a ve rt i d e la con s om m at io n , ca -
ractérisé par des dépenses élevées d’habille ment, de
tr an s po r t e t de co m mu ni c at io n , a ug me n te av ec la
ta il l e de la vi ll e d e ré si d en ce , a v ec le n i ve au d’ in s-
truction et diminue avec l’âge.
En fi n , la p r of es s io n m od èl e l es c h oi x de s c on so m -
ma te u rs ; u n a g ri cu l te ur p ar ti r a m oi n s s ou ve n t e n
vacances d’été du fait de contraintes professionnelles
et un enseignant consommera davantage de produits
culturels.
La l ib er t é du c on s om m at e ur est donc illusoire ;
elle est fortement limitée par les dynamiques sociales,
le s st r at é gi es p u bl ic i ta ir e s de s en t re pr i se s et l a p os it i on
qu e l ’o n o cc up e d a ns l a s oc i ét é.
LA CONSOMMATION :
MARQUEUR SOCIAL
Déterminants socio-culturels :
– Âge, sexe
– Niveau d’instruction, PCS
– Lieu de résidence
Déterminants économiques :
– Niveau des revenus
– Prix
– Marketing, effet de marque
Effet de distinction
et d’imitation Publicité
Schéma Bilan
SYNTHÈSE
THÈME 1
Question 2
2210105034_024-035_SES2_TH1_2.indd 35 1/06/10 13:33:17
1. Donnez deux exemples qui
illustrent chacun des mots en gras
dans la défi nition de l’UNESCO.
2. Quels sont les éléments communs
à ces trois regards ?
Quels éléments diffèrent ?
3. Qu’est-ce qu’illustre
la photo de droite ?
ACTIVITÉS
Valider des compétences du brevet informatique et Internet : B2I
1. Compétence du domaine 4 : s’informer, se documenter
(L.4.1 « Je sais utiliser des fonctions avancées des outils de recherche sur Internet. »)
2. Compétence du domaine 5 : communiquer/échanger
(L.5.1 « Je sais choisir le service de communication selon mes besoins. »)
OBJECTIF
15 2
THÈME
5
Atelier TICE • INDIVIDUS &
1
La culture : un mot, des regards, des défi nitions
LE REGARD de l’ethnologue
« Posons donc que tout ce qui est universel, chez l’homme, relève de la
nature et se caractérise par la spontanéité, que tout ce qui est astreint à
une norme appartient à la culture et présente les attributs du relatif et du
particulier. »
Claude Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté, 1948.
LE REGARD de l’anthropologue
« La culture est un ensemble complexe qui comprend les connaissances, les
croyances, l’art, le droit, la morale, les coutumes et toutes les autres aptitudes
et habitudes qu’acquiert l’homme en tant que membre d’une société. »
Edward Tylor, Primitive culture, 1874.
UN REGARD UNIVERSEL, la défi nition de l’UNESCO
« Dans son sens le plus large, la culture peut aujourd’hui être considérée
comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels
et aff ectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe,
outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l’être
humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. »
Conférence mondiale sur les politiques culturelles, Mexico, juillet août 1982.
Le chef Indien Raoni de la tribu Kayapo (Brésil)
rencontrant le Président Mitterand (avril 1989)
Cl au de L év i- St ra us s (1 90 8- 20 09 )
« Je h ai s le s vo ya ge s et l es e xp lo ra te ur s »
2210105034_152-153_TH5.indd Sec1:152 1/06/10 13:51:48
PRÉFACE AUX ÉLÈVES
SES 2e Magnard - Extrait (Thème 1- Question 1) - Reproduction interdite
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%


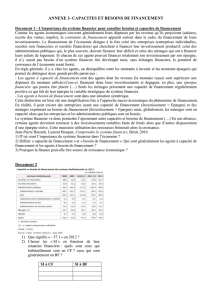
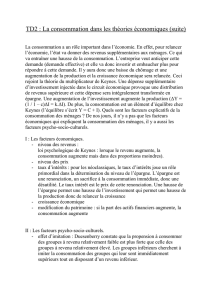

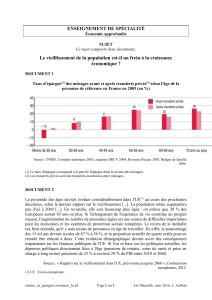
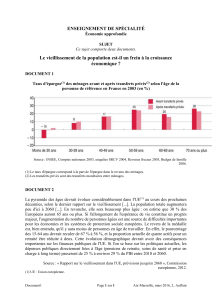
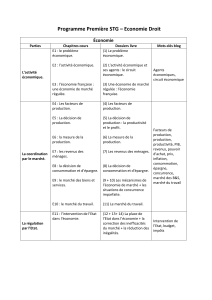
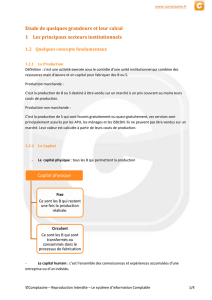
![[…] Il est demandé au candidat de répondre à la question](http://s1.studylibfr.com/store/data/005782290_1-4e0a9f168370a43f95ede41383956fb9-300x300.png)