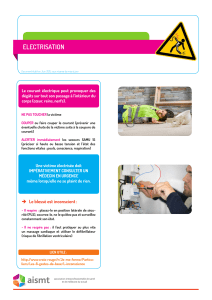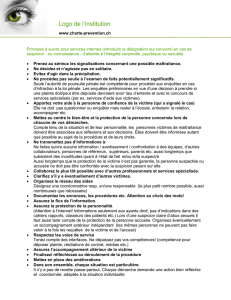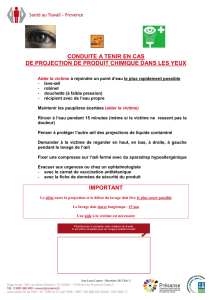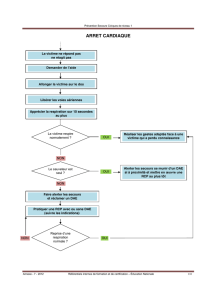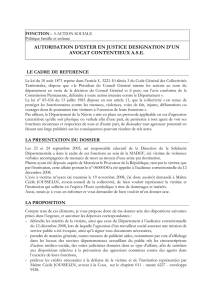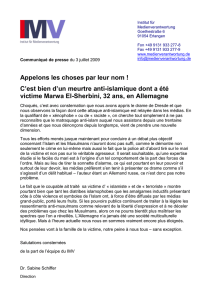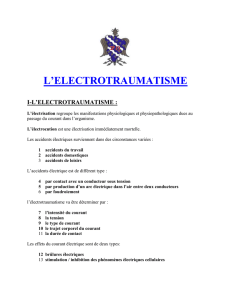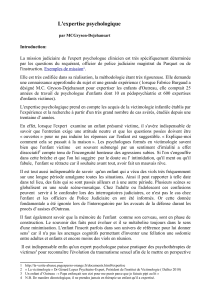Introduction à la Victimologie : Enjeux, Concepts, Cliniques

Introduction à la Victimologie – cours de C. Bouchard, MC Université Rennes 2
1
Université Rennes 2
INTRODUCTION À LA VICTIMOLOGIE
1
Enjeux – Concepts – Cliniques
Plan
I. PLACE DE LA VICTIMOLOGIE EN CRIMINOLOGIE
1. Qu’est-ce que la criminologie ?
2. Qu’est-ce que la psychocriminologie ?
2.1. Psychologie criminologique
2.2. Psychologie judiciaire et pénale
2.2.1. La psychologie judiciaire (ou légale)
2.2.2. La psychologie pénale
II. ORIGINES ET CHAMP DE LA VICTIMOLOGIE
1. Qu’est-ce qu’une victime ?
1.1. Du sacrifice à la victime (étymologie)
1.2. Analyse de la notion de victime
1.3. La victime infractionnelle
2. Qu’est-ce que la victimologie ?
2.1. Naissance de la victimologie
2.1.1 Précurseurs
2.1.2. L’invention de Benjamin Mendelsohn
2.2. À la recherche d’une victimologie autonome
III. CLINIQUES VICTIMOLOGIQUES
1. Facteurs et conditions de victimation
1.1. Devenir victime
1.1.1. Le modèle de la névrose
1.1.2. La victime sérielle
1.2. Être victime
1.2.1. Le syndrome d’accommodation (ou d’adaptation)
1.2.2. Le syndrome de Stockholm
1
- Cours de Claude BOUCHARD, MC, Psychologie, Université Rennes 2 – version nov.-déc. 2014.

Introduction à la Victimologie – cours de C. Bouchard, MC Université Rennes 2
2
2. Victime psychique et psychologie de la victime
2.1. Du stress au traumatisme
2.1.1. Les théories du stress et le PTSD
2.1.2. Les deux théories du traumatisme de Sigmund Freud
2.1.3. Le syndrome de répétition traumatique (SRT)
2.2. La positon victimale
2.2.1. Victimité
2.2.2. Le travail de victime
Références bibliographiques
Annexes
1. Repères historiques
2. Troubles psycho-traumatiques : comparaison CIM-10 / DSM-IV
2. Syndrome de Répétition traumatique (SRT) et névrose traumatique (schéma)

Introduction à la Victimologie – cours de C. Bouchard, MC Université Rennes 2
3
INTRODUCTION À LA VICTIMOLOGIE
Histoire – Concepts – Cliniques
Nous développerons ici une présentation générale et actuelle de la victimologie du
point de vue de la psychologie clinique et de la psychopathologie.
Après avoir précisé la place de la victimologie dans le champ plus large de la
criminologie (première partie), nous présenterons dans une seconde partie une analyse
de la notion de victime ; puis dans une troisième partie, les différents aspects cliniques de
la victimologie qui s’ensuivent, en nous appuyant sur les apports des différents courants
de la victimologie.
Nous laisserons de côté, pour ce cours, les questions de pratiques diagnostiques et
thérapeutiques.
I. PLACE DE LA VICTIMOLOGIE EN CRIMINOLOGIE
1. Qu’est-ce que la criminologie (Rappel)
Sans entrer dans le débat qui ne cesse d’interroger la spécificité et l’homogénéité
du champ criminologique – quand ce n’est pas pour discuter de sa scientificité –, disons
simplement que la criminologie est l’étude du crime.
2
Étymologiquement, la criminologie est « discours sur le crime », le crime lui-même
étant « ce qui peut faire l’objet d’une accusation » (crimen, en grec : accusation).
Les sociologues abordent la question du crime à travers la notion de déviance
(sociologie des déviances). Quant aux juristes, ils préfèrent généralement parler de
sciences criminelles plutôt que de « criminologie ».
Nous pouvons souscrire à la définition suivante, proposée par le juriste
contemporain Raymond Gassin :
« [La criminologie est] la science qui étudie les facteurs et les processus de l’action
criminelle et qui détermine, à partir de la connaissance de ces facteurs et de ces
processus, les stratégies et les techniques les meilleures pour contenir et si possible
réduire ce mal social. » (R. Gassin, Criminologie, 1990, p. 41)
En ce sens, la criminologie se distingue :
du droit pénal, qui a pour but de définir des normes sociojuridiques, d’établir les
types d’infractions relatives à ces normes, ainsi que les peines qui s’y
rapportent ;
de la pénologie, puisque celle-ci étudie les sanctions pénales : leur fonction, les
règles de leur exécution, les moyens de leur application.
En termes de corpus de textes législatifs, le droit pénal correspond au code pénal
(CP) et la pénologie au code de procédure pénale (CPP).
2
- Il est d’usage courant en criminologie (et aussi dans le langage politique) d’employer les mots
« crime » et « criminalité » dans un sens général, qui recouvre tous les types d’infractions à la loi
pénale.

Introduction à la Victimologie – cours de C. Bouchard, MC Université Rennes 2
4
« Droit pénal et criminologie : Ce titre bicéphale recouvre deux sortes de recherche,
apparemment semblables si l’on s’en tient à leur thème, mais profondément
différentes par leurs points de vue et leurs démarches. L’une est juridique à
proprement parler ; elle appartient au bloc des disciplines normatives. Elle étudie
le droit pénal d’un point de vue interne. L’autre l’aborde d’un point de vue externe :
elle prend le pénal comme un fait social et lui applique l’une quelconque des
sciences empiriques de l’homme et de la société. » (Ph. Robert, 1986, p. 309)
Pénalisme (étude du droit pénal) et pénologie (étude du droit de la procédure
pénale) sont donc des domaines strictement juridiques, et c’est essentiellement par ce trait
qu’ils se distinguent de la criminologie.
2. Qu’est-ce que la psychocriminologie ?
Les disciplines constituant la criminologie sont nombreuses et diverses. Nous
l’avons dit, on y retrouve notamment les sciences humaines et sociales – dont la
psychologie.
On pourra globalement appeler psychocriminologie la contribution de la psycho-
logie à l’étude du crime.
Partant de là, il faut toutefois distinguer deux domaines différents, correspondant à
des ensembles distincts de questions et de problèmes :
- la psychologie criminologique
- la psychologie judiciaire et pénale.
2.1. Psychologie criminologique
Nous parlerons de psychologie criminologique pour désigner l’approche psycho-
logique qui vise l’étude explicative des conduites criminelles. Il s’agit, en ce cas, d’élaborer
et de valider des modèles théoriques pouvant rendre compte, d’un point de vue psycho-
logique, de l’acte criminel en général, de ses processus, de sa genèse. Toutes les disciplines
de la psychologie peuvent y contribuer.
Lorsqu’elle envisage l’acte comme étant l’effet d’un dysfonctionnement psychique
(individuel ou groupal), la psychologie criminologique se confond avec la psychopathologie
des conduites criminelles.
Dans le champ de la psychopathologie, et si nous empruntons par exemple à la
psychanalyse, nous disposons pour cela de concepts et de modèles, tels ceux : de pulsion,
d’angoisse, d’agir, d’inhibition, etc. Nous pouvons ainsi rendre compte de l’acte criminel
comme d’un processus, référable aux grandes structures mentales, à leurs caracté-
ristiques, à leurs modes d’aménagement.
Remarques :
Quand nous parlons de psychopathologie, nous ne parlons pas seulement de la
psychopathologie psychanalytique. En psychopathologie, il existe plusieurs courants :
psychopathologie phénoménologique, théorie organo-dynamique, behaviorisme, neuro-
psychologie, etc. (Ionescu, 1991 ; Widlöcher, 1994). Dans chacun de ces champs, de plus,
existent plusieurs modèles théoriques différents (dans le champ psychanalytique par
exemple : modèle freudien, modèle kleinien, modèle lacanien, modèle mahlérien...).

Introduction à la Victimologie – cours de C. Bouchard, MC Université Rennes 2
5
La psychopathologie des conduites individuelles ne se limite pas à une approche
individuelle du crime, elle peut aussi rendre compte de phénomènes collectifs et groupaux.
De façon générale, la psychopathologie n’est pas à réduire à une psychologie individuelle.
À la limite, les actes dits délictueux ou criminels constituent une clinique privi-
légiée, au bénéfice de certains problèmes de psychopathologie générale : clinique de la
culpabilité, de la responsabilité, de la parentalité, des conduites à risques, de l’agres-
sivité, etc. (Ex. : l’étude psychopathologique de la maltraitance nous offre un éclairage
quasiment « expérimental », par son caractère même de conduite extrême, sur ce qu’est
« être parent ».)
2.2. Psychologie judiciaire et pénale
On parle parfois de « criminologie clinique » pour désigner la contribution de la
psychologie au traitement judiciaire et pénal du crime (Pinatel, 1987). Selon la définition
qu’en a donnée en 1958 Benigno di Tullio (médecin italien), la criminologie clinique a pour
objet :
a) de procéder à l’étude du délinquant et de son acte sous tous ses aspects, grâce
à un examen médico-psychologique et social, qui est, par nature, pluri-
disciplinaire ;
b) d’apprécier la personnalité du délinquant et son état dangereux ;
c) de formuler éventuellement le programme du traitement qui devrait lui être
appliqué ;
d) de suivre l’exécution de ce traitement et d’en contrôler les effets.
(N.B. : Ces quatre objectifs concernent une contribution à la fois médicale, psycho-
logique et sociale.)
Comme on peut le constater, les objectifs de la « criminologie clinique » sont
essentiellement pratiques, et diffèrent donc de ceux de la psychologie criminologique,
même si elle s’y réfère nécessairement. Elle implique également des aspects méthodo-
logiques et déontologiques spécifiques, autres que ceux de la psychologie criminologique.
Cependant, dans la mesure où les questions liées à l’instruction (ou information)
judiciaire ne sont pas les mêmes que celles que posent la peine, son exécution, et ses effets,
nous proposons de distinguer :
- la psychologie judiciaire (ou psychologie légale)
- la psychologie pénale.
2.2.1. La psychologie judiciaire (ou légale)
La psychologie judiciaire fait partie de ce qu’on appelle la criminalistique.
La criminalistique est l’ensemble des savoirs et techniques mis au service de la
justice, pour établir des faits matériels liés à l’acte criminel et à la culpabilité des
personnes. La criminalistique inclut : la police scientifique et technique, la médecine
légale, l’identité judiciaire, la psychologie judiciaire – et plus globalement, toutes les
techniques pouvant concourir à l’établissement des preuves (conformément aux
principes d’une justice inquisitoriale). Juridiquement, la criminalistique relève de la
procédure pénale. Elle en constitue la partie technique et pratique non strictement
juridique.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
1
/
53
100%