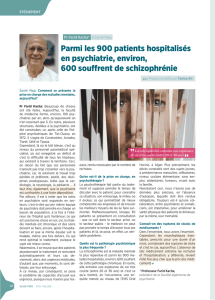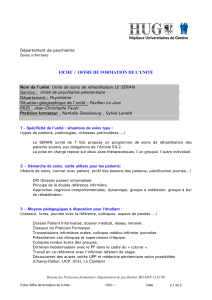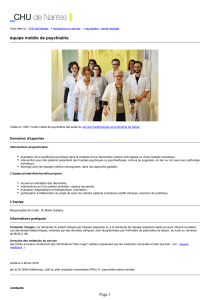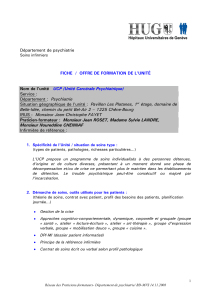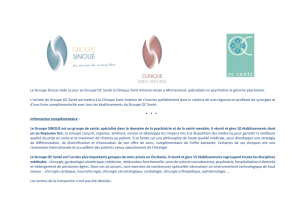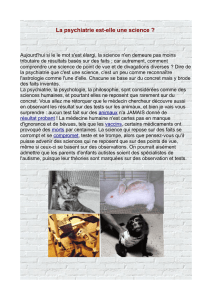Mise en page 1

N ° 8
Les Échos du CPNLF
Post Scriptum
d'un Congrès à l'autre...
109e session
Conférence du Président
Classification des troubles
mentaux et nosographie
psychiatrique
Hommage à Bleuler :
100 ans de schizophrénie

Post Scriptum
2N°8
Directeur de la publication : Pierre Thomas - Rédacteur en Chef : Patrick Martin
Infographiste : Vivianne Lambert - Photos de ce numéro : Martine Bertheuil
L'Association du Congrès de Psychiatrie et de Neurologie de Langue Française (CPNLF) est une société savante qui, depuis plus de
100 ans, a pour but l'étude et la discussion de questions concernant la psychiatrie, la neurologie, la médecine légale et l'assistance
aux malades atteints des maladies du cerveau.
C’est une association scientifique sans but lucratif, reconnue d’utilité publique par décret du 23 mars 1932, qui est largement
ouverte à différents types de praticiens cliniciens, chercheurs et acteurs de santé des maladies du cerveau, l’essentiel de ses membres
étant des médecins psychiatres. Elle comprend aujourd’hui plus de 600 membres actifs, qui sont impliqués dans des approches très
diverses : psychiatrie clinique, psychopharmacologie, médecine légale, neurophysiologie, etc.
Les informations délivrées lors de son congrès annuel ou sur son site internet (www.cpnlf.fr) répondent à un objectif simple de
développement des connaissances, de confrontations des pratiques et de formations médicales professionnelles dans un objectif
final commun d’amélioration de la prise en charge et de la qualité des soins.
L'Association du Congrès de Psychiatrie et de Neurologie de Langue Française (CPNLF) a mis en place une dynamique
transdisciplinaire des connaissances sur le cerveau, avec le concours de ses commissions principalement, "Psychiatres en formation",
"Relation Internationale", "Neurosciences et Neurologie", "Médecins Libéraux" et la commission du FUAG "Formation d’investigateur
de recherche clinique".
L’élaboration de référentiels, la Formation Médicale, le Développement Professionnel Continu sont aussi des objectifs prioritaires de
l'Association du Congrès de Psychiatrie et de Neurologie de Langue Française (CPNLF).
Elle cherche à susciter et encourage les vocations dans la diffusion de travaux de recherche dans tous les domaines appliqués aux
maladies mentales en accordant trois "Prix de Première Communication du CPNLF" et "Prix du meilleur Poster".
Elle se veut regrouper également dans ses démarches scientifiques les pays de langue française.
Pour la 109e édition du congrès de l’association, qui s'est déroulée du 7 au 10 juin 2011 au Palais des Congrès de Paris, le comité
scientifique et les organisateurs ont élaboré un congrès favorisant les échanges et l’ouverture.
Un congrès qui a été ouvert sur des questions d’actualité qui interrogent nos pratiques et qui posent un grand nombre de questions.
En effet, bien qu’à l’heure actuelle tout semble mis en œuvre pour améliorer la qualité des soins, on ne peut néanmoins que constater
qu’il n’existe que peu de données robustes en santé mentale, sur lesquelles les acteurs de santé, dans cette discipline, puissent
s’appuyer pour une meilleure aide à la décision thérapeutique.
Cette situation liée à la psychiatrie n’est pas une situation particulière à la France. Le directeur du National Institutes of Mental
Health (NIMH) aux États-Unis avait dépeint il y a quelques années "le malheureux état actuel" de la psychiatrie "où trop d’études
de recherche offrent peu de pertinence immédiate pour la pratique et trop peu de pratique repose sur des résultats de recherche".
Nous pourrions dire sans trop se tromper que cette situation n’a guère évolué, même si des progrès ont été faits.
La question primordiale qui pourrait être alors posée serait : quelles sont les répercussions de cette situation pour les patients ?
Aussi, à notre époque de médecine factuelle, cette rareté des données probantes de grande qualité a eu pour conséquence la mise
en place de nombreux programmes visant à remédier le mieux possible à cette situation. Par exemple, l'une des stratégies a consisté
à créer des réseaux de cliniciens dans de nombreux centres de soins, hospitalo-universitaires le plus souvent, et à suivre des cohortes
de patients dans ce contexte. La mise en place d’études post-AMM, de type "pragmatique" ou "comme dans la pratique quotidienne"
ont commencé à faire leur apparition depuis quelques années, mais demeurent encore trop peu nombreuses et de méthodologie trop
peu rigoureuse. Mais il semble évident que de telles études pourraient entraîner des changements importants de la pratique et de la
prise en charge des patients souffrant de pathologies mentales.
Toutefois, sommes-nous prêts à accepter les résultats obtenus ou à obtenir à partir de certaines de ces études, pour changer nos
habitudes thérapeutiques ou remettre en question les schémas établis de longue date ?
Il apparaît donc de plus en plus important de développer des actions qui vont dans le sens du meilleur traitement au meilleur
moment pour le patient. La psychiatrie doit intégrer la recherche aux soins, translationnelle ou non, en réalisant des études
d’envergure et en appliquant les résultats au moment présent et en continuant à partager les données obtenues au cours de
manifestations scientifiques.
Vous trouverez toutes ces communications, enrichies de nouvelles données sur les mêmes thèmes, chaque mois jusqu’au congrès de
2012 à Montpellier, dans notre revue "PostScriptum" qui assurera le partage de ces informations.
Vous pourrez consulter et télécharger la revue "PostScriptum" sur le site de l'Association du Congrès de Psychiatrie et de Neurologie
de Langue Française, que nous vous invitons d’une manière générale à consulter régulièrement…
Pr Patrick Martin
Président du Comité d'organisation du 109e congrès
Partage et remise en question

3
Post Scriptum
J. Endicott et E. Robins le deuxième article prônant
l’utilisation de critères diagnostiques pour les recherches
dans la même revue( 35, 773- 82, 1978) : Research
Diagnostic Criteria : Rationale and Reliability pour 25
catégories diagnostiques.
La troisième édition de la classification américaine a vu le
jour en 1980 , dirigée par R. Spitzer, prévoyant l’utilisation
systématique de critères diagnostiques pour l’ensemble des
catégories descriptives retenues et pour tous les types
d’utilisation, ne privilégiant aucune théorie particulière mais
choisissant constamment les critères possédant la meilleure
fidélité inter-juges, c'est-à-dire, le plus souvent, des critères
comportementaux manifestes. Par ailleurs, le DSM III
comprend aussi l’enregistrement, conjointement aux
symptômes, sur des axes distincts, des données de
personnalité et un retard mental éventuel, les affections
médicales générales concomitantes des troubles mentaux,
les problèmes psychosociaux et comportementaux ainsi que
l’évaluation globale du fonctionnement.
Le DSM III a été traduit en français et publié en 1983 sous la
direction de P. Pichot et de moi-même, avec la collaboration
de P. Boyer, J.F. Henry, A. Lisoprawsky, C.B. Pull, M.C. Pull et G.
Welsh, M. Bourgeois étant conseiller à la traduction.
Conférence du Président
Classification des troubles mentaux et nosographie psychiatrique
Julien Daniel Guelfi*
Introduction
L’intérêt pour la classification des troubles mentaux et pour
la nosographie psychiatrique s’est considérablement accru
depuis environ cinquante années.
Dans les années 1960-1970 le diagnostic psychiatrique
n’intéressait pas grand monde en dehors de quelques
auteurs aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne.
La multiplicité des modèles de référence théorique et la très
mauvaise fidélité inter-juges des diagnostics avaient en effet
entraîné une insatisfaction générale des chercheurs
cliniciens. La deuxième édition du Manuel diagnostique et
statistique des troubles mentaux
(DSM) était restée fidèle à la
tradition psycho-dynamique tout
en abandonnant quasiment le
concept de réaction cher à
A. Meyer qui avait été très central
dans la première édition du
manuel en 1952.
Les diagnostics multiples étaient
vivement encouragés dans le
DSM II.
Plusieurs auteurs de renom
avaient fait le constat d’un travail
préalable nécessaire pour pouvoir
définir ce qu’est un trouble
mental comme Joseph Zubin et
les maladies mentales comme
Samuel Guze. Une réflexion était
née qui allait s’amplifier sur les
critères qui permettraient de
mieux homogénéiser les
échantillons de patients dans les
recherches cliniques. Le US-UK
diagnostic project en est une
illustration, à l’initiative de J.
Zubin et M. Kramer du NIH aux
Etats-Unis, mais aussi de Sir Aubrey Lewis à Londres, de
Robert Kendell à Edimbourg et de Norman Sartorius à
Genève pour l’OMS.
L’article qui est venu symboliser le renouveau a été publié
en 1972 dans les Archives of General Psychiatry ( 26, 57-
63) par six auteurs : J. Feighner, E. Robins, S. Guze, R.
Woodruff, G. Winokur et R. Munoz. Il représente les travaux
de l’Ecole dite de St Louis (Missouri) et propose des critères
diagnostiques pour 14 catégories diagnostiques à des fins de
recherche. Ce mouvement a rapidement pris une
importance considérable. Six années plus tard, c’est un
psychiatre biométricien de New York qui publiera avec
Le Pr Jean Daniel Guelfi durant sa conférence

Le DSM-III a rapidement eu un retentissement mondial en
dépit de nombreuses critiques synthétisées dans le livre de
S. Kirk et S. Kutchins, Professeurs de travail social, intitulé :
The selling of DSM. The rhetoric of Science in Psychiatry en
1992, malencontreusement traduit en français par : Aimez-
vous le DSM-III ? Le triomphe de la psychiatrie américaine
(Les empêcheurs de penser en rond, Institut Synthélabo, Le
Plessis Robinson, 1998).
Les critères ont été revus et améliorés dans le DSM-III-R
publié en 1987 ( traduction française en 1989).
Par la suite, le DSM- IV, dirigé par A. Francès, a été publié en
1994 (traduit en français en 1996). Le DSM-IV TR (Text
Revised) a été publié en 2000 ( traduit en français en 2003).
Cette quatrième édition tient compte de nombreuses
études empiriques et non pas seulement des opinions
d’experts ; d’autre part elle accorde plus d’importance au
jugement clinique et à l’utilité clinique que le DSM- III.
Enfin, si l’optique médicale, catégorielle, dite néo-
kraepelinienne selon l’expression de G. Klerman, est
maintenue dans le DSM- IV, une ouverture croissante à une
perspective dimensionnelle est annoncée. .
L’Organisation Mondiale de la Santé, dans sa dixième
révision de la Classification Internationale des Maladies, la
CIM-10, a adopté le système des critères diagnostiques en
1992, du moins pour la recherche (dont la traduction
française a été coordonnée par C. Pull en 1993).
Les travaux préparatoires au DSM-V ont commencé en 2002
sous la direction de D. Kupfer de Pittsburg. Treize réunions
thématiques organisées conjointement par l’Association
Américaine de Psychiatrie et le NIH, se sont déroulées de
2004 à 2008 , avec des participants invités extérieurs, pour
faciliter la tâche de la Task Force du DSM-V ( 27 membres).
La mise en ligne sur internet des diverses propositions des
groupes de travail désignés par la Task Force en février 2010
a immédiatement donné lieu à de nombreuses critiques,
notamment de la part des responsables des versions
antérieures du manuel : R. Spitzer et A. Francès, reprochant
aux groupes de travail de faire nombre de propositions dont
l’intérêt clinique n’était pas établi et qui allaient, en tout
état de cause, conduire à une inflation des troubles mentaux
dans la population générale.
Le travail de Steeves Demazeux
Une réflexion approfondie sur le DSM par un philosophe
des Sciences a vu le jour en mars 2011 dans une thèse de
Doctorat en Philosophie de 668 pages à Paris I sous la
direction de J. Gayon.
Après un résumé de l’histoire institutionnelle de la
psychiatrie américaine et des classifications psychiatriques
aux Etats-Unis, ce jeune chercheur a développé le débat
contemporain autour de la définition d’un trouble mental et
de ses implications pour la nosologie psychiatrique.
La standardisation de la pratique a d’incontestables
avantages mais elle appauvrit inévitablement la clinique et
elle stérilise la recherche. La nosologie doit bénéficier des
apports des philosophes des Sciences avec des auteurs
anglo-saxons comme C. Boorse, T. Engelhardt, J. Wakefield
ou K. Fulford.
Plutôt que de se reposer à titre principal sur les coefficients
de concordance kappas de Cohen pour améliorer la fidélité
inter-juges des diagnostics, il est sans doute préférable de
tenir compte des jugements de valeur et non de les ignorer.
Les divergences diagnostiques ne tiennent en effet pas
uniquement à l’imprécision ou à l’ambigüité des critères
diagnostiques mais aussi à des désaccords sur les valeurs
sous-jacentes.
Au modèle médical catégoriel kraepelinien de E. Robins et S.
Guze s’oppose le modèle des construits psychologiques
auxquels sont accoutumés les spécialistes des approches
dimensionnelles, surtout dans la sphère de la personnalité et
des déviances de celle-ci, comme T. Widiger, T. Trull, R.
Cloninger ou J. Livesley.
Les principales conclusions de Steeves Demazeux peuvent
être résumées comme suit.
• La quête d’une définition univoque pour le trouble mental
est très vraisemblablement une erreur.
• Le DSM donne l’illusion que tous les troubles mentaux sont
d’une essence commune.
• L’uniformisation des pratiques et de l’enregistrement des
données appauvrit l’ontologie qui doit au contraire pouvoir
bénéficier du pluralisme ontologique.
Il est nécessaire d’accepter l’hétérogénéité de la clinique
comme il est nécessaire de reconnaître l’hétérogénéité du
champ psychiatrique (G. Lantéri-Laura). Il existe sans doute
des frontières naturelles pour délimiter certaines catégories
diagnostiques en psychiatrie mais il existe aussi des
catégories qui ont un intérêt pratique sans valeur
nosographique obligée et des dimensions psychologiques
utiles pour décrire d’autres éléments qui sont des "non-
catégories".
Comment sortir de l’impasse ?
• Il est sans doute temps d’abandonner l’idée selon laquelle
une classification unique doit être utilisée tout à la fois dans
la pratique clinique quotidienne, dans la médecine générale
et dans la recherche clinique en psychiatrie. En cela le
modèle de la CIM-10 est supérieur à celui du DSM.
• Il sera sans doute utile d’employer conjointement aux
critères du futur DSM-V attendu en mai 2013 ceux d’autres
systèmes reposant, eux, sur des hypothèses et des modèles
théoriques dont on cherche à vérifier la validité.
Cette nouvelle voie a été initiée par le National Institute of
Health aux Etats-Unis en 2009 avec des construits
théoriques intégrant les données les plus récemment
acquises dans les domaines des Neuro-Sciences, en
Génétique, Neurobiologie, Neuro-Physiologie ou en
imagerie cérébrale.
• L’adoption d’un pluralisme ontologique doit entraîner les
4Post Scriptum

chercheurs à revenir sur le plan clinique à l’approche dite
polydiagnostique défendue en Europe par des auteurs
comme P. Berner et H. Katschnig à Vienne, C. Pull à
Luxembourg ou P. Pichot à Paris.
Cette procédure permettra de confronter différents
schémas diagnostiques issus de la clinique avec des
variables biologiques,
génétiques, physiologiques
ou psycho- sociales issues de
la recherche scientifique.
Il n’est donc aucunement
question de rejeter
l’approche proposée par le
DSM mais on ne doit
attendre aucun progrès de
son utilisation isolée dans le
domaine de la nosographie
psychiatrique. Nous avons
impérativement besoin
d’utiliser ces données cliniques
conjointement à celles des
autres données scientifiques
disponibles de même qu’à
d’autres données cliniques
comme l’histoire personnelle
de tout un chacun ou des
modalités des relations inter-
personnelles établies au
cours du développement.
Pour des auteurs comme
J. Foucher et V. Bennouna
Greene par exemple,
l’utili-sation athéorique
d’une classification sympto-
matique ne peut nous
permettre de progresser dans
la compréhension des
processus pathologiques. Ils
prennent l’exemple de la
classification des psychoses de K Leonhard qui est certes
beaucoup plus complexe que celle du DSM mais qui mérite
des travaux empiriques qui auraient, peut- être, un intérêt
heuristique plus important que les recherches actuelles sur
les catégories du DSM-IV .
Dans le domaine des troubles affectifs on pourrait tenir le
même raisonnement au sujet des propositions de nouveaux
découpages nosographiques dans des directions certes
variées, par des auteurs comme G. Parker, D. Watson,
J. Angst, H. Akiskal ou F. Benazzi.
Conclusion
Pour conclure, je reprends volontiers à mon compte la
conclusion de J. Foucher et V. Bennouna Greene dans leur
Post Scriptum 5
article de 2010 : [il est nécessaire de] "séparer pour un
temps les classifications actuelles dont l’utilité descriptive
et clinique reste incontestable et des classifications de
recherche qu’il serait nécessaire de libérer d’un athéorisme
et d’une phénoménologie clinique inadaptée".
Références
DEMAZEUX S. Le lit de Procuste du DSM-III : classification
psychiatrique, standardisation clinique et anthropologie
médicale. Thèse de Doctorat de Philosophie, Université Paris
I, 668 pages
GUELFI JD. La classification américaine des troubles
mentaux : hier, aujourd’hui et demain. La lettre du
psychiatre 6, suppl 2 n°5, 4-9, 2010
FOUCHER J-R, BENNOUNA GREENE V. La CIM et le DSM ou
l’impossible validation : pourquoi le ver est dans le fruit Ann
Médico- Psychol ( Paris) 168, 609- 15, 2011.
* Professeur émérite de Paris Descartes
CMME, Service du Pr F ROUILLON,
100 rue de la Santé - 75674, Paris CX 14
Le Président Guelfi développe sa conclusion
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%