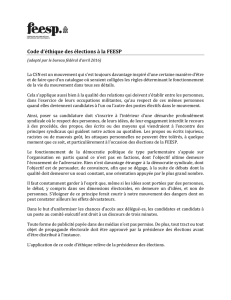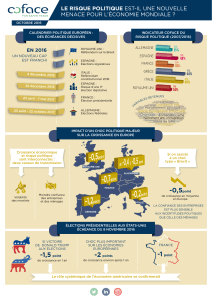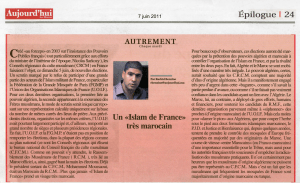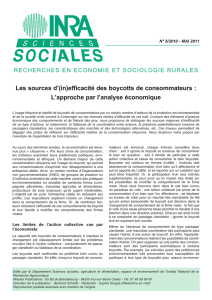Article complet

La dynamique contestataire du mouvement du 20 février à l’épreuve
des révoltes arabes.
Genèse du mouvement du 20 février :
Le Maroc comme tous les pays qui se trouvent dans « la géographie arabe » a vécu des contestations
durant l’année 2011. Certes, l’événement mené par le Mouvement du 20 février (en référence à la
date du début des contestations en 2011) a joui d’une spécificité qui n’est pas assimilée à d’autres
pays révoltés. L’espace de protestation, créé à cette occasion, a regroupé des contestataires aux
appartenances politiques différentes. Le groupe en mobilisation a investi dans l’action stratégique de
ses « entrepreneurs de cause »
1
pour nourrir à bien le répertoire de cette action, indiquant une
nouvelle forme contestataire qui n’est pas issue d’une structure particulière mais plutôt le fruit de
plusieurs interactions.
Le contexte révolutionnaire dans lequel le M20F s’est constitué- un monde arabe en effervescence- a
généré chez les jeunes activistes une véritable opportunité de contestation. Dans l’année 2010, les
acteurs des réseaux sociaux ont organisé un SIT-IN devant l’ambassade de la Tunisie brandissant des
slogans qui soutiennent le peuple tunisien
2
. Les cyber-activistes marocains
3
, bénéficiant de la culture
blogosphère, cherchaient à créer des groupes via les réseaux sociaux. Nous assistons ici à une
légitimation de cette révolte en marche. Par la suite, ces jeunes activistes vont travailler à adopter les
principes de ces soulèvements montrant « la conscience collective » qui fait que les individus
appartenant au monde arabe interagissent entre eux.
Ainsi sera créé le premier groupe sur Facebook intitulé «des marocains s’entretiennent avec le roi »
par quelques cyber-activistes originaires de la ville de Meknès. Les administrateurs du groupe ont
mentionné leur volonté d’organiser des manifestations comme l’a indiqué l’un de ses éléments « on
conteste la manière par laquelle on est gouverné » il a ajouté « au début de son règne, le
roi a vraiment exprimé sa volonté réformiste. Mais, par la suite, il ya eu une
discontinue
4
». Le 27 janvier les activistes ont renommé leur groupe « liberté et démocratie
maintenant ». Ils ont lancé un appel à manifester le 27 février dans les espaces publics. Au lendemain
un ex- militant de la jeunesse du parti de l’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) a publié sur
son mur (Facebook) « le 27 février jour de la colère marocaine ». Mais ces décisions de manifestation
seront rapidement changées pour ne pas coïncider avec les cérémonies d’anniversaire du
Polisario.une autre date sera retenue comme date de protestation. Le 20 février 2011. Cette nouvelle
opportunité produite dans le monde virtuel a incité beaucoup de militants « aguerris » à partager
leurs expériences avec de nouveaux participants « cyber-activistes » pour réanimer le débat sur le
réel politique Marocain. Ces acteurs ont profité du moment révolutionnaire pour tisser des liens de
réciprocité contre les dépassements et les violations.
1
: Une expression utilisée par Lillian Mathieu.
2
: Les premières sorties des activistes étaient considérés dans le but de dénoncer le régime tunisien et
encourager le peuple révolté.
3
: Rahma Bourqia : workin paper sur le mouvement du 20 février. Le cercle d’analyse politique, fondation
Abderahim Bouabid.
4
: Des propos recueillis de l’un des modérateurs « marocains se dialoguent avec le roi ».

Grace à cette dynamique virtuelle qui s’échappe au contrôle exercé par les autorités publiques, ce
groupe d’activistes a pu substituer les supports médiatiques officiaux et traditionnels par des
nouveaux supports empruntés au monde virtuel. Le 12 février 2011, les activistes des réseaux
sociaux ont diffusé une vidéo sur YOUTUBE tournée à l’AMDH en réponse à ceux qui les qualifient de
traitres. Par cette vidéo, les activistes veulent dépasser la question de l’identité et de la marocanité
puisqu’ils commencent par la formule « je suis marocain, je suis marocaine
5
». La diffusion de cette
vidéo a pour objectif de dénoncer la compagne de dénigrement qui les accuse de menacer les
principes fondamentaux de la nation à savoir « Dieu, la Patrie, le Roi ». Ces vidéos, considérées
comme un moyen de communiquer avec le public, exposant, à la fois, les motivations à manifester et
démontrant pourquoi les jeunes ont choisi de descendre dans la rue. Plusieurs gens ont commencé à
faire apparaitre le logos du 20 février sur leurs pages Facebook.
Le 14 janvier 2011, un communiqué mentionne les revendications du mouvement du 20 février. Il se
résume dans les points suivants :
-Une constitution démocratique votée par une assemblée constituante élue démocratiquement.
_ La dissolution du parlement, la destitution de l’actuel gouvernement et l’établissement d’un
gouvernement de transition.
_ Une séparation effective des pouvoirs, et l’appel à une justice indépendante.
_ La reconnaissances des éléments spécifiques à l’identité marocaine : linguistique, culturelle et
historiques. Par conséquent, la reconnaissance de la langue amazighe comme langue officielle à
l’instar de la langue arabe.
_ Une demande de liberté pour tous les prisonniers politiques, victimes des arrestations arbitraires,
des tortures et répressions.
_ Le jugement de tous les responsables impliqués dans des cas de corruption et de dilapidation de
richesse du pays.
_ assurer une vie digne à tous les marocains ; lutter contre la cherté de la vie ; l’augmentation des
salaires.
_ Intégration des diplômés chômeurs dans la fonction publique en organisant des concours
transparents.
5
: Cette vidéo est publiée pour affirmer la présence réelle du groupe.

À Casablanca, ce 20 février 2011, la manifestation a rassemblé une agrégation de militants,
relativement, importante. La participation tourne autour de 5000 contestataires selon les
organisateurs. Les manifestations ont commencé à 10h du matin au centre ville. D’ailleurs, ce choix
de l’usage des « centres villes » comme lieux de départ est raisonné sous la base de plusieurs
facteurs. À ce titre, le « centre ville » peut apporter des repères significatifs lesquels : le message de
manifester est adressé à tous les habitants de la ville. La programmation de SAHT LHMAM (place des
pigeons) comme lieu célèbre pour les Casablancais fait partie de cette stratégie mobilisatrice. Elle
signifie que les messages protestataires seront focalisés sur la mobilisation de tous les habitants de la
ville. Le choix de centre ville est conçu, aussi, dans le cadre d’éviter les dérapages imprévus qui
peuvent porter atteinte à l’image du mouvement qui cherche une meilleure performance pour
continuer à militer. (Un entretien avec un militant du PADS)
D’abord, l’apparition du M20F s’est présentée comme un nouveau cadre contestataire qui n’a pas
surgi d’un fait imprévu. Cette nouvelle organisation est venue pour renforcer le cadre récent de la
mobilisation déclenchée dans cette dernière décennie au Maroc. Il s’avère qu’elle vise à inventer de
nouveau une dynamique de la rue pour dénoncer la perpétuation de l’iniquité sociale responsable du
sentiment d’injustice reproduit dans le milieu des jeunes du Maroc. Plusieurs interrogés au sein du
M20F se sont contentés de considérer le Mouvement comme un prolongement historique de l’action
contestataire propagée sur le territoire marocain. De la sorte, le Mouvement du 20 février est
enraciné tel un processus confirmatif qui vise à poursuivre le cycle contestataire
6
. Les premières
manifestations de l’ère Mohamed VI sont remarquées depuis 2003. À leur tête la question sociale et
le chômage qui ont suscité des mobilisations dépassant le cadre des organisations des diplômés
chômeurs. À ce titre, on fait allusion aux manifestations de Sidi IFNI qui ont mis en cause le gel des
accords conclus entre les autorités locales et nationales pour l’ouverture des unités industrielles. Il
est observé, aussi, des manifestations remontant à septembre 2006 contre l’augmentation des tarifs
de l’eau et de l’électricité pratiquée par l’entreprise privée chargée de la gestion déléguée du réseau.
L’air contestataire n’a fait que se radicaliser en 2007 quand un SIT-IN programmé à SEFROU encadré
par l’AMDH aboutit à une confrontation avec les autorités. Toutes ces manifestations ont été
violemment réprimées par les forces de l’ordre.
En d’autres termes, le M20F s’est caractérisé par un champ multi organisationnel renfermant un bon
nombre d’acteurs politiques influencés par le contexte révolutionnaire de la région et qui envisagent
de nouvelles formes contestataires. Le caractère hétéroclite du M20F a produit un nouveau
répertoire d’action par rapport aux autres contestations précédentes. Le champ d’action du M20F
n’était pas figé, il est évolutif en raison de la nature des demandes politiques appuyées par la
présence énorme des entrepreneurs politiques. La politisation du M20F est remarquée dans les
revendications et les slogans brandis durant les manifestations organisées, De profondes réformes
ont été revendiquées demandant plus de liberté, plus de justice et plus de dignité. Le M20F a
regroupé des acteurs diversifiés issus de différentes couleurs politiques capables de mobiliser
plusieurs coordinations sur le même jour dans des dizaines de villes. Ces coordinations ont porté le
nom des communes où elles se trouvent, à titre d’exemple la coordination de Casablanca a réuni
plusieurs sections qui opèrent dans les quartiers casablancais (Sidi Momen,Sebata,Bernoussi,
Oulfa…). Sur le volet numérique, le M20F a pu rassembler un nombre considérable de contestataires
6
: Lamia Zaki : Maroc dépendance alimentaire radicalisation contestataire et répression autoritaire. Revue du
sud. Actualité des mouvements du sud.

(sur le niveau national) avec lesquels il était possible d’organiser des manifestations synchronisées à
la troisième semaine de chaque mois à l’inverse des dynamiques protestataires mobilisées
antérieurement (avant la date du 20 février)qui ont demeuré très retreintes dans le sens où leur
action contestataire n’a intériorisé que des revendications concertées de réformes de systèmes
économique et social. En plus, ces manifestations, restées sédentaires et limitées en temps et en
espace, étaient incapables de se propager sur tout le territoire.
Le Mouvement du 20 février a bénéficié, aussi, de l’aide gratifiée de ses entrepreneurs offrant de
nouvelles tendances. « Un noyau dur » (le cadre où les décisions du Mouvement sont élaborées) est
constitué. Il est représenté par ces entrepreneurs politiques issus du collectif associatif et partisan et
qui se tenaient prêts à aider le Mouvement. Ils ont créé des commissions diversifiées pour orienter
l’action stratégique du Mouvement (commissions des slogans, des médias, du suivi).
La détermination de la nature d’action contestataire menée par le M20F n’a pas cessé de se
reconfigurer suite aux événements politiques institués (La révision constitutionnelle du 1er juillet et
les élections législatives du 25 novembre 2011). Ceci nous a poussés d’aller en profondeur. Ainsi
notre réflexion sera concentrée sur la forme contestataire incarnée par le M20F :
Il s’agit, en une part, de saisir la manière par laquelle le M20F procède pour nouer des relations
d’alliances capables d’unifier les configurations politiques hétéroclites tout au long de la dynamique
protestataire.
En d’autre part, on va vérifier à quel point le M20F a pu constituer une véritable action contestataire,
bénéficiant du nouvel répertoire, sans pour autant perdre sa spécificité et se confondre avec l’action
politique normative.
_ Le mouvement du 20 février : quelle relation entre le champ
partisan et l’espace contestataire ?
Il serait réducteur de limiter l’apparition du M20F à une émanation propre du contexte
révolutionnaire, ou bien de l’appréhender sous une vision résumant, d’une manière ou d’une autre,
la dynamique faite par des jeunes blogueurs dans les réseaux sociaux, qui viennent indiquer leur
volonté et désirs de se mobiliser à l’instar d’autres jeunes révoltés dans la zone arabe. L’histoire du
Maroc a, plus ou moins, connu des événements politiques générateurs de véritables opportunités de
protestation
7
. Ce qui nous a poussés d’avancer un questionnement lequel : dans quelle perspective
et enjeu s’inscrit le nouveau mouvement de contestation ? S’inscrit-il dans la continuité des
protestations précédentes ? Ou bien serait- il caractérisé par une rupture toute faite d’un genre
nouveau de contestation que le Maroc n’a jamais connu depuis son indépendance ?
Le domaine de la lutte politique a été dynamisé par de profondes mobilisations justes après
l’indépendance. En effet, dés le début des années 1960, l’opposition composée de militants du
mouvement national qui voulaient construire un potentiel d’opposition face à un régime politique,
qui mène une stratégie de scission partant du principe « diviser pour régner ». Ainsi, les forces
nationales sont entrées en conflit avec le monarque. Dés lors, les deux protagonistes de la scène
politique en place commençaient à s’identifier comme des ennemis, nourrissant le clivage instauré.
7
: Rémy Levau : le Fellah marocain défenseur du trône.

Le système politique institué au Maroc par Hassan 2 en 1962 a, en globalité, tendu à reproduire la
politique du MAKHZEN
8
qui fait que la nature du pouvoir soit centralisée autour de la personne du
roi. Par cette mesure Hassan 2 a favorisé la sacralisation du choix gouvernemental qui vise à
désamorcer le champ politique en faveur du champ religieux
9
.
Bien que, la contestation sociale représentée par la gauche en 1965, à la manière d’une révolte
dirigée vers le régime politique, celui-ci a anticipé par la déclaration d’un état d’exception entre
(1965- 1970). En suite, les années 80 étaient marquées par des politiques d’ajustement structurel et
des révoltes urbaines (1981, 1984, 1990). Elles avaient pour cause la contestation des choix
économiques et sociaux. Le soulèvement des mouvements islamistes (cas du voisin algérien, le FIS) et
la chute du mur de Berlin avait des répercussions sur la gauche marocaine qui a accepté des
promesses de démocratisation soulignées par Hassan 2, qui avait commencé à créer des institutions
à vocation démocratiques. Le projet d’ouverture politique s’est traduit par la mise en avant d’un
conseil consultatif des droits de l’homme en 1990, qui a connu la participation de plusieurs
personnalités de l’opposition. Aboutissant, ainsi, en 1996 à l’établissement d’un gouvernement
d’« alternance consensuelle » présidé par une figure connue de l’opposition traditionnelle : M.
Abderrahmane al Youssofi de l’USFP.
L’intronisation du roi Mohamed VI (1999) a constitué une « nouvelle étape » dans l’histoire politique
contemporaine au Maroc. Le nouveau souverain a montré une « volonté » réformiste (discours du
trône, 1999) pour continuer la politique « d’ouverture » entamée par son père. D’ailleurs, le Maroc a
connu pour la première fois une organisation des élections législatives(2002,2009) et
municipales(2003,2009) jugées, plus ou moins, transparentes
10
. Aussi, la présentation d’un projet qui
vise à rendre les villes sans bidonvilles en 2004 et la promotion de l’initiative nationale pour le
développement humain en 2005 dont l’objet est de donner des fonds pour permettre aux
associations d’élaborer leurs propres projets. L’Etat a mené aussi un projet de construction et
d’équipement (des autoroutes, aménagement des ports, tramway).
En dépit des chantiers de réformes présentées, une gamme d’action contestataire est déclenchée à
travers tout le royaume avant même les contestations incitées par le mouvement du 20 février. Le
sentiment de frustration et d’abandon est exprimé, à maintes reprises, vis-à-vis du pouvoir politique.
Les débats ne cesseront pas de s’approvisionner par quelques acteurs politiques autour des règles
qui déterminent le jeu politique au Maroc. Les forces partisanes qui se réclament comme des
héritiers « lucides » du mouvement national (quelques partis de la gauche « radicales » à savoir : le
parti socialiste unifié (PSU), le parti d’avant-garde démocratique et socialiste (PADS), le conseil
national ittihadi (CNI) et le parti de la voie démocratique (VD). Ils n’ont pas cessé de socialiser leurs
militants à la lutte contre la forme politique actuelle en appelant par le biais des Sit-in et des Marches
à la réécriture de « l’histoire » politique demandant la création d’une assemblée constituante élue,
qui s’engage à préparer une constitution démocratique. Sauf que, ces phénomènes contestataires
sont restés isolés et dispersés en temps et en espace. Tant que les autres configurations politiques
8
: Makhzen : locution qui signifie un mode de fonctionnement du pouvoir politique au Maroc qui fait que des
attributions larges soient déléguées à un cercle politique réduit.
9
: Mohamed Tozy : représentation/ intercession : les enjeux du pouvoir dans « les champs politiques
désamorcés » au Maroc.
10
: Karine Bennafla et Haoues Singer, le Maroc à l’épreuve du printemps Arabe, outre terre 2011/3, N°29
pages 143à 158.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%