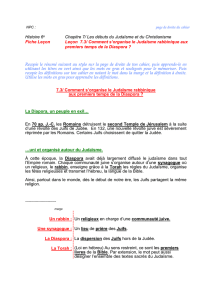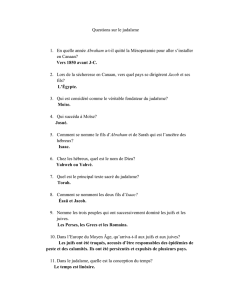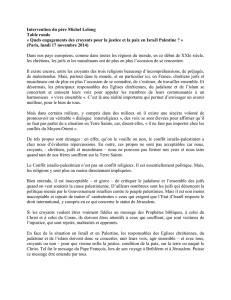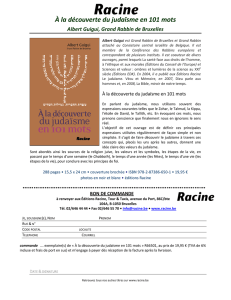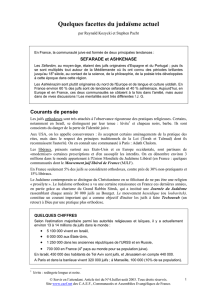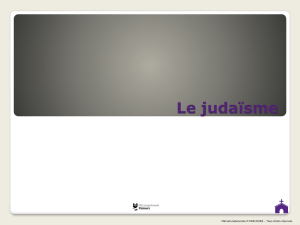les origines secrètes du bolchevisme henri heine et karl marx

L
LE
ES
S
O
OR
RI
IG
GI
IN
NE
ES
S
S
SE
EC
CR
RÈ
ÈT
TE
ES
S
D
DU
U
B
BO
OL
LC
CH
HE
EV
VI
IS
SM
ME
E
H
HE
EN
NR
RI
I
H
HE
EI
IN
NE
E
E
ET
T
K
KA
AR
RL
L
M
MA
AR
RX
X
par
SALLUSTE
(FLAVIEN BRENIER)
1929
Éditions Saint-Remi
– 2014 –

Au Duc POZZO DI BORGO
digne héritier d’un grand nom de la Contre-Révolution,
HOMMAGE D’UN DE SES COLLABORATEURS
A L’INSTITUT ANTIMARXISTE DE PARIS.
Paris. 1929.
SALLUSTE (Flavien Brenier).
Du même auteur aux éditions Saint-Remi :
LES JUIFS ET LE TALMUD, 266 p., 20 €
Il y a eu dans les civilisations antiques, comme nous l'avons rappelé au début
de cet ouvrage, des religions ayant pour but le Mal, honoré notamment sous la
forme de la Cruauté et de la Luxure. Que des satanistes peu nombreux et un
peu fous la pratiquent de nos jours, nous consentons à le croire. Mais presque
personne n’ose le croire possible des Juifs, des Juifs campés au milieu de nous.
Éditions Saint-Remi
BP 80 – 33410 CADILLAC
www.saint-remi.fr

PRÉFACE
Ce livre n’est pas né d’un dessein médité ; il n’a pas été écrit suivant un
plan conçu d’avance : il est le résultat de circonstances successives, presque
indépendantes de la volonté de l’auteur. C’est ce qui explique la forme peu
habituelle sous laquelle il est présenté au public.
Dans le courant de l’année 1927, j’eus l’occasion de faire, à l’Institut
Antimarxiste de Paris, une série de conférences sur les « Origines secrètes
du bolchevisme », sujet peu connu, même par les spécialistes de la question.
La vraie figure de Karl Marx, conspirateur génial bien plus que sociologue,
s’en dégagea avec une vigueur inattendue. On me pressa de la fixer dans une
étude définitive, au lieu de la laisser s’estomper peu à peu dans la mémoire de
mes auditeurs, comme il est arrivé pour tant d’autres sujets historiques traités
oralement par moi. J’acceptai de le faire. De là naquit une série de quatre
articles, publiés dans La Revue de Paris, du 1er juin au 15 juillet 1928,
sous le titre : Henri Heine et Karl Marx.
Ces articles n’utilisaient pas, à beaucoup près, toute la substance de mes
conférences à l’institut Antimarxiste ; embrassant, en effet, une période
beaucoup plus considérable, mon cours conduisait l’histoire du Communisme
jusqu’au temps présent. Comme on le verra plus loin, l’étude que j’en ai tirée
traite surtout de Karl Marx et de ses inspirateurs immédiats. Je ne prévoyais
pas, en l’écrivant, les orages qu’elle devait soulever d’un certain côté de l’opi-
nion, ni les répliques que je serais obligé de faire à des attaques furibondes.
Je dois rendre ici hommage à la haute impartialité du directeur de La
Revue de Paris, M. le comte de Fels, qui n’est pas seulement le sociologue le
plus remarquable de ce temps, mais aussi le plus libéral des directeurs de
revues. Son éclectisme averti lui a permis, à maintes reprises, d’ouvrir aux
théoriciens avancés des divers partis contemporains les colonnes de sa revue,
dont il a fait le lieu de rencontre de tous les grands courants d’idées qui se
disputent l’intellectualité moderne. La Revue de Paris, comme le disait
dans un récent discours M. Poincaré, « est l’image écrite de la France ».
Mon étude, sans sortir du terrain des faits, présentait des conclusions vi-
goureuses. Malgré cela, M. le comte de Fels lui accorda l’hospitalité, se bor-
nant à me demander le sacrifice de deux ou trois paragraphes qui eussent pu
heurter trop violemment des lecteurs d’opinion différente. On trouvera ces
paragraphes rétablis dans le présent volume, non qu’ils aient une importance

PRÉFACE
4
décisive pour la démonstration de ma thèse, mais parce qu’un livre de doctrine
est forcément un acte politique et social, et non, comme La Revue de Paris,
un salon ouvert aux controverses courtoises.
Je ne prévoyais d’ailleurs pas que mes articles fussent destinés à provoquer
une polémique. Les faits qui y sont énoncés sont incontestables et, pour la
plupart, connus des spécialistes. Leur groupement et les conclusions que j’en
tire constituent leur principale originalité. Aussi ma surprise fut-elle grande
quand j’appris que mon étude déchaînait un violent mécontentement dans les
milieux israélites, et que ce mécontentement trouvait son expression dans la
réplique passionnée d’un contradicteur de haute envergure, M. le rabbin
Maurice Liber, professeur à l’École rabbinique de Paris et chargé de cours à
l’École des Hautes Études.
On trouvera plus loin l’article véhément de M. le rabbin Liber, auquel
M. le comte de Fels donna l’hospitalité de La Revue de Paris, avec la
même impartialité qui l’avait fait m’en ouvrir les pages à moi-même. Je ne
commenterai pas ici cet article, puisque je lui ai consacré une réponse détaillée,
que mes lecteurs trouveront à la fin du présent volume.
Mais il est, en marge du débat, certaines considérations qui ont leur place
dans cette préface.
La première est qu’il est peu de phénomènes aussi ignorés de nos contem-
porains que l’aspect nouveau pris par la vieille question juive aspect nouveau
qui date de cent cinquante ans déjà, si l’on remonte aux origines de l’évolu-
tion, et, d’une manière définitive, du début du vingtième siècle. Quand ils
s’occupent de cette question, les non juifs de France et d’Europe la considèrent
encore comme à la fois ethnique et religieuse, ce qui fut vrai dans le passé ; ils
ne se doutent point que le facteur religieux est aujourd’hui aboli presque entiè-
rement : il n’y a plus de religion juive.
Il n’y a plus de religion juive parce qu’Israël a subi bien plus rapidement,
et d’une manière bien plus complète que les peuples chrétiens, l’influence du
courant philosophico-matérialiste du dix-huitième siècle. Ce courant, comme
on le verra par ma réplique au rabbin Liber, correspondait aux affinités
lointaines de la race juive, à ses origines politiques et intellectuelles. La propa-
gande des Maskilim du dix-huitième siècle, au sein des communautés juives,
continuée par Léopold Zunz et ses amis au dix-neuvième, n’a pas eu grand
mal à réveiller le vieux fond endormi du matérialisme sémitique. Au con-
traire de ce qui se passait dans le monde chrétien, les autorités religieuses

PRÉFACE
5
juives et les écoles rabbiniques ont fait peu de résistance à cette évolution ; bien
souvent, elles en ont pris la tête.
Et les conséquences ont suivi. Israël a renoncé d’abord à sa croyance au
Messie à venir, qui avait fait la mélancolique grandeur de ce peuple depuis la
dispersion. Depuis une trentaine d’années, il a renoncé à Jéhovah lui-même, le
Dieu personnel de la Bible et du Talmud. En échange de ces deux abjura-
tions, l’école philosophique matérialiste, qui a imposé sa direction à la presque
totalité de la nation juive, lui a donné une foi nouvelle la croyance en un Mes-
sie impersonnel, non incarné, s’identifiant avec Israël lui-même, appelé à
triompher politiquement et socialement de toutes les nations et à se les soumet-
tre toutes – quelque chose comme ce Génie de Rome qu’adoraient les Ro-
mains des derniers temps de l’Empire.
Comment cette foi nouvelle, à laquelle j’ai donné le nom de Néo-
Messianisme, a eu pour premier effet de générer le Communisme révolution-
naire de Karl Marx, c’est ce que l’on verra dans mon livre. Mon dessein
n’allait pas au delà d’expliquer les origines d’un phénomène social qui épou-
vante actuellement le monde. L’agression inattendue de M. le rabbin Liber
m’a forcé à élargir cette donnée primitive.
Je comprends fort bien que les autorités rabbiniques de notre temps voient
avec malaise des non juifs s’occuper d’une évolution doctrinale généralement
inconnue en dehors des synagogues. Les anciens docteurs de la Loi (qui ne
sont plus guère, depuis qu’ils ont renoncé à la foi au Messie à venir, que les
chefs politiques de la nation juive) ont tout à perdre à la divulgation de cette
abjuration collective. Du jour où les peuples sauront qu’il n’y a plus en Israël
de religion véritable, mais seulement l’attente mystique d’une conquête sociale
et politique de l’univers par les Juifs, il est probable qu’ils n’envisageront plus
la question juive avec l’indifférence à la mode aujourd’hui. Peu importe à nos
contemporains qu’un homme prie Dieu à sa manière ; mais il leur importe
très fort que cet homme se croie Dieu lui-même et prétende, à ce titre, les ré-
duire en esclavage et régner dans leur maison.
L’inquiétude des milieux intellectuels israélites, quand parut mon étude,
n’avait donc rien que de naturel. Il est fâcheux qu’elle ait pris la forme d’at-
taques violentes et désordonnées, qui m’ont forcé à insister davantage et à
placer sous les yeux du public les pièces du procès. M. le rabbin Liber, et
ceux de ses éminents compatriotes (on ne peut plus guère dire proprement
« coreligionnaires ») qui se sont associés à lui, auraient mieux fait d’avoir
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%