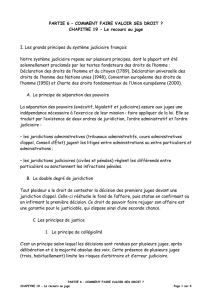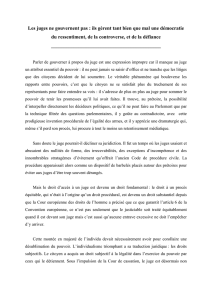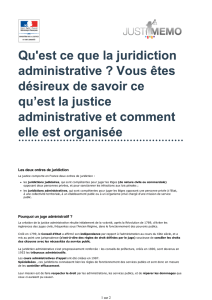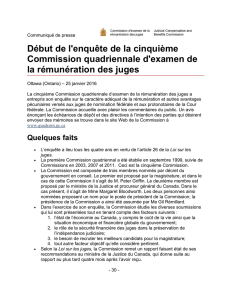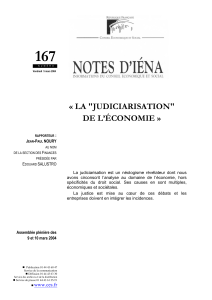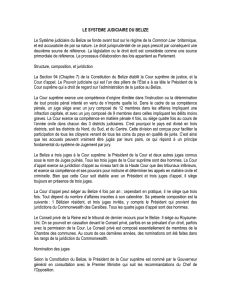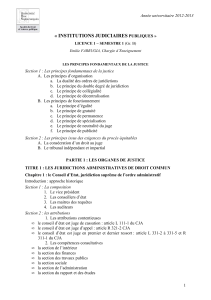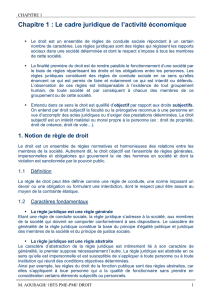LA JUSTICE EN INDE

1
LA JUSTICE EN INDE
David Annoussamy, juge honoraire en Inde
I. LA FIGURE SYMBOLIQUE DU JUGE
En Inde, la justice jouit traditionnellement d’un grand prestige. Le juge est
considéré comme le représentant de Dieu sur terre. On exige de lui une justice infaillible.
Les mythes cultivent la soif d’une justice absolue. Une injustice est ressentie comme un
grand mal social. Les textes prévoient aussi, en cas d’injustice, des punitions sévères
pour le juge, y compris le châtiment corporel. « Partout où la justice est détruite par
l’iniquité, la vérité par la fausseté sous les yeux des juges, ceux-ci sont également
détruits », peut-on lire dans les « Lois de Manou »
1
.
Une abondante littérature tant sanscrite que tamoule donne le portrait du juge tel qu’on
le concevait dans l’Inde ancienne. C’est d’abord celui qui découvre toujours la vérité. On
en a un exemple dans les contes du juge Mariadi Ramane, bien connus dans le pays
tamoul. Ce personnage légendaire possède une perspicacité, un don de divination
extraordinaire qui lui permet de déceler la vérité la mieux dissimulée. La contenance, un
détail dans les paroles, l’intonation, une hésitation, un silence, la moindre contradiction
le mettent sur la voie. Il a plus d’une astuce dans son sac pour faire éclater la vérité ainsi
devinée, démasquer le parjure et le contraindre à baisser la tête.
Un autre exemple de justice parfaite est celui du roi juge qui modifie la loi pour les
besoins de la justice. On le rencontre dans le Roman de l’Anneau (en langue tamoule). Un
brahmane très versé dans les écritures a gagné dans une ville voisine des présents d’une
grande valeur pour ses prestations. Au retour il s’arrête dans un village pour se reposer
sous un arbre. Il aperçoit des enfants brahmanes en train de jouer, il les rassemble et
leur promet une petite récompense à qui répétera le mieux avec lui quelques distiques
des textes sacrés. L’un d’entre eux a été tellement brillant qu’il lui a donné tout son
trésor.
1
Les "Lois de Manou" ou "Code de Manou" sont un ensemble de prescriptions juridiques et de préceptes
régissant la conduite civile et religieuse de l’homme, écrit autour du 12e siècle avant JC par Manou, grand
sage de l’Inde védique et premier législateur de l’humanité.

2
La famille de ce garçon ayant donné des signes d’opulence dans sa manière de vivre, les
fonctionnaires du coin en conçoivent de la jalousie et font emprisonner le père,
l’accusant d’avoir gardé pour lui un trésor qu’il a trouvé, au lieu de le déclarer au roi
comme l’exige la loi. Sanglots et lamentations de la part de l’épouse absolument fidèle.
La force de sa vertu produit son effet : la porte principale du temple refuse de s’ouvrir.
Le roi, pressentant qu’une injustice a été perpétrée à son insu dans son royaume, fait
procéder à une enquête. Les fonctionnaires affectés à cette tâche lui présentent l’homme
injustement incarcéré et exposent au roi les faits. Le roi reconnait le tort commis en son
nom, fait immédiatement libérer l’innocent, le comble de présents, se prosterne devant
lui et devant son épouse au pouvoir si puissant. Il ne s’arrête pas là, il fait proclamer par
un héraut à dos d’éléphant une nouvelle loi : « Dorénavant les biens trouvés
appartiendront à ceux qui les auront trouvés au même titre que les biens reçus des tiers
et les biens acquis au prix d’un effort personnel ». Ainsi le souverain, constatant que la
loi mène à l’injustice, améliore la loi. Juger n’est pas seulement appliquer
scrupuleusement les règles juridiques établies, c’est aussi modifier les règles ainsi que
l’exige la justice.
On pourrait multiplier les exemples. On se contentera de la légende de Manou Nidi
Sojane, où la justice atteint son point ultime. On la trouve dans la littérature tamoule
avant le début de l’ère chrétienne. Elle a été reprise plusieurs fois. Voici, en résumé, la
légende telle qu’elle apparaît dans un poème du Moyen Age.
La justice régnait dans le royaume de Manou Nidi Sojane. Les gens s’appliquaient à ne
faire du mal à aucun être vivant. La cloche qui se trouvait à l’entrée du palais, invitant
toute personne lésée à se plaindre au roi, n’avait pas été tirée une seule fois depuis qu’il
était monté sur le trône. C’était un véritable état de grâce collectif. Alors la déesse de la
justice veut mettre le roi à l’épreuve. Elle prend la forme d’un jeune veau, se jette sous
les roues du char du dauphin et meurt. La vache va droit tirer la cloche d’alarme, le roi
sort, bouleversé. La vache réclame justice pour le meurtre de son petit, ses sanglots font
frémir.
Le jeune prince est le fils unique du roi, il a seize ans accomplis et se destine à prendre
ses fonctions de prince héritier. Il est connu pour sa piété, son caractère élevé, son
respect pour la loi, sa grande compassion pour tous les êtres. Quand le roi est au courant
des faits, il réfléchit et décide que son fils qu’il adore doit périr. Les larmes de la reine
demeurent impuissantes. Les ministres s’efforcent de sauver la vie du prince. Ils
rappellent que la peine de mort n’est applicable qu’en cas de meurtre d’un être humain
et non d’un animal. Ils suggèrent la possibilité de la peine alternative de la pénitence de
vingt ans.
Le roi n’a guère de mal à repousser leurs arguments. La pensée du roi n’est pas tournée
vers la punition. Son tourment est de ne pouvoir offrir une réparation adéquate à la
vache aux larmes intarissables. Il se sent fautif de ne pouvoir la satisfaire. Pour obtenir
l’absolution de sa faute, il lui faut une punition pour lui-même. La plus adéquate à ses

3
yeux, c’est de souffrir les mêmes affres en perdant son fils unique. En d’autres termes, la
préoccupation de compensation prédomine. La peine à infliger au coupable ne retient
pas son attention. Il renverse l’ordre habituel du procès criminel. Ne pouvant pas
restituer le veau à sa mère, il mérite une punition à double titre : celui du père du
coupable et celui du roi protecteur de tous les êtres du royaume. Il serait déplacé
d’exercer la clémence envers lui même. Il n’y a pas lieu de délibérer sur la punition du
coupable pour laquelle il y aurait des atténuations possibles du moment que la punition
que s’inflige le roi fait disparaître le coupable.
C’est à l’issue de la plaidoirie infructueuse des ministres que commence l’interrogatoire
de l’accusé lequel vient plaider pleinement coupable, exprimer son regret pour avoir
terni le règne impeccable de son père. Le roi détourne les yeux. La sentence est
prononcée : le coupable doit mourir de la même façon que le veau, écrasé au même
endroit par le même char.
L’exécution de cette sentence terrible est dévolue à un ministre de confiance. Celui-ci ne
pouvant décliner la mission, il tombe près du veau écrasé, prie et rend l’âme. L’agonie du
roi augmente. Il se reconnaît coupable aussi de la mort du ministre, il se résout à
exécuter lui-même la redoutable sentence et à mourir ensuite pour le choc mortel causé
à son ministre. L’effroi et la désolation sont à leur paroxysme. La foule retient son
souffle en implorant Dieu de protéger l’enfant. Seul le jeune prince attend avec sérénité
l’exécution de la sentence juste du roi. Les roues passent, le veau est vengé, les péchés
sont expiés. A la surprise générale, Dieu fait alors une brève apparition, libératrice de
cette atmosphère étouffante de larmes et de lamentations. Le veau, le ministre puis le
prince reviennent à la vie.
Le merveilleux encadre l’histoire, on le trouve au début dans l’apparition divine sous
forme de veau et on le retrouve à la fin dans l’apparition divine sous son vrai jour, mais
l’action tout entière pivote sur la rigueur du roi dévoré par la justice. La conscience de
celui-ci est en effet saisie de tourments extraordinaires par le spectacle de la mère de la
victime qui demande réparation. La réparation parfaite exige que l’on redonne la vie au
veau mort. Mais il y a des phénomènes de la nature qui sont irréversibles et qui
assignent des limites à la justice. Incapable de jouer son rôle, le roi se punit. Alors cette
justice parfaite, impossible, s’accomplit par miracle. C’est un avertissement contre
l’inefficacité dans laquelle la justice risque de s’enliser sous le prétexte d’éviter les
écueils. C’est une invitation à souffrir en soi la présence d’un peu de cette « substance
caustique » qu’est la justice absolue pour que la justice quotidienne reste tournée vers la
voie de son accomplissement.
Cette légende continue à habiter les esprits. Quand la Cour supérieure de Madras a
célébré son centenaire, il y a quelques années, une représentation sculpturale d’une
séquence de la légende a été érigée dans l’enceinte de la Cour. D’après la conception
indienne tout procès indique une perturbation sociale qui affecte l’ordre de l’univers lui-
même. Au juge incombe l’obligation de restaurer l’ordre. On désigne le roi par son

4
insigne, le sceptre, dont la propriété est d’être droit, de ne pas pencher d’un côté ou de
l’autre, de ne pas plier sous les influences extérieures. Une injustice commise par le juge
peut non seulement entraîner des malheurs pour le pays, elle peut se retourner contre
lui-même.
La justice ne pouvait être rendue par le roi lui-même que dans les petits royaumes.
Ailleurs la tâche était confiée à des juges qui agissaient par délégation. Pour remplir ce
rôle divin ils devaient posséder toutes les qualités requises. Leur énumération varie
légèrement selon le temps et les lieux. Les qualités les plus communément citées exigent
du juge d’être de bonne naissance, instruit, de bonne conduite, animé par le culte de la
vérité, intègre, impartial, exempt de jalousie, sans désir ardent.
II. L’ORGANISATION ACTUELLE DE L’APPAREIL JUDICIAIRE
A. Les juridictions de droit commun
1. Les juridictions subordonnées
La hiérarchie moderne héritée des Britanniques se caractérise par la distinction des
juridictions en deux classes, l’une subordonnée à l’autre. Comme leur nom l’indique, les
juridictions subordonnées sont soumises au contrôle et à l’inspection des juridictions
supérieures. Les juridictions subordonnées sont de trois niveaux.
a) En bas de l’échelle, il y a des cours séparées pour les affaires civiles (de moindre
importance) et les affaires pénales (simple police et affaires correctionnelles). Il est
également possible de confier les affaires pénales ne comportant pas de peine
d’emprisonnement à des magistrats bénévoles choisis parmi les citoyens notables.
b) Au deuxième degré, il y a les cours civiles de pleine juridiction. Elles connaissent
également des affaires criminelles autres que celles relatives au meurtre. Elles décident
en appel des affaires jugées par les tribunaux du premier degré.
c) Au troisième degré, il y a les cours de district qui ont compétence pour les affaires
criminelles graves. Elles jugent en appel les affaires relevant des tribunaux du deuxième
degré. Cependant pour les appels civils leur compétence est limitée aux affaires
inférieures à une certaine somme. Elles connaissent sur pourvoi les affaires de la
compétence des juges du premier degré, soit directement les affaires non soumises à
appel, soit après décision en appel par les tribunaux du deuxième degré.
2. Les juridictions supérieures
Les juridictions supérieures sont les Cours supérieures de chaque Etat et la Cour
suprême. Les Cours supérieures jugent en appel les affaires jugées en première instance
par les tribunaux de district et celles jugées en première instance par les tribunaux du
deuxième degré non sujettes à appel devant les tribunaux de district. Elles jugent sur

5
pourvoi toutes les décisions des cours inférieures qui sont portées devant elles et pour
lesquelles l’appel n’est pas possible. Elles peuvent même s’en saisir d’office si elles
s’aperçoivent qu’une illégalité grave a été commise.
Mais la partie importante du travail de ces cours consiste à traiter les requêtes qui leur
sont directement présentées pour atteinte aux libertés fondamentales ou pour illégalité
d’une décision d’une institution publique. Les avocats ont une préférence marquée pour
cette pratique, car leur travail est plus aisé et les honoraires plus élevés. Des affaires
complexes et délicates sont ainsi traitées selon une procédure sommaire.
Alors que les cours subordonnées sont toujours à juge unique, les Cours supérieures
peuvent avoir des formations de deux, trois ou cinq juges. La chambre de deux juges
traite directement certaines affaires complexes qui lui sont renvoyées par le juge unique
et en appel les affaires traitées par un juge unique de en première instance. Elle juge les
appels en matière de meurtre et les appels civils importants à l’encontre des jugements
des juridictions subordonnées. La chambre de trois juges intervient quand il y a conflit
de décisions entre deux chambres de deux juges.
La Cour suprême juge en appel les affaires traitées par les Cours supérieures, dans les
cas prévus spécifiquement par la Constitution ou sur permission spéciale de la Cour. Elle
est compétente pour connaître en première instance des affaires délicates et
retentissantes de violation des droits fondamentaux.
Devant la Cour suprême comme devant les Cours supérieures les affaires sont enrôlées
seulement après avoir entendu le requérant en audience publique. Il arrive que des
affaires soient rejetées au seuil de la procédure sans inviter la partie adverse à se
présenter. Cela se produit davantage devant la Cour suprême. Sa chambre des requêtes
se compose de deux juges ; la chambre normale est de trois juges ; la chambre
constitutionnelle comprend cinq juges. Quand il apparaît nécessaire de réformer la
jurisprudence existante sur un point de droit, la chambre comprend deux juges de plus
que la chambre dont il s’agit de modifier la décision. On a ainsi vu des chambres
composées de treize juges.
3. L’assistance judiciaire
La présentation du système judiciaire indien serait incomplète sans quelques mots sur
l’assistance judiciaire. La révision du code de procédure criminelle de 1973 rend
obligatoire l'assistance d'un avocat pour une personne accusée devant la cour criminelle
et ouvre la possibilité d'une telle assistance devant les tribunaux correctionnels. La loi du
29 octobre 1994 entrée en vigueur en 1997 avec son escorte de décrets d'application
régit l’assistance judiciaire en matière civile.
L'assistance judiciaire comprend les honoraires des avocats en plus des timbres
d'instance. Les deux sont avancés par le bureau d'assistance judiciaire s'il est
satisfait du bien fondé de la cause et de la pauvreté de la partie qui sollicite
l'assistance. Cette dernière condition n’est plus vraiment exigée. D’abord la majorité de
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
1
/
36
100%