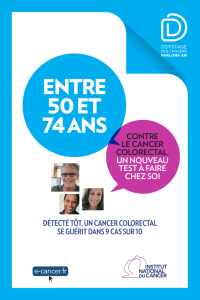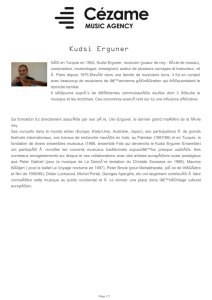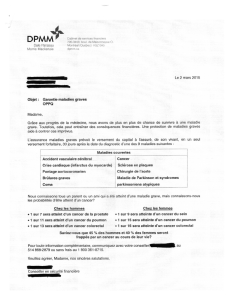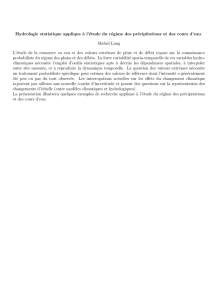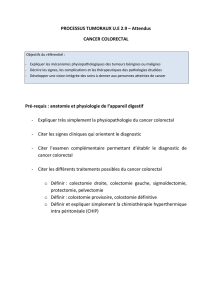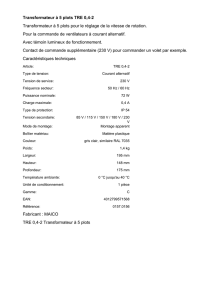La recherche clinique en cancérologie digestive

La recherche clinique en cance´ rologie digestive :
de la cible a`lave´ ritable personnalisation du traitement ?
J.-P. Metges
1,2,6
,A.Volant
3,6
,F.Grude´
2
,O.Pradier
1
,C.Riche
2,4
,E.Gamelin
2,5
,L.Corcos
6
1
Institut de cance´ rologie et d’he´ matologie, Inserm U613, baˆ timent III, CHU Morvan, 5, avenue Foch,
F-29200 Brest, France
2
OMIT Bretagne-Pays-de-la-Loire, 2, rue Moll, F-49933 Angers cedex 09, France
3
De´ partement de pathologie, CHU de la Cavale-Blanche, F-29609 Brest, France
4
Service de pharmacologie, CHU de Brest, F-29609 Brest, France
5
Laboratoire d’oncopharmacologie et de pharmacoge´ne´ tique, CRLCC Paul-Papin, 2, rue Moll, F-49933 Angers
cedex 09, France
6
Inserm U613, universite´ de Bretagne occidentale, F-29238 Brest cedex 03, France
Correspondance : jean-philippe.metges@chu-brest.fr
Rec¸ u le 14 avril 2009 ; accepte´ le 18 mai 2009
Clinical research in
gastrointestinal cancer: from
target to customized treatment?
Abstract: From the strategic use of
biology in clinical practice to new
diagnostic tools, from the new
targeted therapies associated with
chemotherapy with controlled side
effects, to increasingly accurate
radiotherapy associated with in-
creasingly optimised surgery,
research in digestive oncology has
clearly become multidisciplinary.
The challenge now is to develop
all these improvements at the same
time and with a critical eye, and try
to extend the recognized progress
made in colorectal metastatic can-
cer to other digestive localisations
whose prognoses are much less
positive. In this respect, prevention,
optimisation of treatment using
predictive factors, management of
elderly patients with digestive can-
cer, and economic optimisation of
treatment are some of the challen-
ges we must take up in the next
few years if we are to obtain the
main objective: truly personalised
medicine.
Keywords: Clinical research –
Digestive oncology – Personalized
medicine
Re´sume´:De la biologie devenue
strate´ gique en clinique aux nou-
veaux outils d’e´ valuation diagnos-
tique, des nouvelles the´ rapeutiques
cible´ es couple´esa`unechimiothe´ra-
pie aux effets secondaires controˆle´s
a` la radiothe´ rapie toujours plus
pre´ cise associe´e a` une chirurgie de
plus en plus optimise´ e, la recherche
clinique en cance´ rologie digestive
est devenue clairement multidisci-
plinaire. Son challenge va eˆtre de
de´ velopper ces avance´ es ensemble
et avec un souci d’e´ valuation cons-
tant, d’essayer d’e´ tendre les progre`s
connus dans le cancer colorectal
me´ tastatique aux autres localisa-
tions digestives au pronostic beau-
coup plus de´ favorable. Dans ce
cadre, la pre´ vention et l’optimisa-
tion des traitements par l’aide
de facteurs pre´dictifs, le de´ veloppe-
ment de l’oncoge´ riatrie et la dimen-
sion me´dicoe´ conomique seront
parmi les grands challenges a`rele-
ver ensemble.
Mots cle´s : Recherche clinique –
Oncologie digestive – Me´decine
personnalise´e
Introduction
La recherche clinique en cance´rolo-
gie sera multidisciplinaire ou ne le
sera pas. Tel pourrait eˆ tre le pre´-
ambule a` toute discussion sur ce
sujet. Dans les faits, cette consta-
tation doit couler de source et
est adaptable a`l’ensembledela
recherche clinique en me´ decine.
L’e´ laboration des protocoles
d’essais, de`s les phases pre´liminai-
res d’e´ criture, doit impliquer des
praticiens de diffe´ rentes disciplines
et des pharmaciens prenant en
charge les patients d’oncologie
digestive. Les protocoles e´ tant de
plus en plus des associations me´di-
cochirurgicales, outre les chirur-
giens, les oncologues me´ dicaux,
les radiothe´ rapeutes, les spe´ cialis-
tes d’organes (he´ patogastroente´ro-
logues dans le cas qui nous
inte´ resse), vont re´ unir, bien suˆr, les
biologistes et les pathologistes. En
effet, actuellement, la part biolo-
gique devient primordiale soit par
la valeur pre´ dictive de tel ou tel
marqueur, soit par la ne´ cessite´
d’e´laborer des e´ tudes translation-
nelles, permettant la mise en e´vi-
dence d’autres potentiellement plus
pre´ dictifs encore que ceux recon-
nus. De plus en plus, cette part
biologique pourrait devenir primor-
diale pour e´valuer la re´ ponse aux
nouvelles the´ rapeutiques en lieu et
place des crite` res RECIST [26]. En
effet, pendant longtemps, les pro-
fessionnels de sante´ ont lu les
re´ sultats de se´ ries cliniques testant
tel ou tel protocole de chimiothe´ra-
pie, de radiothe´rapie ou de chirur-
gie ou associant tout ou partie de
ces traitements avec, pour Graal, le
taux de re´ ponse. Son e´volution
ultime a paru eˆ tre les fameux
crite` res RECIST [26]. Le scanner et
les mensurations de la ou des cibles
Re´ flexions sur la recherche clinique en France
Oncologie (2009) 11: 1–7
©Springer 2009
DOI 10.1007/s10269-009-1079-4
SYNTHE
0
SE / REVIEW ARTICLE
1

tumorales de´ finies par le ou les
investigateurs permettaient de de´fi-
nir un taux de re´ ponse objective et
de comparer tel ou tel traitement et
son efficacite´ faisant ou de´ faisant
les AMM. L’autre pan de l’e´valua-
tion e´ tait, en dehors des effets
secondaires, la survie sans progres-
sion ou sans re´ cidive et la survie
globale. Plus re´ cemment, le patient
et son ve´ cu (douleur i.e.) ont e´te´
plus pris en compte graˆ ce, entre
autres, a`l’e´ valuation de la qualite´
de vie dont les e´ chelles d’e´ valuation
sont de plus en plus performantes,
dans la plupart des essais [23].
Passe´
Notre propos n’est, bien suˆr,pasde
nous e´ tendre sur le passe´ , mais
d’envisager plutoˆ t les pistes qui
vont eˆ tre prises dans les mois a`
venir pour optimiser la recherche
clinique en cance´ rologie digestive.
Pour autant, l’oncologie digestive
est probablement un des secteurs
de l’oncologie qui a connu les pro-
gre` s les plus palpables. Depuis
15 ans, les me´ dianes de survie des
patients porteurs de cancers colo-
rectaux y compris me´ tastatiques
(CCRM) se sont clairement ame´lio-
re´ es. Pour les patients, du seul 5-FU
et du choix entre ses diffe´rents
sche´ mas d’administration y compris
oral, la pharmacope´ e a vu apparaıˆtre
l’oxaliplatine et le Campto
®
[10,13].
La meilleure connaissance des pro-
duits et de leurs effets secondaires,
voire des effets de l’association de
me´ dicaments, a permis de mettre en
e´ vidence des incompatibilite´ s (ex. :
FOLFUGEM et cancer du pancre´as)
[21]. Chacun de ces deux produits,
utilise´ seul, ne donne que tre`s peu
d’alope´ cie, leur association en
donne plus de 97 % [21]. Les me´dia-
nes de survie ont peu a` peu aug-
mente´ pour le CCRM. Cette
multiplication des options a peu a`
peu conduit a`l’e´ laboration de phase
III. Du seul concept de survie globale,
l’e´ valuation s’est de plus en plus
inte´resse´e a` la survie sans progres-
sion. Ce changement e´ tait soutenu
par le fait qu’un pourcentage sou-
vent diffe´ rent de patients entre les
deux bras d’un essai be´ne´ ficiait de
lignes the´ rapeutiques ulte´ rieures
pouvant expliquer les diffe´rences
de survie globale. La suite logique
de l’arrive´edeme´ dicaments dans le
CCRM a e´te´ l’e´laboration d’e´tudes
de strate´ gie. Dans le domaine de
l’oncologie digestive, l’e´ tude rappor-
te´ e en 2004 par Tournigand et al. est
probablement un tournant impor-
tant [28]. La comparaison est faite
non pas entre le FOLFIRI et le
FOLFOX, mais bien pour de´finir
quelle est la meilleure succession
de traitement (FOLFIRI puis FOLFOX
vs FOLFOX puis FOLFIRI). L’e´ tude
coordonne´ e par Ducreux et pre´sen-
te´e a` l’ASCO 2007 par Bouche´etal.
dans la meˆ me indication jette un
pave´ dans la mare en montrant
clairement que pour des patients
porteurs de me´tastases a` coup suˆr
inope´ rables, il n’y a pas lieu de
commencer par une bithe´rapie, la
survie sans progression des deux
premie`res lignese´ tant comparables
dans les deux groupes de patients
[5]. Cette e´ tude est a` rapprocher de
l’e´ tude FOCUS qui arrive aux
meˆ mes types de conclusion [24].
L’e´ tude de Tournigand et al. est
conduite, en Europe, quasiment au
moment meˆmeou` de l’autre coˆte´de
l’Atlantique, nos colle`gues ame´ri-
cains qui n’ont pas d’oxaliplatine a`
leur disposition refont une e´tude de
phase III US pour comparer le
FOLFOX a` l’IFL (sorte de FOLFIRI en
plus toxique) a` un IROX. Cette e´ tude
positive permettra l’obtention de
l’AMM pour l’oxaliplatine aux E
´tats-
Unis avec quatre ans de « retard »
sur l’Europe. Pour autant, si le CCRM
voit son pronostic s’ame´ liorer, les
autres localisations paˆ tissent d’une
re´ putation de tre` s mauvais pronostic
(ex. : œsophage, estomac et bien suˆr
pancre´ as). Ainsi, l’AMM de la gem-
citabine a e´te´ obtenue non sur une
nette ame´ lioration de la re´ponse
objective ou sur de la survie mais
sur la comparaison d’un score de
bien-eˆ tre comprenant, entre autres,
un moindre recours aux morphini-
ques, une reprise du poids [6].
Pre´ sent : l’arrive´e des
the´ rapies cible´es et des
questions qu’elles induisent !
Les anne´ es 2000 ont e´te´marque´es
par l’entre´ e tonitruante des the´ra-
pies cible´ es et des questions qu’elles
ne manquent pas de nous poser.
L’imatinib (Glivec
®
)premie`re
the´ rapie hypercible´ e est l’exemple
parfait. Son utilisation dans les
tumeurs stromales digestives
me´ tastatiques nous a appris a`
regarder d’une autre fac¸on les
scanners. Si nous avions repris
uniquement les crite` res RECIST,
l’effet du me´ dicament aurait e´te´
juge´ quasi nul. Les tumeurs parais-
saient augmenter en taille, alors
que seule de la ne´ crose et quelques
cellules viables pouvaient eˆtre
retrouve´ es au sein d’une masse
qui a pu paraıˆtre augmente´e de
taille ou eˆ tre seulement stabilise´e.
D’autres marqueurs de re´ponse
deviennent ainsi obligatoires. Cette
recherche de facteurs pre´dictifs ou
d’outils perfectionne´ s d’e´ valuation
est un champ tout trouve´etextreˆ-
mement strate´ gique pour une prise
en charge optimise´ e. L’imagerie
fonctionnelle a, la` , un roˆle tout a`
fait strate´gique a` jouer tant pour
e´ tablir le diagnostic que le stade de
lamaladieetlare´ ponse aux traite-
ments innovants. Mais, elle pourrait
aussi participer a` l’exploration de
nouvelles cibles the´ rapeutiques.
Ainsi, en France, Cosgrove et Las-
sau ont de´ montre´ que l’e´chogra-
phie avec doppler couple´ e pouvait
avantageusement remplacer le
scanner (par exemple, dans les
GIST) [9]. Tranquart et al. ont e´tudie´
l’IRM fonctionnelle et son apport
dans l’e´ valuation des anti-angioge´-
niques et, de fac¸on plus ge´ne´rale,
l’imagerie fonctionnelle [29]. Un
STIC coordonne´parlameˆme
e´ quipe portant sur l’inte´reˆt de
l’e´ chographie doppler couple´dans
la meˆ me indication pour les me´tas-
tases he´ patiques est en cours.
Cette optimisation de l’e´valua-
tion inte´ resse aussi les nouvelles
techniques d’endoscopie tant sur le
diagnostic (endoscope loupe,
confocale) que sur la the´rapeutique
(arrive´ e de la technique de radio-
fre´ quence perendoscopique pour
les cancers superficiels de l’œso-
phage) [7].
La recherche de marqueur
pre´ dictif va devenir encore plus
strate´ gique et a tout naturelle-
ment inte´gre´ la biologie. Ainsi, la
ONCOLOGIE
2

re´ alisation d’e´ tude de profil ge´ne´-
tique a permis de mettre en e´vi-
dence l’importance de codon
discriminant pour la prescription
de l’imatinib (codon 11 versus 9).
Pour autant, tous ces marqueurs
biologiques ont e´te´valide´ s quasi
syste´ matiquement de fac¸on re´ tro-
spective. Mais, en paralle`le de
l’e´ tude clinique, la conservation de
mate´ riel tumoral et/ou de pre´le`ve-
ments sanguins s’est peu a`peu
impose´ e. Elle permettait de ve´rifier
le ve´ ritable impact d’un marqueur
de´ja` connu mais aussi, la science
avanc¸ ant, d’un marqueur inconnu
au moment de l’e´ laboration de
l’e´ tude.
Rapidement apre` s l’arrive´e de
l’imatinib, le bevacizumab, qui a e´te´
la premie`rethe´ rapie cible´ea` obtenir
l’AMM en premie` re ligne dans le
cancer du coˆlonme´ tastatique, reste,
pour l’instant, le contre-exemple en
termes de facteurs pre´ dictifs, mais
paraıˆt confirmer dans les cohortes
publie´essoninte´reˆ t [16,22,27]. Ainsi,
ni le VEGF sous toute forme, ni le
Kras ou autre n’est un facteur pre´-
dictif de re´ ponse pour optimiser
l’utilisation du bevacizumab. Seule
a` ce jour, l’hypertension induite
paraıˆt un facteur pronostique positif
prouve´ , mais n’est pas vraiment un
facteur tumoral [16]. Il ne semble pas
exister de marqueurs de re´sistance
non plus. Pour autant, en 2008, en
cance´ rologie colorectale, c’e´tait
l’anne´ e du Kras [1,2,4,12,19,20,30].
Dans un premier temps, des
e´ tudes he´te´ roge` nes, regroupant
des patients traite´ s par cetuximab ±
chimiothe´ rapie, cetuximab, voire
meˆ me panitumumab en dixie`me
ligne de traitement pour cancer
colorectal multime´ tastatique, ont
e´te´e
´labore´ es dont celle de Lie`vre et
al. [20]. Plusieurs biais me´ thodologi-
ques apparaissaient. Le premier
e´ tait : comment me´ langer des
patients avec cetuximab seul avec
d’autres ayant l’association cetuxi-
mab-Campto
®
? Tout chimiothe´ra-
peute le sait, le taux de re´ ponse est
double´ entre les deux cohortes. C’est
meˆ me pour cette raison que le
cetuximab a obtenu l’AMM dans
cette indication. Pour autant, le
fait d’avoir eu l’ide´ e de l’inte´reˆt du
Kras dans le cas d’un anti-EGFR
et de concevoir apre` s la paillasse
une e´ tude clinique certes he´te´ro-
ge`nemarqueunee´ tape primordiale
dans l’ame´ lioration de la recher-
che clinique par l’approche transla-
tionnelle.
La conception des e´tudes trans-
lationnelles et l’e´ volution vers une
homoge´ne´ isation du mate´rieletdes
me´ thodes vers des patients vrai-
ment comparables et non la consti-
tution de se´ ries dont le seul point
commun est la maladie, et le fait de
recevoir un traitement chimiothe´ra-
pique est en cela remarquable de
l’e´ volution des pratiques.
La preuve de l’inte´reˆ t du statut
Kras et de son association a`la
re´ ponse objective a surtout e´te´
apporte´ e de fac¸ on plus probante
par deux e´ tudes en premie`re ligne.
Dans les deux cas, le statut Kras a
e´te´e´ tudie´ re´ trospectivement chez
40 a` 50 % des patients inclus dans
les e´tudes prospectives CRYSTAL
(FOLFIRI vs FOLFIRI-cetuximab :
phase III) et OPUS (FOLFOX vs
FOLFOX-cetuximab : phase II ran-
domise´ e). Mais c’est bien suˆr
l’e´ tude de phase III qui est la plus
inte´ ressante [30]. Le re´ sultat est
clair : le statut Kras est associe´a`la
re´ ponse objective. Or, en premie`re
ligne, ce re´ sultat est un des objectifs
majeurs, si ce n’est l’objectif en vue
d’une e´ ventuelle chirurgie des
me´ tastases. Ces re´ sultats probants
ont induit une tre` s belle re´ action en
chaıˆne des tutelles et des profes-
sionnels. La mise en place de
plateforme biologique apte a`re´pon-
dre en un temps record (15 jours a`
trois semaines dans l’ide´ al) a`une
demande de statut Kras dans
chaque re´ gion de notre pays a e´te´
obtenue en moins de huit mois. Elle
est la preuve e´ clatante de l’irruption
du « toujours plus de multidiscipli-
naire » dans la prise en charge des
patients. Les de´ cisions de la RCP
sont fonction de l’apport de diffe´-
rents professionnels de sante´de
spe´ cialite´ s diverses la constituant et
non plus de telle ou telle spe´ cialite´
qui croirait avoir une vision globale
a` elle seule. Par ailleurs, les freins
possibles a` cette mise en place de
plate-forme et a`sonefficacite´ont
e´te´e´ tudie´ s. Ainsi, plus de 50 % des
blocs anatomopathologiques sont
conserve´ s dans les laboratoires
prive´ s. La juste re´ tribution du de´ sar-
chivage et de la se´lection des blocs
et des lames a` envoyer ont e´te´
pre´ vues pour les pathologistes du
prive´ qui les adressent aux platefor-
mes universitaires, faisant ainsi
partie inte´ grante pleine et entie`re
de cette chaıˆne diagnostique (le
re´sultat e´ tant, dans certaines
re´ gions, cosigne´ par les diffe´rents
intervenants).
L’optimisation des pratiques est
un mode` le du genre sur ce sujet. En
effet, un STIC fe´de´ rateur et strate´-
gique coordonne´ par Pierre Lau-
rent-Puig est dans la foule´e
organise´ , associant les plateformes
afin d’homoge´ne´iser les techni-
ques. Le but est de rendre le plus
fiable possible le re´sultatetsa
reproductibilite´ d’une plate-forme
a` l’autre. En effet, l’obtention d’un
re´sultat suˆ r et totalement fiable est
plus que jamais de mise. Du diag-
nostic du biologiste de´pend totale-
ment la prescription non plus d’un
seul me´ decin, mais finalement de
toute la RCP. Ainsi, ce STIC va nous
permettre aussi de quantifier le
pourcentage de statut inde´ termi-
nable (de´ faut de cellules extracti-
bles, type de fixateur, fragment de
mauvaise qualite´, tre` s bonne
re´ ponse par radiochimiothe´rapie
pre´ope´ ratoire). L’existence de re´ sul-
tats de ce type a induit une re´activite´
des cliniciens qui ont fait remonter
de « la vraie vie » les interrogations
que la recherche clinique n’a pas
misoupumettreene´ vidence.
L’ave` nement des observatoires
des me´ dicaments et des the´rapeu-
tiques innovantes [OMEDITs]
(OMIT pour Bretagne-Pays-de-
Loire [OMIT B-PL] et PACA) ou`se
coˆ toient tutelles ARH, cliniciens et
pharmaciens est une ve´ritable
chance pour de´ bloquer de fac¸on
consensuelle ce type de situation.
Une e´tude pre´ alable ayant montre´
qu’au moins 5 % des statuts e´taient
inde´ terminables et posaient un re´el
proble` me au clinicien. Apre` s avis de
L’OMIT B-PL, a` titre exceptionnel
devant cette situation et dans l’inte´-
reˆ t des patients, les ARH B-PL et le
repre´ sentant de l’assurance mala-
die des deux re´ gions, en cette fin
mars 2009, ont de´cide´depermettre
SYNTHE
0
SE / REVIEW ARTICLE
3

la prescription des anti-HER1 sous
certaines conditions dans le cas des
statuts Kras non de´ terminables. La
prescription est non admise en
premie` re ligne, car il existe d’autres
alternatives. Par contre, le doute
profite au patient au-dela`dela
deuxie`me ligne. Apre` s avis de la
RCP et remonte´ e du dossier a`
l’OMIT B-PL, les prescripteurs pour-
ront proposer un anti-HER1 sans
avoir a` rebiopsier le patient. En
effet, la chance d’avoir un Kras
positif est de 60 a`70%.Toutesses
situations seront remonte´esa`l’Inca.
Pour autant, une e´ valuation de cette
proce´dure apre` s un an sera effec-
tue´ e et publie´e, de´ montrant encore
une fois la part que peut prendre,
dans le cadre de ses missions et
objectifs donne´ s par les tutelles,
l’OMIT dans la recherche clinique
en effectuant sa mission de ve´rifica-
tion du bon me´ dicament au bon
patient. La situation que nous
venons de de´crire s’inte` gre dans la
partie du de´ cret de bon usage
relative aux prescriptions justifie´es.
Elle montre la part importante prise
par l’OMIT (et les OMEDITs) pour la
validation de ces prescriptions.
Futur : vers l’e´ valuation,
la syste´ matisation des essais
a` toutes les localisations,
l’optimisation des pratiques
multidisciplinaires
et la personnalisation
du traitement
En paralle`le de marqueur pre´dictif
optimisant la prise en charge des
patients, la recherche clinique en
oncologie digestive va devoir s’atte-
ler a` de multiples missions et
objectifs.
Le travail effectue´ par l’e´quipe
de Tenon, publie´enfe´ vrier 2009, est
pour cela extreˆ mement e´ difiant
[11]. En effet, cette e´ quipe s’est
inte´resse´ e aux dossiers des patients
traite´ s pour des cancers digestifs a`
Tenon en 2007. Ils ont syste´mati-
quement et de fac¸on re´ trospective
ve´rifier l’ade´ quation de leur pres-
cription au re´fe´ rentiel de bon
usage en cance´ rologie et aux re´fe´-
rentiels des pratiques en cance´ro-
logie digestive. Le pourcentage de
de´ viation paraıˆt tre` s important. Les
explications sont probablement
multiples, mais me´ ritent d’eˆtre e´tu-
die´esdepluspre` s. Le point positif
est le caracte`re homoge`ne de la
se´ rie (elle s’est uniquement inte´res-
se´e a` l’oncologie digestive). Point
ne´ gatif : il ne repre´ sente, bien suˆr,
que l’expe´ rience d’un seul centre. Il
met en lumie`re l’absolue ne´ cessite´
d’e´ valuer nos pratiques tant dans
l’inte´reˆ t des patients que dans une
strate´gie me´dicoe´ conomique. La
syste´ matisation d’OMEDIT (OMIT)
sur le territoire et la participation
des cliniciens au coˆte´ des pharma-
ciens et des tutelles pourraient eˆtre
des pistes pour avancer sur ce
dossier et explorer de nouveaux
de´ veloppements en matie`re de
recherche clinique en cance´rologie
y compris digestive [17,22]. Les
questions que la publication de
Tenon met en exergue sont, bien
suˆ r, la relative difficulte´qu’ontles
re´fe´rentiels a` couvrir toutes les
situations mais aussi, en dehors du
CCRM, l’absence d’essais the´rapeu-
tiques dans des pans entiers de la
cance´ rologie digestive et peut-eˆtre
l’absence d’espace de discussion
(dans certaines re´ gions) que peut
constituer un OMIT performant. Il
est ainsi clair que les de´ viations
constate´ es dans le cancer de l’œso-
phage et de l’estomac avance´cor-
respondent aussi a`untre` s faible
nombre d’essais en comparaison du
CCRM. Le relatif faible taux d’inclu-
sions dans un essai rapporte´dans
cette e´ tude (7 %) montre aussi le
chemin important qu’il reste a`par-
courir au moment ou` l’Inca essaye
de promouvoir un acce`s facilite´a`
l’innovation the´ rapeutique pour
tous les patients traite´ s pour cancer.
Celui-ci sera clairement atteint
si, en dehors des localisations
comme le colon ou le pancre´as ou`
les essais existent et abondent, la
promotion d’e´ tudes dans des loca-
lisations ou` le pronostic en phase
me´ tastatique reste tre`s mauvais
comme le cancer de l’œsophage et
de la jonction œsogastrique, les
maladies orphelines que consti-
tuent les cancers des voies biliaires,
du greˆ le et autres est facilite´e, voire
soutenue de fac¸ on active par les
tutelles.
Par ailleurs, a`lalecturede
beaucoup de phase III, la descrip-
tion des patients inclus brosse le
portrait d’une population quelque-
fois e´ loigne´ e de notre pratique
quotidienne. Ce reproche se cristal-
lise sous la forme de l’opposition
entre les patients des essais et ceux
dit de « la vraie vie » [17,22]. Tout
d’abord, un argument de re´ponse
facile pourrait eˆ tre que le challenge
de la cance´ rologie digestive (celle
de la cance´ rologie en ge´ne´ral) est
de proposer syste´ matiquement a`
nos patients l’inclusion dans un
essai. Ainsi, le profil des patients
de la vraie vie et des essais seraient
rapidement superposables. Pour
autant, en attendant cette e´ volution,
la constitution de cohorte de
patients traite´ s dans nos structures
(publiques et prive´ es) permettant
en temps re´ el de constituer des
observatoires des nouvelles mole´-
cules pourrait aider a`lade´ cision. Ce
travail est clairement appele´deces
vœux par un e´ ditorial du JCO,ilya
quelques mois. Il passe par un
travail rigoureux ne´ cessitant des
moyens et une e´ troite collaboration
entre les diffe´ rentes structures
publiques et prive´ es. En effet,
seule une exhaustivite
´comple`te
permettra d’avoir une vraie photo-
graphie de la situation re´ elle. Plus
de 50 % des patients sont, en effet,
pris en charge dans des structures
prive´es.
Par ailleurs, dans ce concept de
patients de la vraie vie, une cate´go-
rie est clairement absente des
essais : les patients aˆge´s. Par le
vieillissement de la population et
l’aˆ ge de survenue moyen de la
plupart des cancers digestifs,
l’oncoge´ riatrie digestive est un
vaste champ d’investigation
[18,22]. Elle re´pond a` un besoin
urgent de sante´ publique et d’opti-
misation des soins. Elle rend ne´ces-
saire une multidisciplinarite´ accrue
associant aux acteurs usuels de la
RCP le ge´ riatre et son e´ valuation. En
France, Aparicio et al. ont ainsi
de´montre´ les faiblesses de la prise
en charge de ces patients (moins
d’acce`s a`lachimiothe´ rapie inno-
vante, sous dosage des traitements,
arreˆ t pre´ coce de traitement) [3]. Le
fait d’e´ tendre les e´ tudes par le seul
ONCOLOGIE
4

crite` re d’aˆ ge supe´ rieur a`18ans
sans borne supe´rieure permet
l’inclusion dans des essais. Le pas
comple´ mentaire est la re´ alisation
d’e´ tudes purement d’oncoge´ riatrie
ou` la personnalisation du traite-
ment, tellement a` la mode actuelle-
ment, pourrait trouver un champ
d’investigation tre`s inte´ ressant.
L’e´ tude de la vraie vie nous permet,
cependant, d’e´ valuer les effets de
mole´ cules innovantes chez les
patients aˆge´s.Ainsi,surune
cohorte homoge`nedepatientstrai-
te´ s par FOLFIRI-bevacizumab en
premie` re ligne d’un CCRM, la
comparaison entre les cohortes
aˆge´ es de moins et de plus de
70 ans montre les meˆ mes pour-
centages de re´section secondaire
des me´ tastases he´ patiques et une
survie globale non statistiquement
diffe´ rente [22].
A
`travers l’ave` nement des the´-
rapies cible´ es, l’ide´ e de la person-
nalisation du traitement est
maintenant devenue un objectif
strate´gique.L’heure e´ tant aux asso-
ciations chimiothe´ rapies conven-
tionnelles, il apparaıˆt primordial de
personnaliser les deux types de
traitement associe´ s [14,15]. Pour
les the´rapies cible´ es, les essais
d’escalade de dose sont un premier
pas permettant d’obtenir des re´pon-
ses chez des patients n’en pre´ sen-
tant pas a` doses usuelles. Elle
pre´ figure la strate´ gie de dosage et
d’adaptation du traitement e´ tudie´e
dans les maladies he´ matologiques
avec l’imatinib. Elle doit, cependant,
ne pas oublier qu’il existe des
moyens de personnaliser les chi-
miothe´ rapies conventionnelles.
Ainsi, outre le de´ pistage du de´ficit
majeur en dihydroprimidine-de´hy-
droge´ nase (DPD) ou en UGT1A1
(sources de toxicite´ potentiellement
le´ thale sous fluoropyrimidines ou
irinote´can), les e´ tudes du profil
ge´ notypique de traitement comme
le FOLFIRI (par exemple) permet-
tent d’envisager une escalade de
doses des traitements chez les
patients a` bon profil me´ tabolique,
le concept d’effet-dose intensite´
e´tant prouve´ dans la plupart des
cancers [14]. Avec un profil de
toxicite´calcule´ , cette strate´gie
concourt a`lave´ ritable personnali-
sation du traitement et est une des
voies de choix de la recherche en
cance´ rologie. Cette optimisation du
traitement est bien suˆraussie´ tudie´e
en radiothe´ rapie. Prenons un exem-
ple simple : le protocole Herskovic,
dans le cadre du cancer de l’œso-
phage, a e´te´rapporte´a` la fin des
anne´ es 1980. Le sche´ ma associe
une radiothe´rapie a` une chimiothe´-
rapie (CT) par 5-FU-cisplatine sur
cinq jours (dont les doses de CT et la
fac¸ondelade´ livrer n’ont pas
bouge´ ). Par contre, la radiothe´rapie
a depuis fortement progresse´dans
l’optimisation des champs et du
mate´ riel. La fac¸on de de´ livrer la
dose a change´ , l’utilisation d’une
proce´dure de radiothe´rapie confor-
mationnelle, la pre´ cision des acce´-
le´ rateurs avec le « multilames »
permet de re´ duire les effets secon-
daires et de prote´ ger les tissus sains
[8]. L’arrive´ e en cance´ rologie diges-
tive d’autres techniques d’optimisa-
tion comme l’IMRT, le gating,mais
aussi le CyberKnife
®
(indique´ e pour
l’instant dans les tumeurs he´pati-
ques) ou la tomothe´ rapie vont
devoir eˆ tre e´ value´ es tant sur le
plan de l’efficience clinique que sur
la partie me´dicoe´ conomique.
Comme pour toutes les avan-
ce´es en cance´ rologie digestive,
notre travail va eˆ tre de de´ finir le
concept du bon traitement au bon
patient a` la bonne dose en alliant
une compre´ hension de l’activite´de
la mole´ cule. Ainsi, voit-on apparaıˆ-
tre le concept de phase 0 qui pour-
rait eˆ tre de´ finie par une meilleure
compre´ hension de la pharmacody-
namie et de la pharmacocine´tique
pour laquelle le risque toxique est
quasi inexistant, mais le potentiel
the´ rapeutique est lui aussi tre`s
faible. Cependant, ce concept ne
prend pas en compte des parame`-
tres pharmacocine´ tiques tels que la
cine´ tique non line´ aire, les voies
me´ taboliques pouvant varier en
fonction des niveaux de doses et
les cas de de´ ficits me´ taboliques
complets lie´s a` des polymorphis-
mes ge´ne´tiques.A
`l’autre bout de la
chaıˆne d’e´ valuation, se positionnent
les e´tudes me´dicoe´ conomiques
permettant, par exemple, de calcu-
ler le couˆ t global de la prise en
charge [22,25]. Ainsi, les lignes de
traitement s’additionnant dans le
CCRM, il est important d’avoir une
lisibilite´ sur le couˆ t moyen induit par
patient de l’ajout des the´rapies
cible´es et des e´ventuelles diffe´ren-
ces suivant la ligne a` laquelle elles
sont de´livre´ es. La re´ cente publica-
tion de Grude´ et al. nous montrent
que le couˆt total s’e´le`vepluson
avance en ligne dans le CCRM et
que l’utilisation de mole´cules
comme le bevacizumab ou le cetu-
ximab induit un couˆ t de l’ordre de
25 000 euros par patients dans la
fameuse « vraie vie » [17].
Mais, on le voit, l’innovation
the´ rapeutique n’est pas cantonne
´e
aux disciplines me´ dicales. La chi-
rurgie a enregistre´ des progre`s
constants, et les patients atteints
de cancers digestifs be´ne´ ficient de´ja`
des avance´es en matie` re de chirur-
gie he´ patique. La cre´ ation d’un
groupe de recherche (GRECCAR :
groupe de recherche chirurgicale
sur le cancer du rectum), en 2006,
s’attachant a`e´ valuer et a` tester de
nouvelles voies de recherche en
chirurgie du cancer est la`pourle
confirmer. Dans cette optique,
apre` s la vulgarisation de la chirur-
gie par cœlioscopie, l’arrive´ e de la
robotique pourrait a`termeeˆ tre une
nouvelle voie de recherche et
d’optimisation des soins. La cance´-
rologie digestive pourrait eˆ tre une
voie reˆve´ e d’expe´ rimentation de
ces nouvelles techniques chirurgi-
cales.
Mais, a`coˆte´ de toutes ces avan-
ce´es the´ rapeutiques, un champ
strate´ gique de recherche doit eˆtre
promu de fac¸on coordonne´e et
active, c’est la pre´ vention ; elle
peut apparaıˆtre le parent pauvre de
notre me´ tier. Et pourtant, les cam-
pagnes successives mene´es, en
France comme a`l’e´ tranger, nous
montrent son impact sur la survie.
Conclusion
Enfin, on le voit, la multiplicite´des
avance´ es dans chaque spe´ cialite´
concourant a` la prise en charge
des patients porteurs de cancer
digestif va ne´ cessiter un effort de
coordination commune pour conju-
guer les efforts de chacun [[merci
SYNTHE
0
SE / REVIEW ARTICLE
5
 6
6
 7
7
1
/
7
100%