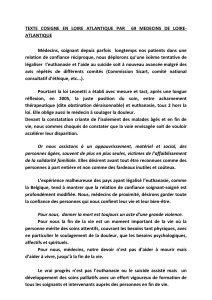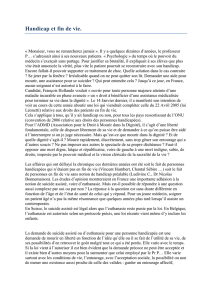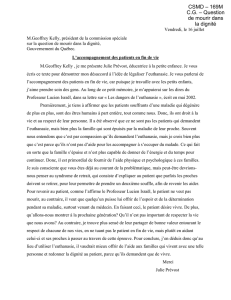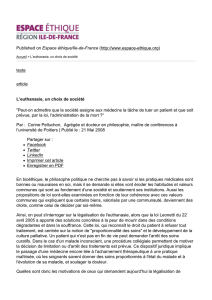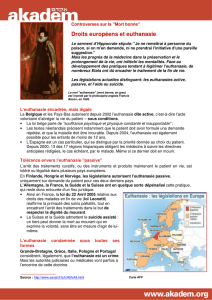La mort comme traitement Quand les personnes souffrant d`une

La mort comme traitement
Quand les personnes souffrant d’une maladie non terminale doivent-elles être aidées à
mourir ?
Ce texte est une traduction d’un article de Rachel AVIV paru dans The New Yorker le 22/06/2015
intitulé
The Death Treatment ; When should people with a non-terminal illness be helped to die?
La version originale anglaise est consultable sur le lien suivant
http://www.newyorker.com/magazine/2015/06/22/the-death-treatment
Toute suggestion destinée à améliorer la traduction est la bienvenue.
La législation belge autorise l'euthanasie pour les patients souffrant de pathologies graves et
incurables, troubles psychologiques y compris.
Dans son journal intime, Godelieve De Troyer classait ses humeurs avec des couleurs. Elle se
sentait « gris foncé » quand elle avait fait une erreur de couture ou de cuisine. Lorsque son
compagnon parlait trop, elle variait entre « noir » et « très noir ». Et quand elle rendait visite à
ses parents dans leur ferme du nord de la Belgique, elle souffrait de la pire couleur noire
possible. En leur présence, elle se sentait agressive et dangereuse. Elle s’inquiétait d’avoir
deux personnalités à l’intérieur d’elle-même, l’une empathique, charmante, sensible et l'autre
cruelle.
Elle se sentait « grise claire » quand elle se rendait chez le coiffeur ou faisait du vélo au
travers des bois de Hasselt, une petite ville dans la région flamande de Belgique, où elle
vivait. Dans ces moments, écrivait-elle, elle essayait de se rappeler de toutes les choses qu'elle
pourrait faire afin de se sentir heureuse : « obtenir le respect des autres »; « être physiquement
attrayante »; « adopter une attitude réservée »; « vivre en harmonie avec la nature ». Elle
imaginait une vie dans laquelle elle aurait été appréciée intellectuellement, impliquée
socialement, à l’aise en anglais (elle prenait des cours de langue), et aurait eu une « femme de
ménage avec laquelle je me serais bien entendue. »
Godelieve, qui enseignait l'anatomie aux infirmières, avait été en thérapie depuis l’âge de dix-
neuf ans. Avec chaque nouveau médecin, elle recommençait le processus thérapeutique, en
adoptant la philosophie de son médecin et en réécrivant l'histoire de sa vie selon celle-ci. Elle
disséquait sans cesse la source de son angoisse. « Je suis confrontée presque quotidiennement
aux conséquences de mon enfance », écrivait-elle à sa mère. Elle avait voulu être historienne,
mais son père, autoritaire et froid, avait fait pression pour qu’elle devienne médecin. Sa mère,
malheureuse en mariage, lui rappelait la figure d'un « esclave ». « Je ne veux pas tout accepter
et rester effacée comme elle. »
Godelieve était préoccupée par l'idée d’avoir reproduit les erreurs de ses parents avec ses
propres enfants. Elle s’était mariée à vingt-trois ans, et avait eu deux enfants. Mais le mariage
était tumultueux et s’était achevé par un divorce, en 1979, alors que son fils avait trois ans et
sa fille sept ans. Deux ans plus tard, leur père, Hendrik Mortier, un radiologue, se suicida.
Comme toute mère seule, Godelieve fut accablée. Dans une note de son journal en 1990,
quand ses enfants étaient adolescents, elle se donnait pour mission de « laisser mes enfants

être eux-mêmes et les respecter dans leur individualité. » Malheureusement, elle se disputa
avec sa fille, qui était froide et indépendante, et se reposa donc sur son fils, Tom, qui devint
« victime de mon instabilité », constatait-elle. Elle craignait, disait-elle à son psychologue,
que ses enfants soient « en train de payer pour tout ce qui était arrivé des générations plus
tôt. »
La plus belle période de sa vie a commencé au début de la cinquantaine avec un nouveau
compagnon. Elle avait l’impression d’être allée au-delà des drames de son enfance, un exploit
dont elle attribuait la réussite à son nouveau psychiatre. « Il ouvre complètement la plaie, la
nettoie à fond, puis la referme pour qu'elle puisse cicatriser, ». Godelieve, aux cheveux blonds
et au sourire mélancolique, se fit beaucoup d'amis au cours de ces années. Pour Tom, « Elle
était la plus belle des femmes », « Les gens me disaient, 'Oh, je pourrais tomber amoureux de
votre mère.' » Christiane Geuens, un ami proche, disait : « Les gens voulait tous la connaître.
Quand elle entrait dans une pièce, on ne voyait qu’elle. »
Godelieve fut ravie quand Tom et sa femme eurent un enfant, en 2005. Elle se promit
d’apprendre de ses erreurs en tant que mère pour être une grand-mère attentive. Sur les
photos, elle se montre affectueuse pour la fille de Tom, en la tenant alors qu’elle se brosse les
dents, ou assise sur le lit avec elle, en lui tressant les cheveux.
Puis, en 2010, son compagnon rompit la relation, et elle se sentit à nouveau complètement
« noire ». Elle cessa de porter du maquillage et de se coiffer, annula ses rendez-vous avec ses
amis, parce disait-elle, elle se sentait laide et vieille. Elle pensait avoir perdu son
levensperspectief, un mot néerlandais désignant le sentiment qu'il y a une raison de vivre.
Tom habitait seulement à trente minutes, mais elle n'avait plus l’envie de se rendre chez lui.
Elle accusa Tom de ne pas être assez sympathique, et Tom, qui venait d’avoir un deuxième
enfant, lui reprochait d’avoir abandonné sa famille. Après plusieurs mois de conflits, ils
arrêtèrent de se parler. Elle le constate dans son journal intime « Je ne pense pas qu'il puisse y
avoir de contacts fructueux avec les enfants avec toute cette agressivité envers moi. » La sœur
de Tom, une avocate spécialisée dans les droits de l'homme en Afrique, l’évitait également;
elle trouvait trop douloureux d’être aspirée par la dépression de sa mère, qui avait déjà
marqué toute son enfance. (Elle a demandé à ne pas être nommée.)
Godelieve avait l’impression que tous ses progrès émotionnels et affectifs avaient été
illusoires. Elle voyait le même psychiatre depuis plus de dix ans et l'avait consulté sur toutes
ses décisions, même celles impliquant des investissements financiers et des travaux au
domicile, mais elle avait complétement perdu confiance en lui. Elle s’en plaignit auprès de ses
amis, « je lui donne 90 €, il me donne une ordonnance, et après dix minutes, c’est fini. » Son
psychiatre reconnaissait qu'il n'y avait pas de remède pour son état ; le mieux qu'il pouvait
faire, disait-il, était de l'écouter et de lui prescrire des antidépresseurs, comme il l’avait fait
pendant des années.
À l'été 2011, quand elle eut soixante-trois ans, Godelieve rencontra un nouveau médecin. Elle
assistait à une conférence donnée par Wim Distelmans, un oncologue et professeur de
médecine palliative à l'Université libre de Bruxelles. Distelmans était l'un des principaux
partisans de la loi de 2002 en Belgique qui autorisait l'euthanasie pour les patients aux
maladies incurables provoquant une souffrance physique ou mentale insupportable. Depuis, il
a euthanasié plus d'une centaine de patients. Distelmans, qui porte un manteau et des bottes de
cuir, des foulards noués artistiquement, est devenu une célébrité en Belgique en promouvant

la mort digne comme un droit de l’homme, une « formidable libération », et donne des
conférences dans les centres culturels, hôpitaux et écoles dans tout le pays.
En septembre, Godelieve rencontra Distelmans à sa clinique. Quatre mois plus tard, elle
envoyait un mail à ses enfants : « J'ai déposé une demande d'euthanasie avec le professeur
Distelmans, demande fondée sur ma dépression. J’ai réalisé toutes les démarches et j’attends
désormais le résultat ».
Tom et sa femme venaient d'avoir leur troisième enfant. Ils enseignaient tous deux la chimie
au Collège universitaire de Louvain, qui dépend de la plus ancienne université belge. Quand
Tom reçut ce mail de sa mère, il le montra à son superviseur, Lies Verdonck, un médecin
familier du travail de Distelmans, et lui demanda ce qu'il fallait faire. Pour elle, il n’était pas
possible que Distelmans approuve la demande d'euthanasie sans en parler d'abord avec la
famille du patient. « Restez concentré sur votre travail et vos enfants » dit-elle à Tom.
À l'époque, Tom était en train de chercher une maison de retraite pour la mère de Godelieve,
avec laquelle elle était brouillée. Il était mécontent que cette tâche lui soit retombée dessus, et
il estimait que sa mère se faisait manipuler. Elle avait déjà exprimé des pensées suicidaires
auparavant, qui avaient ensuite disparues, il avait donc décidé de ne pas répondre au mail. Sa
sœur, qui était en Afrique, avait répondu qu'elle respecterait la décision de sa mère, mais que
cela lui faisait mal.
Le 20 avril 2012, trois mois après le mail de Godelieve, Tom reçut une courte lettre de sa
mère écrite au passé. Elle y écrivait que son euthanasie avait été effectuée le 19 avril, à
l'hôpital universitaire de l'Université libre de Bruxelles. « Je fais don de mon corps à la
science », écrivait-elle. Sur le dos de la lettre, elle avait marqué le numéro de téléphone d'une
amie qui avait les clés de sa maison.
Tom se rendit immédiatement à la maison de l'amie, qui lui offrit un verre et lui expliqua
ensuite que son mari et elle avaient conduit Godelieve à l'hôpital. Tom accusa le couple
d’avoir coopéré à la réalisation d’un suicide. Ils se défendirent : c’était le choix de Godelieve,
et ils ne voulaient pas qu'elle se rende à l'hôpital, seule, en taxi. Plus tard, ils admirent face à
Tom que dans la voiture, Godelieve causait et riait, et ils avaient commencé à se demander
s’ils la connaissaient aussi bien qu'ils ne l’avaient pensé.
Tom sentit son esprit s’arrêter. Il alla à la maison de sa mère, qu'il n'avait pas visitée depuis
plus d'un an. Elle venait de terminer des travaux au premier étage, avant de se séparer de son
compagnon. Ils avaient voulu vieillir dans la maison sans avoir à se soucier des escaliers et
avait accompli des travaux en ce sens. L'intérieur de la maison avait été décoré avec des
photographies encadrées de ses petits-enfants. De grands dessins de Tom et de sa sœur étaient
accrochés sur le mur du salon.
Dans le tiroir du bureau de la chambre de Godelieve, Tom trouva des brouillons de plusieurs
lettres d'adieu qu'elle avait écrites à des amis, son association de quartier, et une chorale dans
lequel elle chantait, ainsi que d'une liste de noms avec un X en face, comme si elle remerciait
chacun d’être venus après une fête. Elle remerciait ses amis pour leur compagnie, présentait
ses excuses de les blesser ainsi, et expliquait que « la solitude, l’absence de guérison après
quarante ans de thérapie, plus d’objectif dans cette vie, tout cela m'a amenée à voir que la
seule chose qui reste à faire est une fin de vie digne ».

Il y avait aussi un brouillon d'une longue lettre à ses enfants, beaucoup plus touchante que
celle envoyée. « Je n’ai pas été capable de gérer ma relation avec toi, Tom, » écrivait-elle.
« Je t’ai beaucoup aimé, mais tu ne l’as pas perçu ainsi. » Puis elle s’adressait à ses trois
petits-enfants: « Vous m’avez beaucoup manqué. » Elle avait également écrit, avant de
raturer : « je ne vais pas voir mes petits-enfants grandir et cela me fait mal. »
Dans le salon de sa mère, Tom trouva un article sur Distelmans dans De Morgen, un journal
flamand de premier plan, qui présentait une grande photo de lui assis sur un lit, vêtu d'un jean,
une chemise à motifs, bracelet d’argent au poing. Le journaliste décrivait Distelmans comme
un médecin qui « ne peut pas supporter l'injustice. » Distelmans y évoquait son mépris pour
les médecins qui pensent savoir ce dont leurs patients ont besoin, et ajoutait au journaliste que
la « loi sur l'euthanasie a une grande valeur symbolique. Les gens peuvent dire ce qu’ils
veulent vraiment. »
Tom découvrit également une brochure, produite par LEIF (Forum d’information sur la fin de
vie), organisation fondée par Distelmans, qui décrivait les options médicales et juridiques
disponibles pour les personnes en fin de vie ou qui souhaitaient mourir. Sur la dernière page,
les auteurs avaient imprimé un extrait de « Utopia », par Thomas More, qui décrit un monde
dans lequel « l'euthanasie est considérée comme une mort honorable. » Dans la société idéale
de More, les responsables gouvernementaux et les prêtres visitent les malades souffrants et
leur disent: « Pourquoi ne vous arrêtez vous pas et ne partez-vous pas vers un monde meilleur
? »
En Belgique, l'euthanasie est vue comme un symbole de lumière et de progrès, signe que le
pays lui-même a rompu avec ses racines patriarcales catholiques. Distelmans, qui a été élevé
en catholique et a ensuite rejeté l'Église, m'a dit que son travail était inspiré par l’aversion
pour toutes les formes de paternalisme. « Qui suis-je pour convaincre les patients qu'ils ont à
souffrir plus que ce qu'ils ne veulent ? »
La Belgique a été le deuxième pays au monde, après les Pays-Bas, à dépénaliser l'euthanasie;
elle a été suivie par le Luxembourg, en 2009, et, puis, cette année, par le Canada et la
Colombie. La Suisse a autorisé le suicide assisté depuis 1942 (NDT en fait c’est une faille du
Code pénal qui de fait dépénalise l’aide au suicide à condition qu’elle soit désintéressée). La
Cour suprême des États-Unis a reconnu que les citoyens pouvaient avoir des inquiétudes
légitimes concernant les prolongations inutiles de la vie en milieu hospitalier, mais en 1997,
elle a jugé que la mort n’était pas un droit protégé par la Constitution, et a laissé chaque Etat
régler la question du suicide assisté par lui-même. Quelques mois après la décision, l'Oregon
adoptait une loi permettant aux médecins de prescrire des produits létaux pour les patients à
qui il reste moins de six mois à vivre. En 2008, Washington a adopté une loi similaire ; le
Montana a décriminalisé le suicide assisté l'année d'après ; et le Vermont a suivi en 2013.
Ce mouvement du droit à mourir a pris de l'ampleur à un moment où le vieillissement de la
population s’accroit ; les plus de soixante-cinq ans représentent la plus forte croissance
démographique aux États-Unis, au Canada, et une grande partie de l'Europe. Mais ces lois
semblent être moins motivées par les désirs des personnes âgées que par les préoccupations
des jeunes générations, dont les membres sont rassurés par l’idée qu'ils puissent contrôler leur
fin de vie. Diane Meier, professeur de gériatrie à la Mount Sinai School of Medicine, à New
York, et l'un des principaux médecins de soins palliatifs dans le pays, m'a dit que « le
mouvement de légalisation du suicide assisté est entraîné par des ‘gens inquiets mais en bonne
santé’, des gens qui sont terrifiés par l'inconnu et veulent reprendre le contrôle. » Elle ajoute,

« Cela ne veut pas dire que la profession médicale ne fait pas un travail impressionnant pour
empêcher les gens de souffrir. » Comme la plupart des médecins spécialisés en soins
palliatifs, un domaine mettant l'accent sur la qualité de vie des patients en fin de maladies
graves ou de vie, elle pense que la légalisation du suicide assisté est inutile. « L'idée que si les
gens ne se suicident pas, ils vont mourir avec un respirateur artificiel à l'hôpital serait
amusante si elle n’était pas aussi grave, » dit-elle. Elle croit que l'angoisse qui nourrit ce
mouvement serait diminuée si les patients avaient un meilleur accès à des soins palliatifs et si
les médecins étaient plus attentifs à la souffrance psychologique de leurs patients.
En Oregon et en Suisse, des études ont montré que les personnes qui demandent la mort sont
moins motivées par la douleur physique que par le désir de rester autonome. Ce raisonnement
a été illustré par Brittany Maynard, une jeune mariée de vingt-neuf ans, qui a déménagé en
Oregon l'an dernier pour qu'elle puisse mourir au moment choisi plutôt que de laisser son
cancer du cerveau suivre son cours. Son histoire a fait la couverture du magazine People, qui
l'a décrite comme ayant « l'âme d'un aventurier et le cœur d'un guerrier. » Elle est devenue le
visage de l’aide à mourir, beaucoup plus présentable que celui de Jack Kevorkian, qui avait
déjà rempli ce rôle. Contrairement aux patients que Kevorkian aidait à mourir grâce à une
« machine à suicide » bricolée, Maynard ne semblait ni passive, ni vulnérable. Depuis sa
mort, il y a huit mois, les législateurs de plus de vingt-trois États américains ont présenté des
projets de loi qui rendraient légale l’aide à mourir.
Les opposants ont averti depuis des années que la légalisation serait une « pente glissante »,
mais en Oregon, moins de neuf cents personnes ont demandé des prescriptions létales depuis
que la loi a été adoptée, et ils représentent la catégorie sociale la moins susceptible d'être
influencée : ils sont massivement blancs, instruits et aisés. En Belgique et aux Pays-Bas, où
les patients peuvent être euthanasiés, même sans maladie mortelle, les lois semblent avoir
imprégné le corps médical plus profondément qu'ailleurs, peut-être en raison du rôle central
accordé aux médecins : dans la majorité des cas, c’est le médecin, et non le patient, qui
accomplit le geste final. Au cours des cinq dernières années, le nombre d'euthanasies et de
suicides assistés aux Pays-Bas a doublé, et en Belgique, il a augmenté de plus de 150%. Bien
que la plupart des patients belges présentait un cancer, les gens ont également été euthanasiés
pour des raisons d’autisme, d'anorexie, de trouble borderline, de fatigue chronique, de
paralysie partielle, de cécité associée à la surdité et de bipolarité. En 2013, Wim Distelmans a
euthanasié un homme transgenre de quarante-quatre ans, Nathan Verhelst, parce Verhelst
avait été dévasté par l'échec de ses chirurgies de changement de sexe ; il disait se sentir
monstrueux quand il se regardait dans le miroir. « Adieu, tout le monde, » a-t-il déclaré de son
lit d'hôpital, quelques secondes avant de recevoir une injection létale.
Les lois semblent avoir créé une nouvelle conception du suicide, aujourd’hui vu comme un
traitement médical, dépouillé de ses dimensions tragiques. Patrick Wyffels, un médecin de
famille belge, m'a dit que le processus d'euthanasie, qu’il réalise huit à dix fois par an, a une
composante « magique. » Mais il s’inquiète parfois de la façon dont ses propres valeurs
pourraient influencer la décision d'un patient de vivre ou de mourir. « Selon ma manière de
communiquer, je pourrais guider les patients dans telle ou telle voie, » raconte-t-il. Dans les
jours qui précèdent et qui suivent une euthanasie, il a du mal à dormir. « Vous passez sept ans
à étudier pour devenir médecin, vous apprenez comment remettre les gens en bonne santé et
puis, soudain, vous faites tout le contraire, » me dit-il. « J’ai peur du pouvoir que j’ai à ce
moment. »
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%