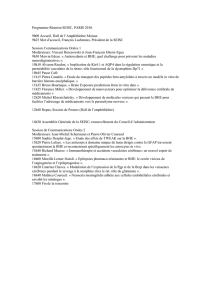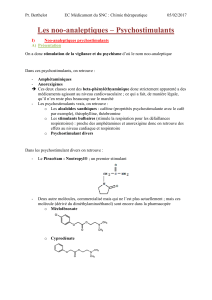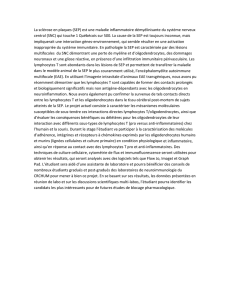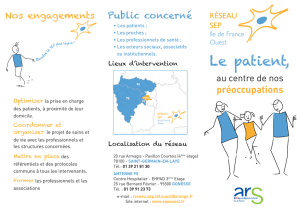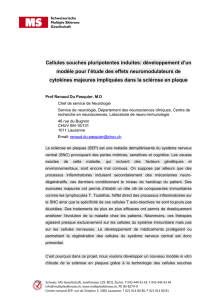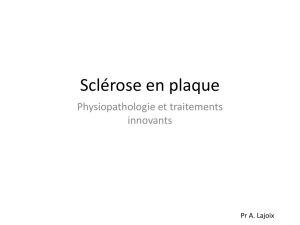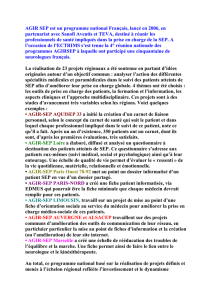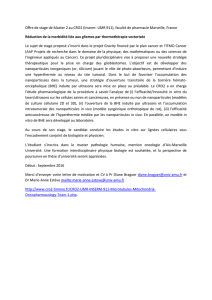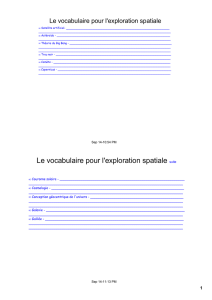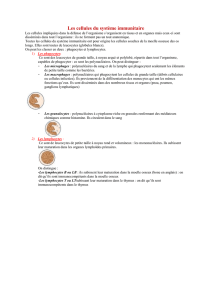Les interactions BHE/leucocytes dans la sclérose en plaques

Correspondance
Alexandre Prat, MD, PhD
Directeur de l’axe des neurosciences
CHUM-Hôpital Notre-Dame
1560 Sherbrooke East,
Montréal,
Québec, H2L 4M1
Canada
514 890-8000 poste 24734
Date de réception : 29 novembre 2012
Date d’acceptation : 1 février 2013
Les interactions BHE/leucocytes dans
la sclérose en plaques
BBB-Leukocyte Interactions
in Multiple Sclerosis
Catherine Larochelle1,2 et Alexandre Prat1,2
1Laboratoire de recherche en neuroimmunologie, Centre d’excellence en neuromique, CRCHUM, Hôpital Notre-Dame,
Faculté de médecine, Université de Montréal
2Clinique des maladies démyélinisantes, CHUM-Hôpital Notre-Dame, Département de neurologie, Faculté de médecine,
Université de Montréal
NUMÉRO CRCQ
Vol.2 n°2
REVUE
CATHERINE LAROCHELLE ET COLL. 1

Résumé
Près de 150 ans après sa description clinique, la cause exacte de la sclérose en plaques (SEP), une
maladie infl ammatoire du système nerveux central (SNC), demeure inconnue. La contribution du sys-
tème immunitaire périphérique à la formation des plaques est toutefois indéniable, et la compréhen-
sion croissante des mécanismes moléculaires sous-tendant l’infi ltration du SNC par des leucocytes
infl ammatoires a permis de nombreuses avancées thérapeutiques. Cet article propose une revue des
connaissances actuelles concernant l’interaction des cellules du système immunitaire périphérique
avec la barrière hémo-encéphalique (BHE), un événement crucial dans la genèse des lésions du SNC
observées dans la SEP.
Summary
Nearly 150 years after its clinical description by Charcot, the exact cause of Multiple Sclerosis, an in-
fl ammatory disorder of the central nervous system, still remains elusive. The contribution of the periph-
eral immune system to lesion formation is however undeniable, and the understanding of the molecular
mechanisms underlying the infi ltration of the central nervous system by infl ammatory leukocytes has
led to numerous therapeutic advances. This review article focuses on the interactions between periph-
eral immune cells and blood-brain barrier endothelial cells, a crucial early event in Multiple Sclerosis
lesion formation.
Vol.2 n°2
NUMÉRO CRCQ
CATHERINE LAROCHELLE ET COLL. 2

lique (BHE), constitue l’événement initial ou un
phénomène secondaire à une dysfonction du
compartiment central [1]. Néanmoins, la com-
préhension croissante des mécanismes molé-
culaires sous-tendant l’infi ltration du SNC par
des leucocytes infl ammatoires et la formation
subséquente des ‘plaques’ a permis de nom-
breuses avancées tant au niveau des connais-
sances concernant la pathophysiologie de la
SEP que du traitement pharmacologique de ses
manifestations cliniques. Cet article propose
une revue des connaissances actuelles concer-
nant l’interaction des cellules immunitaires avec
la BHE, un événement considéré crucial dans
la genèse des lésions du SNC observées dans
la SEP.
Introduction
En 1866, à Paris, Charcot décrit une
nouvelle entité clinique qui se mani-
feste par des symptômes neurolo-
giques intermittents, variés et récurrents, et
est associée en pathologie à des plaques de
démyélinisation au niveau du système nerveux
central (SNC). Il lui donne le nom de sclérose en
plaques (SEP). Près de 150 ans plus tard, bien
que l’on attribue généralement les symptômes
de la SEP à une action inappropriée du système
immunitaire entraînant une atteinte de la myé-
line et des axones du SNC, la cause exacte de
la SEP demeure inconnue. Le débat demeure à
savoir si l’entrée de cellules immunitaires péri-
phériques dans le SNC, normalement restreinte
par la présence de la barrière hémo-encépha-
Vol.2 n°2
NUMÉRO CRCQ
CATHERINE LAROCHELLE ET COLL. 3
La SEP est une maladie infl ammatoire du SNC associée à une perte de fonction
de la BHE
La SEP est une maladie infl ammatoire du SNC
caractérisée par la présence de zones multifo-
cales d’infi ltration leucocytaire et de démyélini-
sation. Bien que la nature auto-immune de la
SEP ne soit toujours pas confi rmée, plusieurs
facteurs appuient la contribution majeure du
système immunitaire au développement de la
SEP. Premièrement, les facteurs génétiques
associés au risque de développer la SEP sont
majoritairement impliqués dans la fonction
immunitaire [2], le facteur génétique associé
au plus grand effet sur la susceptibilité (risque

à des infi ltrats immunitaires périvasculaires [7,
8]. Ces leucocytes infl ammatoires infi ltrants re-
lâchent des facteurs toxiques et des molécules
infl ammatoires qui activent et endommagent les
cellules résidentes du SNC [9]. Ils sont donc lar-
gement considérés responsables du dommage
subi par les cellules gliales et neuronales, et
subséquemment des symptômes cliniques neu-
rologiques récurrents et/ou cumulatifs obser-
vés chez les patients souffrant de la SEP. Dif-
férentes sous-populations leucocytaires ont été
incriminées dans la formation de lésions dans
la SEP, dont les lymphocytes THelper, les lympho-
cytes Tcytotoxiques, les cellules dendritiques et les
lymphocytes B [7, 8]. Quelle que soit leur na-
ture, les leucocytes infl ammatoires doivent tout
d’abord pénétrer au sein du SNC et augmenter
la perméabilité de la BHE pour être pathogé-
niques dans la SEP [10]. La déstabilisation de la
BHE et l’infi ltration périvasculaire de leucocytes
au niveau du SNC sont en effet considérées
comme des événements précurseurs dans la
formation des lésions de SEP, tel que démontré
par i) la présence de rehaussement des lésions
après injection de gadolinium, observé en ima-
relatif 3.08) étant l’haplotype Human Leuko-
cyte Antigen (HLA)-DR, associé au complexe
majeur d’histocompatibilité classe II [3]. Deu-
xièmement, 90% des patients souffrant de SEP
présentent des bandes oligoclonales au sein
du liquide céphalo-rachidien, témoignant d’une
production d’anticorps au sein du SNC. Dans la
même veine, une étude récente suggère qu’un
anticorps anti-canal potassique KIR4.1 poten-
tiellement pathogénique serait retrouvé chez
46.9% des patients SEP [4]. Troisièmement, un
modèle animal de la SEP, l’encéphalite autoim-
mune expérimentale (EAE), est basé sur l’acti-
vation du système immunitaire périphérique en
présence d’antigènes originaires du SNC [5]. Fi-
nalement, les traitements démontrés effi caces
dans la SEP sont des immunosuppresseurs ou
des immunomodulateurs, tels les corticosté-
roïdes, la mitoxantrone, l’acétate de glatiramer,
les interférons bêta ou plus récemment le fi ngo-
limod [6].
Au niveau histopathologique, les plaques de
SEP sont caractérisées par de la démyélinisa-
tion, de la perte axonale, une gliose réactionnelle
et une dysfonction focale de la BHE, associées
Vol.2 n°2
NUMÉRO CRCQ
CATHERINE LAROCHELLE ET COLL. 4

suite aux traitements immunomodulateurs ou
immunosuppresseurs.
gerie par résonance magnétique [11, 12] et ii) la
diminution de l’incidence de nouvelles lésions
Vol.2 n°2
NUMÉRO CRCQ
CATHERINE LAROCHELLE ET COLL. 5
La barrière hémo-encéphalique (BHE)
Le SNC est considéré comme ‘immunoprivilé-
gié’ puisque la présence de la BHE restreint la
circulation des molécules et des cellules de la
périphérie vers le SNC [13]. En effet, les capil-
laires et veinules post-capillaires du SNC sont
tapissés de cellules endothéliales spécialisées
qui forment la première couche de la BHE. Cet
endothélium n’est pas fenêtré, présente une
faible activité pinocytaire et exprime plusieurs
molécules impliquées dans l’effl ux de média-
teurs solubles vers le sang [10, 14-17]. Il en-
trave donc fortement la diffusion transcellulaire
des éléments du sang vers le SNC et expulse
activement les métabolites toxiques [18]. Les
cellules endothéliales de la BHE expriment éga-
lement des molécules de jonctions serrées (JS)
et de jonctions adhérentes (JA) (fi gure 1) [10,
13, 14, 19-21]. Les JS sont formées par des
protéines transmembranaires qui lient deux cel-
lules endothéliales adjacentes. Ces protéines
appartiennent à la famille des claudines, des
occludines et des molécules d’adhérence jonc-
tionnelles. Les complexes macromoléculaires
formés par les JS sont attachés aux fi laments
d’actine du cytosquelette de la cellule endo-
théliale par des molécules adaptatrices dont
les zona occludens 1, 2 et 3, la cinguline et la
protéine sérine kinase dépendante du calcium.
Les JA quant à elles sont formées de protéines
telles que la cadhérine vasculaire-endothéliale
et sont liées au cytosquelette par des caténines.
En formant des complexes intercellulaires sem-
blables à des fermetures éclair, les TJ et les AJ
limitent la perméabilité intercellulaire de l’endo-
thélium capillaire du SNC.
Apposée à l’endothélium spécialisé de
la BHE, une lame basale endothéliale, formée
de protéines de la matrice extracellulaire telles
que les laminines 8 et 10 et le collagène type IV,
pose aussi entrave à la circulation moléculaire
et cellulaire de la périphérie vers le SNC. Cette
lame basale délimite la première bordure de
l’espace périvasculaire [13, 22]. Des péricytes
enchâssés à l’intérieur de cette lame basale
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%