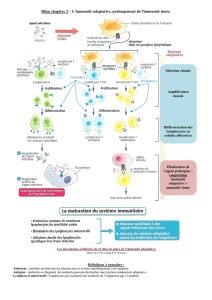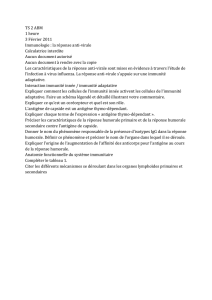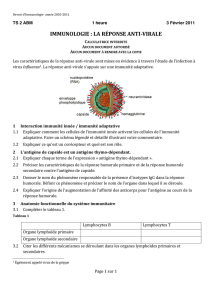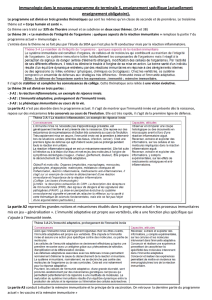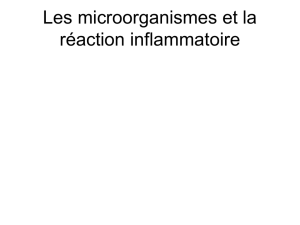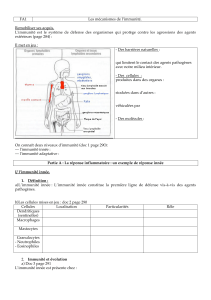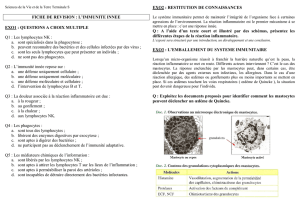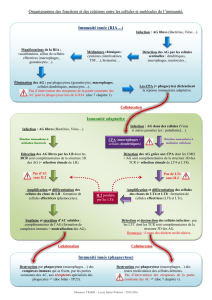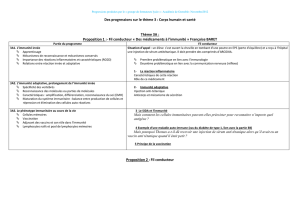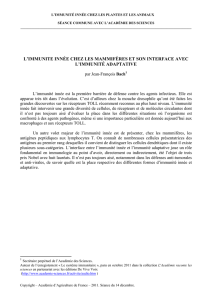Partie C – Les réactions immunitaires

Partie C – Les réactions immunitaires
Les chapitres 10, 11 et 12 équivalent aux chapitres 1, 2 et 3 de la partie 4 du livre.
Immunité = défense de l'organisme contre les micro-organismes pathogènes, et élimination des
cellules devenues anormales (ex. cancéreuses).
La peau et les muqueuses constituent des barrières contre la pénétration des micro-organismes dans
le milieu intérieur de l'organisme. Cependant, lors d'une blessure accidentelle, des micro-organismes
peuvent franchir ces barrières ; notre organisme doit alors les éliminer. De plus, notre organisme doit
aussi empêcher la prolifération de micro-organismes pathogènes dans les cavités naturelles (tube
digestif, voies respiratoires, urinaires, génitales...). (voir "L'infection microbienne", p. 284).
Suite à une première rencontre avec un antigène (= micro-organisme
reconnu comme pathogène par l'organisme, ou molécule provenant
d'un tel micro-organisme), les lymphocytes B produisent des
immunoglobulines (anticorps) spécifiques dirigées contre cet
antigène. Lors d'une deuxième rencontre avec le même antigène, la
production d'anticorps sera beaucoup plus efficace et plus rapide
(c'est le principe de la vaccination, voir doc. ci-contre). On parle
d'immunité adaptative (une immunoglobuline donnée, spécifique
d'un antigène, ne commence à être produite par les lymphocytes
qu'à partir du moment où notre organisme a été effectivement
confronté à cet antigène naturellement ou du fait d'une vaccination).
Seuls les Vertébrés possèdent des lymphocytes, notamment des lymphocytes B, et produisent
des immunoglobulines. Cependant, Insectes, Mollusques, et plus généralement tous les animaux
possèdent des mécanismes de défense contre les micro-organismes pathogènes, de même que les
nouveaux-nés de Vertébrés qui ne sont pourtant pas encore capables de produire des
immunoglobulines. On parle d'immunité innée (= ensemble des mécanismes de défense présents
dès la naissance, non spécifiques d'un antigène et communs à la plupart des animaux). (voir
doc. 3 p. 291)
Comment fonctionne l'immunité innée ? Quels sont les liens entre mécanismes de l'immunité innée et
de l'immunité adaptative ?
Mots et expressions-clés du chapitre 10 selon le programme officiel :
–organes lymphoïdes
–macrophages, monocytes
–granulocytes
–phagocytose
–mastocytes
–médiateurs chimiques de l'inflammation
–réaction inflammatoire
–médicaments anti-inflammatoires
–cellules dendritiques.
1

Chapitre 10 – L'immunité innée. Un exemple : la réaction inflammatoire
I. La réaction inflammatoire, première ligne de défense
1. La reconnaissance du pathogène comme étranger
La plupart des micro-organismes possèdent à leur surface
des molécules typiques absentes des cellules animales,
comme les lipopolysaccharides de la paroi des bactéries
Gram-négatives (doc. ci-contre, ne pas apprendre).
De plus, chez beaucoup de virus à ARN (= dont le
matériel génétique est constitué d'ARN et non d'ADN), de
l'ARN double brin est présent au moins temporairement
soit dans le virus soit lors de sa réplication dans une
cellule de notre organisme ; or il n'existe normalement pas
d'ARN double brin dans les cellules eucaryotes.
Ces molécules typiquement étrangères à notre
organisme sont "ciblées" par des récepteurs TLR
présents à la surface des cellules de l'immunité innée
(macrophages et mastocytes notamment).
Différents types de récepteurs TLR
reconnaissent différents types de molécules
typiquement microbiennes (activité 23 et doc. 1
p. 294). Ces récepteurs TLR ont été très
conservés au cours de l'évolution des
Vertébrés et sont semblables d'une espèce à
l'autre (activité 23 et doc. 4 p. 291) ; des
récepteurs semblables sont même présents chez les Insectes et les végétaux verts : ils étaient donc
déjà présents chez l'ancêtre commun aux animaux et aux végétaux verts.
2. Destruction du pathogène par phagocytose
La reconnaissance du micro-organisme comme étranger induit sa destruction par phagocytose : il
est séquestré dans une vésicule (phagosome) qui fusionne avec des vésicules cytoplasmiques
(lysosomes) contenant enzymes, peptides antimicrobiens (protéines semblables à des
antibiotiques), voire des oxydants puissants. Le pathogène est ainsi détruit.
Les cellules de l'immunité innée normalement présentes dans les tissus (macrophages, mastocytes,
cellules dendritiques) ne sont cependant pas assez nombreuses pour assurer la destruction totale des
micro-organismes. Ils appellent à la rescousse d'autres cellules, notamment des granulocytes, grâce à
la réaction inflammatoire. Schéma à connaître (sera fait en classe)
3. Médiateurs de l'inflammation et déclenchement de la réaction
Les mastocytes et macrophages présents sur place et ayant phagocyté des particules reconnues
comme étrangères (micro-organisme ou virus) sécrètent différentes molécules médiatrices de
l'inflammation : cytokines pro-inflammatoires et prostaglandines notamment (et histamine pour les
mastocytes). Voir schéma activ. 23
Ces molécules provoquent une vasodilatation (élargissement des capillaires sanguins dans la zone
concernée, d'où la rougeur), une fuite du plasma sanguin hors des capillaires (le liquide s'accumule
sur place d'où un gonflement de la zone ou œdème). Les prostaglandines stimulent les récepteurs
de la douleur (nocicepteurs), d'où les picotements ou la sensation de douleur.
2
paroi
membrane plasmique
cytosol
chromosome
Une bactérie (schéma simplifié)

4. La mobilisation des phagocytes
Les médiateurs de l'inflammation provoquent l'adhérence, dans la
zone d'inflammation, entre les phagocytes (granulocytes notamment)
circulant dans le sang et la paroi des capillaires (endothélium). Les
granulocytes traversent alors la paroi du capillaire sanguin
(diapédèse) et se dirigent vers le lieu de l'infection, où ils vont
phagocyter activement les micro-organismes.
II. La réaction inflammatoire, préalable à la réponse
immunitaire adaptative
1. Les cellules dendritiques
Les cellules dendritiques
(découvertes dans les années 1970
et ayant donné lieu à un prix Nobel
en 2011) sont des sentinelles
postées dans les organes : elles y
séjournent plusieurs semaines ou
mois. Quand elles reconnaissent
une particule étrangère, elles la
phagocytent, puis en présentent
des fragments à leur surface :
elles deviennent ainsi des cellules
présentatrices d'antigène (CPA).
Les macrophages également
deviennent des CPA, mais leur rôle
est moins important. (doc. 1 p. 296
et 2 p. 297 en bas)
Les cellules dendritiques pénètrent alors dans un vaisseau lymphatique
et le suivent, portées par la circulation lymphatique, jusqu'à arriver dans
le plus proche ganglion. Là, elles entrent en contact avec des
cellules responsables de l'immunité adaptative : des lymphocytes.
(doc. 2 p. 297).
Les fragments peptidiques étrangers présentés à la surface des
cellules dendritiques et des
macrophages sont associés à
des molécules du CMH
(complexe majeur
d'histocompatibilité). Voir
schéma page suivante.
Le système lymphatique comprend :
- les vaisseaux lymphatiques qui
ramènent, dans la circulation
sanguine, la lymphe interstitielle ;
- divers organes et tissus
lymphatiques (ganglions
lymphatiques, rate, amygdales...)
disséminés à des endroits
stratégiques dans l'organisme. Ces
organes abritent les phagocytes et
les lymphocytes, agents essentiels de
la défense de l'organisme.
3

2. Activation en retour du processus de phagocytose
Si un lymphocyte T CD4 reconnaît le fragment peptidique qui lui est
présenté par une cellule présentatrice d'antigène, il s'active et
devient un lymphocyte T CD4 auxiliaire (voir diaporama, diapo 41) ;
il se met alors à produire des cytokines. Lors de rencontres ultérieures
avec des phagocytes présentant le même fragment peptidique
étranger, les cytokines produites par le LT CD4 auxiliaire
activeront le processus de phagocytose dans ces phagocytes.
III. Les médicaments anti-inflammatoires
Dans les mastocytes et macrophages, les prostaglandines sont
synthétisées par la voie indiquée ci-contre. L'intervention
successive de deux enzymes est nécessaire :
la phospholipase et la cyclo-oxygénase.
Tous les médicaments anti-inflammatoires
inhibent l'une ou l'autre de ces enzymes :
– les corticoïdes anti-inflammatoires
("cortisone" dans le langage courant)
inhibent la phospholipase : elles
diminuent considérablement son activité ;
– les anti-inflammatoires non-stéroïdiens
(aspirine, ibuprofène) inhibent la cyclo-
oxygénase.
Les médicaments anti-inflammatoires diminuent donc la synthèse de prostaglandines, et ainsi
limitent l'inflammation et diminuent la sensation de douleur.
Conclusion du chapitre
La réaction inflammatoire constitue une première ligne de défense contre l'infection, présente
chez tous les animaux, et ce dès la naissance (innée). Elle implique des cellules phagocytaires
reconnaissant des molécules présentes chez un grand nombre de micro-organismes et absentes des
cellules eucaryotes, grâce à des récepteurs (TLR) très conservés chez les animaux.
Les cellules dendritiques (et les macrophages) font ensuite la jonction avec l'immunité adaptative :
grâce aux molécules du CMH, ils présentent des fragments peptidiques provenant du micro-
organisme qu'ils ont phagocyté. Cela aboutit à l'activation des lymphocytes T CD4 qui, en retour,
activent le processus de phagocytose.
L'inflammation est un processus utile : il ne faut pas prendre de corticoïdes en cas d'infection. Mais
si elle devient excessive, l'inflammation peut être gênante voire dangereuse. Les médicaments
anti-inflammatoires sont alors utiles.
4
phospholipides membranaires
corticoïdes phospholipase (enzyme)
anti-inflammatoires
acide arachidonique
anti-inflammatoires cyclo-oxygénase (enzyme)
non stéroïdiens (AINS)
prostaglandines
Voie de synthèse des prostaglandines et mode d'action
des médicaments anti-inflammatoires
Un signe signifie que le médicament inhibe l'enzyme
-
-
-

Complément : principaux constituants du sang
On centrifuge 10 mL de sang, rendu incoagulable, dans un tube gradué. La
lecture du volume du culot globulaire (globules qui ont sédimenté au fond du
tube) permet la détermination des volumes relatifs des cellules et du plasma :
–les hématies (= globules rouges) occupent un peu moins de 50 %
du volume total du sang ; ce taux, variable d'un individu à l'autre et
selon les conditions de vie, est appelé hématocrite.
–Le plasma occupe les 50 % restants.
–Les leucocytes (= globules blancs) et les plaquettes (fragments de
cellules participant à la coagulation du sang) occupent un très petit
volume.
Le plasma sanguin est constitué d'eau et de nombreuses substances
dissoutes (ou transportées par des protéines) dont :
–des ions minéraux (Na+, Cl-, mais aussi HCO3- provenant de la
dissolution du dioxyde de carbone, etc);
–des protéines (protéines de transport, anticorps, protéines permettant
la coagulation du sang, etc);
–du glucose, des lipides, des acides aminés;
–de l'urée (un déchet du métabolisme azoté; les reins "filtrent" le sang
et éliminent l'urée dans l'urine : urine = eau + urée dissoute) ;
–des hormones; etc.
N.B. Le sérum est le liquide qui surnage quand on a laissé coaguler du sang. Il a la même composition que le plasma sanguin, moins les
protéines qui participent à la coagulation du sang.
5
1
/
5
100%