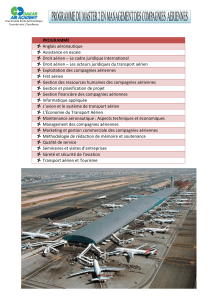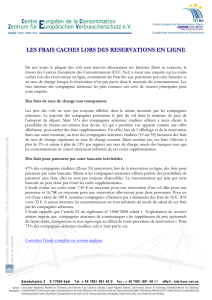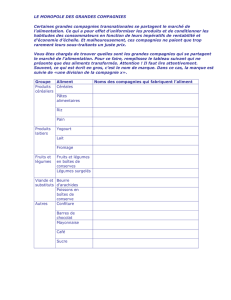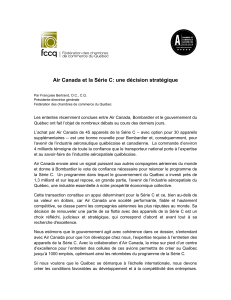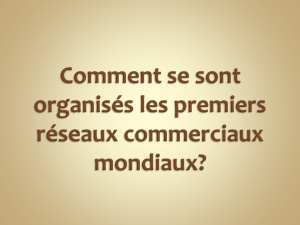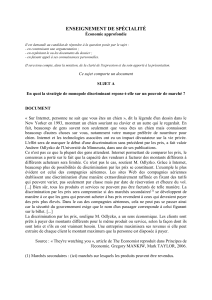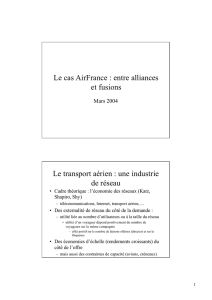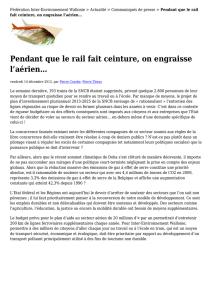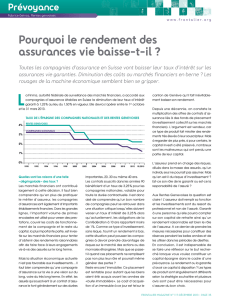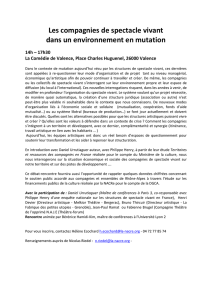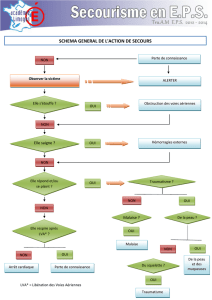Les progrès, problèmes et perspectives du transport aérien en Afrique

Distr.: LIMITEE
ECA/TRID/08/03
15 Mai 2003
NATIONS UNIES
COMMISSION ECONOMIQUE POUR L’AFRIQUE Original: FRANCAIS
Réunion du comité sur l’intégration régionale
Addis Abeba, Ethiopie
Octobre 2003
Les progrès, problèmes et perspectives
du transport aérien en Afrique

2
Les progrès, problèmes et perspectives du transport aérien
en Afrique
I. Introduction
La libération économique du transport commencée aux Etats Unis dans
les années 79 s’est poursuivie dans toutes les régions du monde y compris
l’Afrique. Cette libéralisation couplée avec la globalization a provoqué des
changements profonds dans l’industrie aéronautique mondiale. Au niveau
africain, grâce aux efforts conjugués de la CEA, de l’Union Africaine, de la
CAFAC, de l’AFRAA, des communautés économiques régionales, les pays
africains ont adopté et sont entrain de mettre en œuvre des politiques
appropriées de libéralisation en Afrique.
La présente note de travail fait une analyse succinte de la situation et
donne un aperçu des progrès, problèmes et perspectives de transport aérien
enregistré en Afrique depuis fin 1999, date à laquelle les Ministres africains
chargés de l’aviation civile ont adopté la Décision de Yamoussoukro relative à
la libéralisation de l’accès aux marchés de transport aérien en Afrique.
II. Les progrès
(1) Aéropolitique
En Juillet 2000, les chefs d’Etat et de gouvernement de l’OUA ont
approuvé à Lomé, Togo, la Décision relative à la libéralisation de l’accès aux
marchés de transport aérien qui avait été adoptée par la Conférence des
Ministres africains chargés de l’aviation civile en novembre 1999 à
Yamoussoukro, Côte d’Ivoire. La Décision a préséance sur tous les accords
bilatéraux et multilatéraux de transports aériens qui n’y sont pas conformes ; et
élimine de façon graduelle toutes les barrières non physiques du transport
aérien intra-africain et les restrictions liées à :
¾ L’octroi des droits de trafic et spécialement ceux de la 5ème liberté
de l’air ;
¾ La capacité des aéronefs des compagnies aériennes africaines ;
¾ La réglementation des tarifs ;
¾ La désignation des instruments d’exploitation ; et
¾ L’exploitation des vols-cargo.

3
Suite à l’adoption de la Décision par les décideurs politiques africains, les
Etats, les communautés économiques régionales et les organisations africaines
ont entrepris des efforts pour assurer sa mise en œuvre effective. Les efforts
déployés ont eu les résultats suivants :
(i) Flexibilité dans l’octroi des droits de trafic
La flexibilité dans l’octroi des droits de trafic a été traduite par la création
de nouvelles lignes♣ surtout à l’intérieur des différentes sous-régions
économiques africaines (CEDEAO, UMA, COMESA, SADC, EAC, CEN-SAD,
IGAD, etc.). Les nouvelles lignes créées sont exploitées soit par des
compagnies aériennes basées dans la sous-région où ces lignes ont été créées
soit par des compagnies aériennes africaines basées dans d’autres sous-
régions africaines dont les pays desservis par les nouvelles lignes ne sont pas
membres. Ceci est la résultante d’une flexibilité dans l’octroi des droits de la
5ème Liberté et de l’acceptation des principes de la multiple désignation des
compagnies aériennes, comme le prévoit la Décision de Yamoussoukro. C’est
ainsi que, par exemple, la nouvelle compagnie Afriquihya et Air Sénégal
International sont entrain de rapprocher l’Afrique du Nord avec les pays de
l’Afrique au Sud du Sahara. Kenya Airways et Ethiopian Airlines ont développé
plusieurs routes vers l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Cameroon Airlines a
étendu ses exploitants vers l’Afrique de l’Ouest et de l’Est en bénéficiant des
droits de trafic de 5ème Liberté. Des compagnies privées de l’Afrique Australe
telle que Inter Air sont entrain d’étendre leurs services en Afrique de l’Ouest. La
compagnie South African Airways bénéficie des avantages qui lui ont permis de
servir certaines nouvelles capitales africaines. Toutefois, des résistances ont
été rencontrées dans l’exploitation de certaines lignes, car certaines autorités
de l’aviation civile sur les influences des responsables des compagnies
aériennes concernées ont continué à gérer les droits de trafic comme le
demandent les anciens accords bilatéraux.
(ii) Accords bilatéraux de ciel ouvert
Certains pays ont signé à partir des principes de la Décision de
Yamoussoukro, des accords bilatéraux de ciel ouvert qui vont au-delà de la
Décision ; c’est le cas par exemple de l’Ethiopie et de d’Afrique du Sud ; du
Kenya et de l’Ouganda.
(iii) Réduction des tarifs
Il a été par exemple constaté qu’en Afrique de l’Ouest, certains tarifs ont
baissé de près de 30% sur les lignes où il existe une compétition créée grâce à
la libéralisation de l’accès aux marchés de transport aérien. En outre, les
usagers disposent sur certaines destinations de plusieurs gammes tarifaires.
♣ Voir Tableau 1.

4
(iv) Développement de l’initiative du secteur privé.
Plusieurs petites compagnies aériennes privées ont été créées surtout en
Afrique de l’Ouest où jusqu’à présent, à part au Nigeria, le secteur privé ne
s’était pas intéressé au transport aérien. C’est le cas d’Air Togo, Air Bénin, de la
nouvelle société Air Burkina, etc. Il y a eu aussi des investissements trans-
frontières comme le cas d’Air Sénégal et de Royal Air Maroc ; d’Air Mali SA et
d’une société Egyptienne ; la prise de la participation d’une partie du capitale
d’Air Tanzanie par la compagnie South African Airlines (SSA), etc. En Afrique
du Nord, des nouvelles compagnies aériennes avec la participation du secteur
privé telle que Khalifa Airways ont aussi vu le jour. L’émergence de ces petites
compagnies aériennes a introduit la compétition sur certaines lignes aériennes
jusque là opérées par les compagnies nationales. Cette compétition a entraîné
dans certains cas l’amélioration des services et la réduction des prix des billets.
(2) Facilitation des opérations
Plusieurs pays n’ayant pas de compagnie aérienne dont par exemple le
Nigeria, ont conclu des accords de coopération avec des compagnies aériennes
africaines et les ont désignés comme compagnie éligible. Ceci est une preuve
de l’application de la politique de désignation indiquée dans la Déclaration.
Cette politique a entraîné une fluidité dans l’exploitation de certaines lignes et a
augmenté le nombre des dessertes aériennes donnant ainsi aux usagers la
possibilité de voyager les jours et périodes de leur convenance.
(3) La crainte des compagnies aériennes
Les compagnies aériennes, surtout de moyenne taille, ayant bénéficié de
la protection des gouvernements depuis leurs créations, et craignant pour leurs
survies en cas de compétition, ont demandé l’élaboration de règles de
compétition afin d’assurer leur protection. Ainsi, les CERs telles que COMESA,
SADC, EAC ont assisté les pays de leurs sous-régions à élaborer des règles de
compétition qui ne sont pas encore approuvées. Cette situation risque de faire
retarder la mise en œuvre de la Décision.
(4) Développement de l’industrie des compagnies aériennes
africaines
En 2001, les compagnies aériennes membres de l’AFRAA♣ ont
transporté 32,4 millions de passagers soit une augmentation de 2,8% par
rapport à 2000. Le trafic domestique a atteint pendant la même année 13
♣ Rapport Sec. Gen AFRAA 2002

5
millions de passagers soit une augmentation de 7,9% par rapport à la
précédente année. Le trafic intra-africain a, quant à elle, augmenté de 7,5% et
ceci grâce à la politique de libéralisation prônée par la Décision de
Yamoussoukro.
Le transport de fret a subi un déclin par rapport à 2000, passant de
494.300 tonnes à 469.300 tonnes. Ceci était dû au déclin de l’économie
mondiale et à la disparition de la compagnie aérienne Air Afrique qui assurait,
grâce au monopole, la majorité de l’exploitation du trafic fret dans 11 pays
africains.
Les chiffres disponibles sur 10 compagnies aériennes montrent une
augmentation de 6,2% des recettes d’exploitation qui sont passées de 3,9 à 4,2
milliards de dollars de l’an 2000 à 2001, tandis que les coûts d’exploitation sont
passés pour la même période de 3,91 à 4,05 milliards de dollars soit 3,4%
d’augmentation. L’industrie aéronautique africaine de ces 10 compagnies
aériennes était en déficit.
Le tableau ci-dessous indique l’évolution des paramètres de libéralisation
enregistrée dans les pays qui ont répondu aux questionnaires de la CEA.
Tableau 1 : Evolution des paramètres de libéralisation
Pays Nbre
nvelles
demand
es de
licence
et de
ddes de
nvelles
compag
nies
Nbre
nvelle
s
lignes
Aug.
Frequen
ces de
1999 a
2002
Sur
totales
lignes
Nveau
tarif Aug. Pax
entre Aug fret
entre Nbre
routes
opéré
es en
5ème
liberté
Observa
tions
2000/
1999 2001/
2000 2000/
1999 2001/
2000
Burkina
Faso 2 6 3 2 -11,9% -4,8% -26,7% 5,9% 5
Cameroun 4 2 2 Nil 9,5% 8,8% 5,5% 5,5% NA
Cape Vert 4 7 2 7 -3,7% 44,0% 7
Congo 7 7 4 21,7% -34,0% NA
Gambie 7 5 7 7 2,9% -7,2% 9,3% 47,7% 04
Guinée 9 8 17 ---- -18,4% 0,8% -47,7% -40,0% 7
Maurice Nil Nil Nil Nil 7,2% ---- -7,3% Nil
Mauritanie 5 9 --- ---- --- 2
Nigeria 7 2 5 Nil -13,8% 94,0% 31,5% 38,4% 4
Sénégal 15 4 41 2,97% ---- 04
Tanzanie 0 0 8 0 33,1% -22,5% 450,6% -9,6%
Source : UNECA
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%