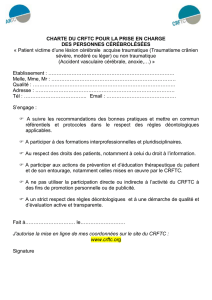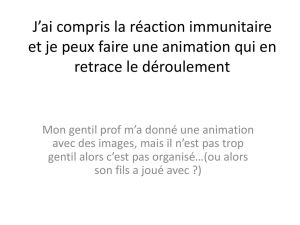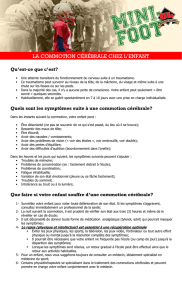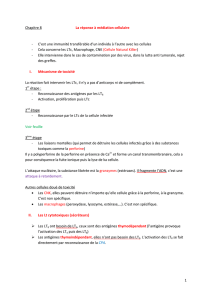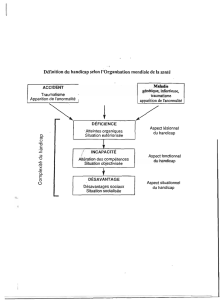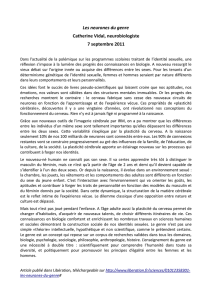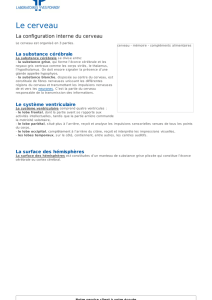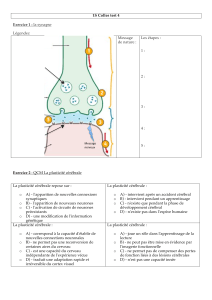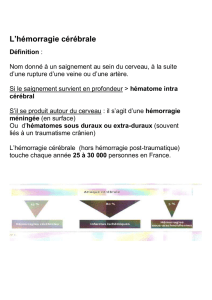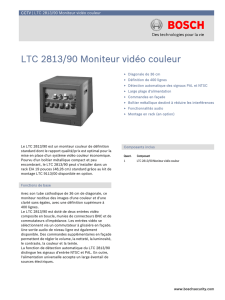La lésion traumatique cérébrale (LTC)

La lésion traumatique cérébrale
Document de travail à l’intention du
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et
de l’assurance contre les accidents du travail
mai 2004
préparé par le
Dr J.F.R. Fleming
Professeur émérite, division de neurochirurgie
Université de Toronto
Division de neurochirurgie, Toronto Western Hospital,
Réseau universitaire de santé
Version révisée en juillet 2013 par le
Dr David W. Rowed, BA, MD, FRCSC
Professeur émérite
département de chirurgie, division de neurochirurgie
Université de Toronto
Le Dr J.F. Ross Fleming a obtenu son doctorat de la faculté de médecine de l’Université
de Toronto en 1947. Il a fait des études postdoctorales en neurochirurgie de 1947 à
1956 à l’Université de Toronto, à la University of Michigan et à Oxford en Angleterre.
Il a obtenu son certicat en neurochirurgie et est devenu associé du Collège royal
des médecins et chirurgiens en 1956. Il occupe une chaire de professeur émérite à la
division de neurochirurgie du département de chirurgie de l’Université de Toronto. Il
s’intéresse à la pratique clinique et à la recherche dans le domaine de la neurochirurgie.
Il a publié de nombreux ouvrages sur le sujet. Il a pratiqué à la division de neurochirurgie
du Toronto Western Hospital de 1956 à 1996, et il a exercé les fonctions de chef de cette
division de 1965 à 1984. Le Dr Fleming a rempli différentes fonctions au Tribunal :
il a été assesseur de 1988 à 1992, conseiller médical de 1993 à 1997 et président du
groupe des conseillers médicaux de 1998 à 2006.

La lésion traumatique cérébrale (LTC)
Le Dr David Rowed a obtenu son diplôme de l’Université de Western Ontario (B.A.
1962, M.D. 1966). Il a fait des études postdoctorales en médecine interne à l’Université
de l’Alberta et, en neurochirurgie, à l’Université de Western Ontario, à l’Université
de Toronto et à la University of Chicago. Il est devenu associé en neurochirurgie du
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada en 1973. Après des stages de
perfectionnement à la Medical University of South Carolina et à la University of Glasgow,
il s’est joint à la division de neurochirurgie du Sunnybrook Health Sciences Centre à
Toronto et au corps professoral du département de chirurgie, division de neurochirurgie,
de l’Université de Toronto en 1974. Il est membre du département de chirurgie, division
de neurochirurgie, et du département d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-
faciale du Sunnybrook Health Sciences Centre à Toronto. Il a été chef de la division
de neurochirurgie et chef adjoint du département de chirurgie de même que directeur
médical de l’unité des soins intensifs de neurochirurgie du Sunnybrook Health Sciences
Centre. Il est actuellement professeur émérite au département de chirurgie, division
de neurochirurgie, de l’Université de Toronto. Le Dr Rowed s’intéresse principalement
aux traumatismes crâniens, à la chirurgie cérébrovasculaire, à la chirurgie pratiquée
sur les tumeurs situées à la base du crâne et à la surveillance neurophysiologique
peropératoire. Il a publié de nombreux ouvrages dans ces domaines. Il est conseiller
médical du Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les
accidents du travail depuis 2006.
Ce document de travail médical sera utile à toute personne en quête de renseignements
généraux au sujet de la question médicale traitée. Il vise à donner un aperçu général d’un sujet
médical que le Tribunal examine souvent dans les appels.
Ce document de travail médical est l’œuvre d’un expert reconnu dans le domaine, qui a été
recommandé par les conseillers médicaux du Tribunal. Son auteur avait pour directive de
présenter la connaissance médicale existant sur le sujet, le tout, en partant d’un point de vue
équilibré. Les documents de travail médicaux ne font pas l’objet d’un examen par les pairs, et ils
sont rédigés pour être compris par les personnes qui ne sont pas du métier.
Les documents de travail médicaux ne représentent pas nécessairement les vues du Tribunal.
Les décideurs du Tribunal peuvent s’appuyer sur les renseignements contenus dans les
documents de travail médicaux mais le Tribunal n’est pas lié par les opinions qui y sont
exprimées. Toute décision du Tribunal doit s’appuyer sur les faits entourant le cas particulier visé.
Les décideurs du Tribunal reconnaissent que les parties à un appel peuvent toujours s’appuyer
sur un document de travail médical, s’en servir pour établir une distinction ou le contester à l’aide
d’autres éléments de preuve. Voir Kamara c. Ontario (Workplace Safety and Insurance Appeals
Tribunal) [2009] O.J. No. 2080 (Ont Div Court).
Traduit de l’anglais par Claude Filteau, trad. a.
Membre de l’Association des traducteurs et interprètes de l’Ontario (ATIO)

La lésion traumatique cérébrale (LTC)
1
LA LÉSION TRAUMATIQUE CÉRÉBRALE (LTC)
Une lésion traumatique cérébrale (LTC) est une perturbation des fonctions cérébrales
normales causée par une force mécanique externe. La force peut être transmise au
cerveau par suite d’un impact au crâne, à la mâchoire ou au corps. Les contraintes de
cisaillement sur le cerveau et les vaisseaux sanguins, qui résultent d’une accélération
ou d’une décélération soudaine et souvent rotationnelle de la tête, sont responsables
de la majeure partie des dommages.
La LTC peut guérir complètement de façon spontanée ou produire une invalidité
grave, voire même entraîner la mort. Globalement, les chutes sont les principales
causes de LTC, surtout chez les personnes jeunes (de moins de 14 ans) et âgées
(de 65 ans et plus). Les accidents de véhicule motorisé sont au deuxième rang des
causes de LTC et au premier rang des causes de décès chez les jeunes adultes. Les
deux tiers des LTC surviennent chez des hommes, mais des lésions paraissant de
même gravité peuvent évoluer de façon plus défavorable chez les femmes que chez
les hommes. La pratique de sports et les voies de fait sont d’autres causes fréquentes
de traumatisme crânien.
En milieu de travail, les causes de LTC sont entre autres les chutes, les chutes
d’objets et les accidents de véhicule motorisé ou de machine. Les secteurs
professionnels présentant le plus de risques sont la construction, le transport,
l’agriculture, la foresterie, la pêche et les services médicaux d’urgence. Vingt pour cent
des lésions en milieu de travail seraient attribuables à des chutes sur des surfaces
inégales ou mouillées ou causées par des objets qui ne sont pas à leur place, et elles
semblent donc évitables en grande partie.
Les traumatismes cérébraux peuvent être soit « fermés », c’est-à-dire sans lésions
du cuir chevelu, soit « ouverts », c’est-à-dire accompagnés de lacérations du cuir
chevelu. Une fracture du crâne ou des lacérations de la dure-mère (la plus externe
et la plus résistante des trois membranes séparant le crâne du cerveau) peuvent y
être associées. Il peut aussi y avoir des contusions (ecchymoses) ou des lacérations
(déchirures) du cerveau. Une fracture du crâne linéaire fermée est peu importante en
soi, sauf qu’elle témoigne de l’intensité de la force exercée sur la tête. Les fractures
du crâne fermées peuvent cependant causer une embarrure (enfoncement localisé
de la voûte crânienne) qui peut léser le cerveau. Les traumatismes ouverts sont une
cause d’infections intracrâniennes, telles que la méningite, l’empyème sous-dural et
l’abcès cérébral. Les traumatismes ouverts peuvent être externes ou internes. En cas
de traumatisme ouvert interne, la fracture du crâne peut toucher les sinus paranasaux
ou les cellules pneumatiques mastoïdiennes de la base du crâne et, en association
à une lésion de la dure-mère et de la membrane arachnoïdienne, servir de voie de
contamination bactérienne et entraîner les infections intracrâniennes susmentionnées.
Les fractures du crâne peuvent aussi porter atteinte aux vaisseaux sanguins et causer
une hémorragie, ce qui peut entraîner la formation d’un caillot de sang (hématome).

La lésion traumatique cérébrale (LTC)
2
L’hématome peut être dans le cerveau lui-même (intracérébral) ou sous le crâne,
mais à l’extérieur du cerveau, soit sous la dure-mère (sous-dural) ou à l’extérieur
de la dure-mère (extradural). Comme le volume intracrânien est xe, une contusion
ou un hématome en expansion peut comprimer ou déformer le cerveau, ce qui
cause d’autres lésions. L’engagement cérébral peut exercer une pression sur le
tronc cérébral supérieur, dont une des fonctions est de maintenir l’état de veille. Les
hématomes peuvent causer une compression cérébrale aiguë (immédiate), subaiguë
ou chronique (différée).
Les contusions cérébrales peuvent survenir au point d’impact et être accompagnées
ou non d’une embarrure. Elles peuvent aussi survenir à distance d’un point d’impact
par suite du contact forcé entre la surface du cerveau et une proéminence osseuse de
la face interne du crâne causée par la transmission d’une force. Les lésions au côté
opposé à celui du point d’impact sont appelées « lésions par contrecoup ». Les lésions
par contrecoup les plus courantes sont les contusions cérébrales et les hématomes
sous-duraux et épiduraux.
Une LTC peut causer une enure du cerveau (œdème cérébral) en raison de la
perturbation de la fonction des cellules qui tapissent les petits vaisseaux sanguins
(barrière hématoencéphalique), ce qui entraîne la fuite de protéines et d’eau dans
le cerveau. L’enure peut toucher l’ensemble ou la majeure partie du cerveau
(œdème généralisé) ou être limitée (œdème focal), par exemple en association à une
contusion. Comme le crâne est une boîte fermée, l’œdème porte atteinte aux fonctions
cérébrales en comprimant les vaisseaux sanguins, ce qui réduit la perfusion sanguine,
et en refoulant certaines parties du cerveau, un peu à la façon de caillots de sang,
ce qui entraîne des décits neurologiques. Les décits neurologiques attribuables
à un hématome intracrânien, à une contusion ou à un œdème cérébral peuvent se
manifester ou évoluer de façon différée, après un intervalle asymptomatique.
La lésion axonale diffuse (LAD) résulte des forces de cisaillement perturbant
les prolongements des cellules nerveuses (axones) grâce auxquels ces cellules
communiquent entre elles et forment des réseaux. Ce type de traumatisme crânien
fermé peut entraîner des décits neurologiques graves si les forces de cisaillement
sont importantes.
Pour diverses raisons, il est difcile de déterminer avec certitude l’incidence réelle de
la LTC. Souvent, les traumatismes crâniens fermés ne mènent pas à la consultation
d’un médecin ni à l’hospitalisation. Par ailleurs, les critères d’enregistrement des
traumatismes crâniens sont variables. En outre, d’autres lésions peuvent masquer
un traumatisme crânien connexe. La taille de la population à risque peut ne pas
être déterminée avec exactitude. L’incidence annuelle connue de la LTC au Canada
est d’environ 50 pour 100 000 personnes, mais l’incidence réelle est presque
certainement plus élevée.
La gravité de la LTC va de légère (LTCL) – la guérison étant en apparence totale dans
la plupart des cas – à grave – entraînant un décit neurologique permanent, un coma

La lésion traumatique cérébrale (LTC)
3
prolongé ou la mort. Pour comprendre l’invalidité persistante résultant de la LTC, il faut
déterminer la gravité de la lésion initiale et établir une corrélation avec l’état du patient
au moment où le degré de guérison est maximal. Les traumatismes sont légers,
modérés ou graves.
Les traumatismes crâniens modérés et, en particulier, les traumatismes crâniens
graves donnent lieu à des résultats d’examens neurologiques et radiologiques
tels qu’il n’est habituellement pas difcile de leur attribuer une invalidité prolongée.
On ne peut pas traiter un traumatisme direct au cerveau produit par un impact,
mais il peut y avoir une certaine amélioration de l’état du patient avec le temps.
L’amélioration du devenir du patient dépend en partie de la prévention et du traitement
des troubles qui entraînent des traumatismes cérébraux secondaires en entravant
l’apport de sang et d’oxygène au cerveau. Certains traumatismes exigent un
traitement neurochirurgical d’urgence, par exemple pour l’évacuation d’un hématome
intracrânien, tandis que d’autres peuvent exiger un traitement médical intensif, par
exemple pour tenter d’assécher l’œdème cérébral post-traumatique. Des mesures
comme l’hyperventilation modérée, qui réduit la concentration de gaz carbonique dans
le sang, et partant, le volume sanguin intracrânien, ou l’administration de diurétiques
pour réduire la quantité d’eau présente dans le cerveau, se sont révélées utiles pour
atténuer l’œdème cérébral ou pour gagner du temps en attendant que l’hématome
puisse être retiré.
On est constamment à l’affût de nouvelles modalités de traitement. On a par exemple
récemment signalé que la progestérone s’était révélée prometteuse pour réduire
la mortalité et l’invalidité associées aux traumatismes cérébraux. Les résultats sont
toutefois préliminaires et il faudra pousser la recherche.
Les traumatismes crâniens graves peuvent entraîner un coma prolongé, une invalidité
permanente ou la mort, et ce, malgré un traitement intensif. Certaines données
semblent indiquer, chez les victimes de traumatismes crâniens graves, une corrélation
entre une amnésie post traumatique (APT) relativement longue, soit une perte partielle
ou totale de la mémoire des événements suivant la LTC, et de mauvais résultats
cliniques. Il faut toutefois souligner que cela ne s’applique qu’aux cas de traumatismes
graves. Par exemple, au cours d’une étude, plus de 60 % des patients qui avaient
présenté une APT de deux à quatre semaines avaient repris leurs activités productives
un an après le traumatisme, tandis que, dans les cas où l’APT avait duré plus de 70
jours, les chances de reprise des activités productives après un an étaient de moins
de 20 %.
Toutefois, comme il est souvent plus difcile de déterminer si une lésion traumatique
cérébrale légère (LTCL) peut être à l’origine d’une invalidité prolongée, nous nous
attarderons surtout sur celles-ci.
Depuis 1974, l’instrument le plus utilisé pour l’évaluation normalisée des traumatismes
crâniens est l’échelle de Glasgow. Les dossiers médicaux font souvent état de
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%