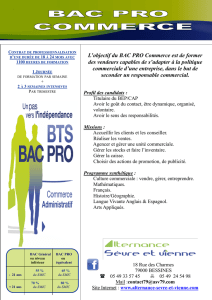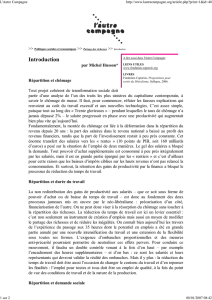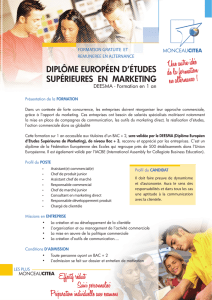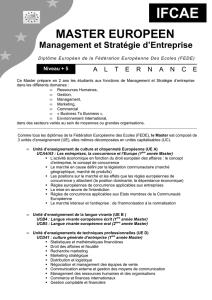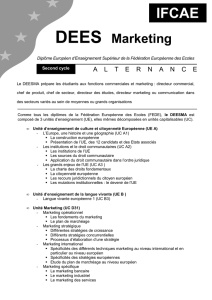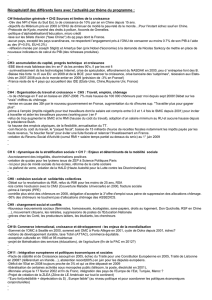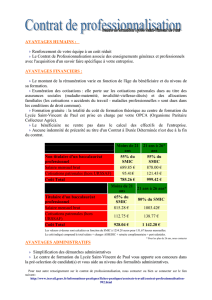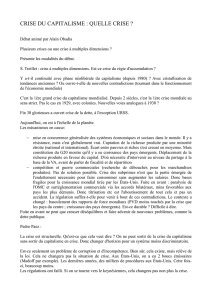Recension - Hussonet

Recensions
Michel HUSSON
Un pur capitalisme
Lausanne, Page 2, Collection Cahiers Libres, 2008, 206 pages
L’ouvrage de Michel Husson se présente comme une
série d’articles articulés autour d’une thèse centrale
clairement explicitée dès les premières lignes du
livre. Il s’agit de montrer que « le capitalisme
contemporain tend vers un fonctionnement pur, en
se débarrassant progressivement de toutes les
« rigidités » qui pouvaient la réguler ou l’entraver
(…) et ce à travers deux grandes tendances : la
« remarchandisation » de la force de travail et la
formation tendancielle d’un marché mondial » (p. 9).
Michel Husson nous propose ainsi un ensemble de
réflexions critiques sur l’état et le devenir du
capitalisme mondial, non sans évoquer leurs
conséquences sur la dégradation des conditions de
vie des salariés. Prenant acte de l’affirmation de ces
transformations, il réfléchit ensuite à la construction
d’alternatives, élaborées essentiellement pour la
France, et fondées notamment sur l’augmentation
des revenus du travail (et en particulier du SMIC),
mais aussi sur la poursuite de la diminution du
temps de travail et sur la taxation des revenus du
capital.
La première partie de l’ouvrage intitulée « le capital-
monde » a pour ambition d’offrir un état des lieux du
capitalisme contemporain caractérisé par la « hausse
tendancielle du taux d’exploitation », – c’est-à-dire
dans les termes de la statistique nationale du taux
de marge –. L’auteur montre très clairement que la
part de la richesse nationale revenant aux détenteurs
de capital s’accroît au détriment de celle revenant
aux salariés. Cette hausse tendancielle des taux
d’exploitation et de profit s’explique par la
dégradation de la position des travailleurs dans les
rapports de forces sociales suite essentiellement à
l’affirmation de la finance, à la mobilité accrue du
capital, à l’abandon des politiques keynésiennes et à
la persistance d’un chômage de masse. En outre, et
compte tenu de l’imbrication croissante des
économies nationales, l’auteur précise que la
« mondialisation capitaliste, [qui] vise
essentiellement à la constitution d’un marché
mondial et à la mise en concurrence directe des
travailleurs, tend à établir des normes salaires et la
rentabilité » (p. 43) et qui exercent une pression à la
baisse sur les conditions d’existence de cette classe.
Pour compléter ses explications relatives à une telle
dégradation du rapport de forces sociales, Michel
Husson s’intéresse ensuite aux conséquences de la
montée des pays dits émergents. Il souligne qu’une
nouvelle répartition géographique des richesses
mondiales se fait désormais, et ce de plus en plus au
détriment des pays de la Triade, mais au profit de la
Chine et de l’Inde notamment. Il complète son
panorama de l’économie monde en s’intéressant à la
situation de deux pays phares de la mondialisation
actuelle. La Chine tout d’abord, dont il nous décrit les
grands axes de son développement, non sans
souligner également ses limites, potentiel facteur
d’essoufflement de la croissance économique
mondiale future. Les États-Unis ensuite dont la
« suprématie repose sur la capacité à drainer un flux
permanent de capitaux venant financer son
accumulation et reproduire les bases technologiques
de cette domination » (p. 45). Mais cet impérialisme
étatsunien, désigné comme « prédateur », est
également précaire et instable compte tenu du
niveau de la dette extérieure de ce pays.
La seconde partie de l’ouvrage est consacrée aux
« contraintes du profit » et vise à faire la critique de
certaines thématiques en vogue actuellement.
L’auteur y montre que ni la flexibilité, ni les mesures
destinées à alléger le coût du travail ne se sont
traduites par une relance de la croissance ou par une
résorption du chômage. Ces politiques n’ont fait
qu’amplifier une répartition des revenus défavorable
aux salariés et ont contribué à accentuer le dualisme
du marché du travail. Une dernière idée préconçue
est battue en brèche, celle de la dette publique,
prétexte contemporain aux réformes ou plutôt au
progressif démantèlement de l’État et de la Sécurité
sociale. L’auteur explique que l’origine de la dette de
l’État doit être majoritairement attribuée à la
diminution des recettes fiscales causée
essentiellement par la diminution des impôts sur le
capital ou sur les revenus les plus élevés. Les
avantages fiscaux octroyés aux plus riches ont eu
une double conséquence : la première est que les
déficits se sont mécaniquement creusés. La seconde
est que ces mesures destinées aux plus riches, n’ont
stimulé ni la consommation ni la croissance, mais
ont, au contraire, favorisé l’épargne. L’auteur
propose donc qu’un prélèvement exceptionnel soit
mis en place sur les patrimoines les plus élevés pour
résorber les déficits et contrecarrer l’accroissement
de la dette.
Dans une troisième partie, Michel Husson revient sur
les débats relatifs à la fin du travail pour en critiquer
ses partisans. Réaffirmant que seul le travail est à
l’origine de la valeur et de la production de richesses,
l’auteur souligne notamment que « la montée du
chômage n’est pas le résultat mécanique de
l’évolution de la productivité. Elle résulte de la non-
redistribution des gains de productivité aux salariés
que ce soit sous forme de progression du pouvoir
d’achat ou de réduction du temps de travail »
(p.115-116). Il revient ensuite sur la question de
l’instauration d’un revenu universel et évoque ses
probables conséquences sur la partition de la société,
entre ceux qui ont un emploi et ceux qui ne
disposeraient (que) du revenu universel. Il pose
également la question des conséquences de la mise
en place d’un tel revenu qui pourrait participer à
l’asservissement des femmes en apparaissant
comme un revenu familial ou maternel déguisé.
C’est la raison pour laquelle l’auteur réaffirme la
nécessaire revendication d’un emploi pour tous,
fondement essentiel des droits sociaux. Cette
proposition n’est que la première de sa
« construction d’alternatives » visant à dépasser
l’esclavage salarié en soumettant le capital aux
droits des travailleurs et en valorisant la poursuite de
la diminution du temps de travail. Michel Husson est

ainsi amené à appeler de ses voeux une
« démarchandisation » de la force de travail, qui
s’opèrerait notamment par l’affirmation d’un droit à
l’emploi et à la continuité du revenu, par la
contestation de l’actuelle répartition des richesses,
par l’exigence d’une baisse du temps de travail avec
embauches proportionnelles, par le contrôle des
salariés sur l’embauche et les conditions de travail,
et par le refus du pouvoir patronal sur l’emploi et les
conditions de travail. Il s’agirait ainsi d’être « Tous
salariés, pour abolir le salariat », c’est-à-dire de
promouvoir la socialisation de l’emploi. Reste une
question en suspend que l’auteur n’aborde pas : de
qui serions-nous alors les salariés ? Sans doute d’un
État ? Mais cette situation signerait-elle alors
réellement la libération des salariés ?
Michel Husson propose en tout cas un programme de
transformation sociale fondé sur la continuation des
35 heures et sur la redistribution des richesses en
s’attaquant à la fois aux revenus financiers par la
fiscalité directe et par l’augmentation des salaires.
L’auteur est ainsi amené à réaffirmer l’idée que la
croissance doit être soutenable et utile en
permettant la satisfaction des besoins sociaux les
plus urgents. Il propose donc à la fois l’instauration
d’un SMIC à 1500 euros indexé sur la progression
moyenne de la productivité du travail par tête, mais
aussi la mise en place de minima sociaux unifiés,
portés à 1200 euros (80 % du SMIC et indexés sur la
progression du SMIC). Il évalue le coût de ces
mesures à 235 milliards d’euros répartis sur 5 ans et
propose de le financer par une ponction sur les
revenus financiers et par les gains de productivité
réalisés sur cette période. Il faut donc bien percevoir
que ce schéma ne postule pas une accélération de la
croissance mais plutôt un changement de son
contenu et une transformation de la répartition des
richesses produites lesquelles seraient davantage
attribuées aux revenus du travail. Mais son
programme ne s’arrête pas là puisqu’il souhaite la
mise en place des 32 heures de concert avec une
progression des salaires de 13% sur 5 ans, moyen
selon lui de résorber également le chômage.
Une série d’interrogations viennent alors à l’esprit
d’un lecteur sans doute plus fataliste que l’auteur. La
première a trait à l’aspect incitatif du niveau du SMIC
par rapport à celui des revenus minimaux. Si l’auteur
s’oppose au revenu universel, ou à des minimaux
sociaux équivalents au SMIC pour valoriser l’emploi,
la fixation de ceux-ci à 80% du SMIC laisse sceptique
surtout si le travailleur est amené à prendre en
compte la contrainte et les coûts liés directement ou
indirectement à son emploi comme les coûts de
transport. La seconde prend acte des positions de
l’auteur, et viserait à se demander si les minima
sociaux ne devraient pas avoir une contrepartie qui
pourrait prendre la forme d’un emploi d’utilité sociale
permettant à la fois de contribuer à satisfaire les
besoins sociaux les plus urgents et à revaloriser
l’emploi.
La dernière enfin porte sur le financement de ces
mesures. Si l’auteur entend taxer le patrimoine et les
revenus du capital, la mobilité du capital (et
particulièrement des patrimoines financiers) risque
de rendre la chose impossible. Même si nous avons
bien pris acte de la proposition de l’auteur,
d’exproprier les propriétaires « inciviques »
pratiquant l’évasion fiscale, même si nous
comprenons concrètement comment la mettre en
place quand il s’agit de sanctionner des propriétaires
de capitaux fixes et physiques, elle nous semble
impossible à pratiquer sur des patrimoines financiers
sans que ne soit instaurée au préalable une
coopération fiscale internationale.
Enfin l’auteur termine son ouvrage sur des questions
plus théoriques, s’interrogeant sur les raisons de la
domination de l’économie néoclassique orthodoxe et
libérale. Il est alors amené à réaffirmer l’intérêt
d’une analyse de l’économie d’inspiration marxiste,
soulignant comme il l’avait déjà laissé entendre que
le travail humain, contrairement à la finance, est à la
source de la production de valeurs et de richesses. Il
n’est donc pas étonnant que sa Postface soit
consacrée à la crise actuelle des subprimes. C’est ici
que le lecteur attendrait peut-être une réflexion sur
les moyens d’endiguer et de « réencastrer » la
finance pour éviter les crises financières. La
proposition d’une loi programmatique relative à la
taxation de la finance l’aurait ainsi intéressé. De
même, une réflexion sur l’intervention du prêteur en
dernier ressort (c’est-à-dire de l’Etat ou des autorités
monétaires), nécessaire pour endiguer les crises de
liquidités, aurait été appréciable. Elle aurait pu être
soumise à une réflexion de politique économique en
suggérant la possibilité d’une éventuelle prise de
contrôle par le prêteur en dernier ressort des
institutions bancaires ou financières bénéficiant
d’une telle intervention, ce qui permettrait alors de
limiter le risque d’aléa moral qu’un tel secours fait
traditionnellement peser.
Pour conclure, l’ouvrage est riche et offre un
ensemble d’intéressantes réflexions sur des
problématiques actuelles, tant économiques que
sociales. Il contribue ainsi au débat politique et
prouve que face à la mondialisation, une politique
économique ambitieuse qui viserait la satisfaction
des besoins sociaux est d’une part possible mais
également souhaitable.
Jean-Daniel Boyer
Université Marc Bloch, Strasbourg
Laboratoire “Cultures et sociétés en Europe”
Revue des Sciences Sociales, 2008, n° 40
1
/
2
100%