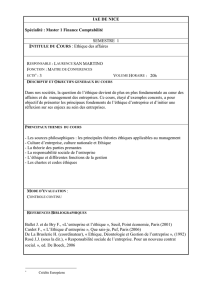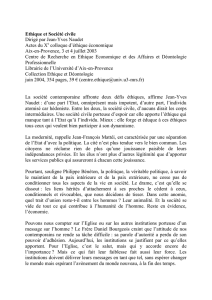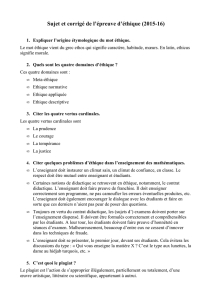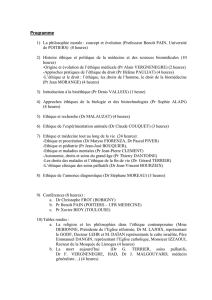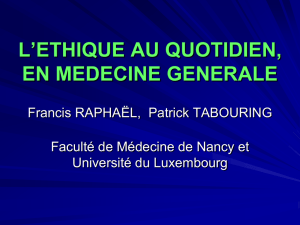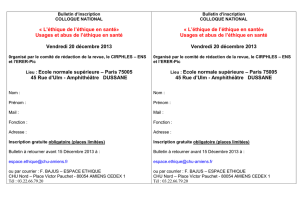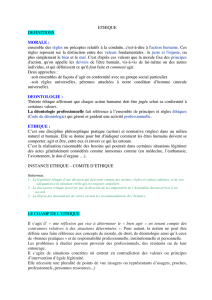Ethique et économie: médiation du politique - UNESDOC

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Organisation des Nations Unies pour l=éducation, la science et la culture
Ethique et économie :
médiation du politique
par
Henri BARTOLI
Professeur émérite en Sciences Economiques
à
l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne
Secteur des Sciences sociales et humaines

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Organisation des Nations Unies pour l=éducation, la science et la culture
Ethique et économie :
médiation du politique
par
Henri BARTOLI
Professeur émérite en Sciences Economiques
à
l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne
Programme interdisciplinaire Ethique de l’économie
Secteur des Sciences sociales et humaines
Economie Ethique N°6
SHS-2003/WS/37

Les idées et opinions exprimées dans cette publication sont celles de l’auteur et ne reflètent pas
nécessairement les vues de l’UNESCO et n’engagent pas l’Organisation.
Les appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent
n’impliquent de la part de l’UNESCO aucune prise de position quant au statut juridique des pays,
territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant à leurs frontières ou limites.
Publié en 2003 par l’Organisation des Nations Unies
pour l=éducation, la science et la culture
7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP
© UNESCO 2003
Printed in France
(SHS-2003/WS/37)

Economie Ethique N°6 i
« Le concept de l’humanisation de la mondialisation est de fait une expression
moderne des obstacles qui se dressent à l’aube du nouveau siècle, sur la voie d’un
développement humain partagé. Il touche autant à l’économie qu’à la préservation des
cultures. Il concerne la façon dont l’humanité relèvera ses propres défis et prendra
des mesures respectueuses des valeurs humaines fondamentales qui sont au cœur de la
paix. Pour l’UNESCO, ce concept commande que l’Organisation jette des ponts en
direction des autres acteurs concernés du système des Nations Unies, des institutions
de Bretton Woods (la Banque mondiale et le Fond monétaire international), de
l’Organisation mondiale du commerce et des organisations non gouvernementales, en
vue de l’adoption et de la mise en pratique de l’humanisation de la mondialisation. En
particulier, si elle veut que ce concept soit pris en compte véritablement,
l’Organisation se doit d’être la source de la prise de conscience, par les institutions de
Bretton Woods, des impératifs éthiques et moraux d’un développement "à visage
humain". »
Equipe spéciale de réflexion sur l’UNESCO au XXIè siècle
Conseil exécutif de l’UNESCO
« Au moment où se dessinent les contours d’un système qui, en deçà et au delà des
relations inter-étatiques, devient à proprement parler mondial, le besoin se fait sentir,
dans de nombreux domaines de la vie économique, sociale et culturelle, de définir de
nouvelles règles du jeu, d’établir des normes et des principes de régulation, ou tout
simplement de fonctionnement, qui puissent être acceptables pour tous, parce qu’ils
reposent sur des valeurs reconnues et partagées par tous. »
Koïricho Matsuura
Directeur général de l’UNESCO
« Les idéaux de justice sociale n’ont cessé de refaire surface en dépit des obstacles
auxquels se sont successivement heurtés les divers projets visant à les appliquer. »
Amartya Sen
Prix Nobel d’économie
« Nous sommes une communauté mondiale, et comme toutes les communautés, il nous
faut respecter des règles pour pouvoir vivre ensemble. Elles doivent être équitables et
justes, et cela doit se voir clairement. Elles doivent accorder toute l’attention
nécessaire aux pauvres comme aux puissants, et témoigner d’un sens profond de
l’honnêteté et de la justice sociale. Dans le monde d’aujourd’hui, elles doivent être
fixées par des procédures démocratiques. Les règles qui régissent le fonctionnement
des autorités et institutions de gouvernements doivent garantir qu’elles prêtent
l’oreille et qu’elles répondent aux désirs et aux besoins de tous ceux qu’affectent les
mesures et les décisions qu’elles prennent. » Joseph Stiglitz
Prix Nobel d’économie

Economie Ethique N°6
ii
Présentation
Dr Ninou Garabaghi
Responsable du Programme interdisciplinaire
Ethique de l’économie
UNESCO
La Stratégie à moyen terme de l’UNESCO pour 2002-2007, a pour thème
fédérateur « humaniser la mondialisation ». Le nouveau programme interdisciplinaire
Ethique de l’économie a été conçu et développé au titre de ce thème fédérateur. Il a
pour objet de susciter et de soutenir les initiatives qui tendent à la définition, la
promotion et la diffusion dans la vie économique de valeurs éthiques susceptibles de
contribuer à l’humanisation de la mondialisation. Un premier état des lieux liminaire
de la problématique de l’humanisation de la mondialisation économique et des
initiatives en matière de promotion de valeurs éthiques dans la vie économique a été
réalisé au cours du biennium 2000-2001. Cet état des lieux liminaire a permis, entre
autres, d’élaborer à des fins analytiques et pratiques une définition de la notion
d’économie éthique qui a servi de base à la formulation de l’objectif du programme.
Forgé dans le cadre du paradigme du « développement humain durable et
partagé »1, le concept d’économie éthique se présente aujourd’hui avec pour objet la
définition, la promotion et la diffusion dans la vie économique de règles du jeu, de
principes et de normes éthiques universellement acceptables susceptibles de favoriser
à moyen terme la réconciliation de l’économique, du social, de l’écologique et du
culturel et à plus long terme d’assurer leur codétermination dans le processus de
mondialisation en cours. Fondé sur le principe du droit inaliénable de chaque être
humain à la vie et à la liberté2, le concept d’économie-éthique implique des principes
d’économicité qui restent à être définis sur une base universelle. Provisoirement et à
des fins heuristiques, il est possible d’énoncer trois principes : l’effet bénéfique
objectivement3 ; l’exclusion de toute destruction de services et de biens - produits par
les cultures et/ou dons de la nature - propres à des effets bénéfiques pour les êtres
humains4 ; le plein développement multidimensionnel de chaque être humain5.
A partir des résultats de l’état des lieux liminaire des initiatives en matière
d’économie éthique réalisé au cours du biennium 2000-2001, un schéma directeur
pour le programme Ethique de l’économie a été mis au point et validé lors d’une
réunion informelle d’experts organisée au Siège de l’UNESCO du 24 au 25 juin
20026. Dans ce schéma directeur des axes de réflexion thématiques ont été identifiés
1 Rapport final de l’équipe spéciale de réflexion sur l’UNESCO au XXIe siècle - "Vers la paix et la sécurité au
XXIe siècle : les défis à relever et les possibilités à saisir pour humaniser la mondialisation", document
160 EX/48 du Conseil exécutif de l’UNESCO.
2 Socle des valeurs proclamées par la Déclaration universelle des droits de l’homme.
3 Il ne s’agit évidemment pas de décider, de vive force et contre leur gré, ce qui est bon pour les êtres humains
mais de les mettre en situation de pouvoir décider sur la base des savoirs disponibles de ce qui est bon pour
eux.
4 Ce qui suppose la préservation de l’environnement dont dépend l’existence de tous les êtres humains et le
respect et la promotion de la diversité culturelle.
5 Ce qui implique l’obligation prioritaire de la couverture des coûts du statut humain de la vie.
6 Document SHS-2002/CONF.603/2.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
1
/
92
100%