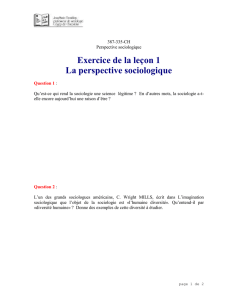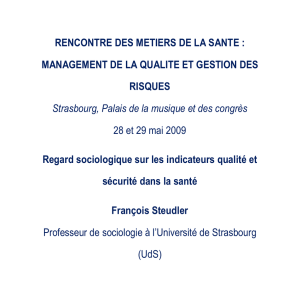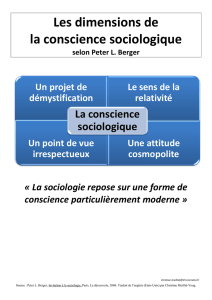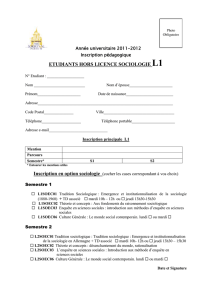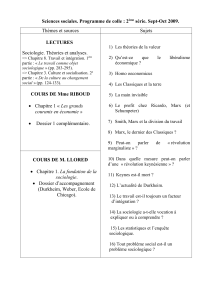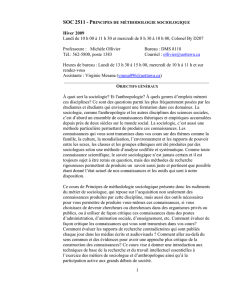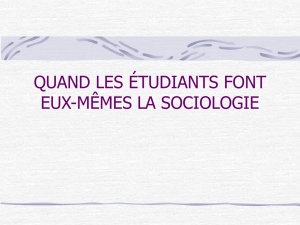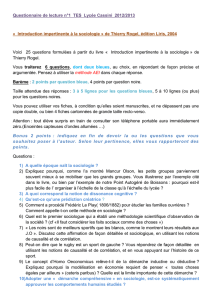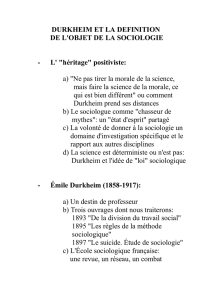de la sociologie comparée à la sociologie croisée

Construire un objet de recherche comparatif
Illustration de solutions inspirées (notamment) de l'histoire croisée
Travail en cours : ne pas citer.
Auteur : Boget Yoann
Doctorant à l'EHESS
Équipe de Recherches sur les Inégalités Sociales
Centre Maurice Halbwachs.
Comme l’énonçait déjà Durkheim, « la sociologie comparée n'est pas une
branche particulière de la sociologie ; c’est la sociologie même. » (1986, [1894]) Si
bien que, lorsqu’on parle de perspectives comparatives ou de sociologie comparée,
on fait en réalité référence à une forme bien particulière de comparaison qu’est la
comparaison internationale. Ce qui fait la spécificité de la méthode comparative ne
réside ainsi pas tant dans le fait de comparer que de comparer entre des contextes très
différents.
Cette démarche de la comparaison internationale est d’ailleurs aussi vieille
que la sociologie elle-même. Que l’on pense à des précurseurs comme Tocqueville ou
Marx ou aux Pères fondateurs tels que Weber ou Durkheim, on s’aperçoit
immédiatement que la comparaison internationale est constitutive de la discipline
sociologie.
Pourtant, parmi la vaste littérature méthodologique sur les comparaisons
internationales1, très peu de travaux se sont intéressés aux problèmes spécifiques
posés par l’utilisation de méthodes qualitatives2. Il ne s’agit pas de prétendre qu’il
1 Pour un aperçu des contributions récentes marquantes : voir la bibliographie.
2 Dont font en particulier partie les contributions de Collet et de Vassy (voir la bibliographie).
1

n’existe aucune contribution sur le sujet. Depuis le débat, plus théorique que
méthodologique, entre les chercheur du LEST, partisans de l’analyse sociétale et la
vision plus culturaliste de d’Iribarne et en dehors de quelques très bons chapitres
d’ouvrages collectifs (Lallement et Spurk, 2003 et Barbier et Letablier, 2005) ou de
d’écrits orientés vers l'apprentissage et construits sur le type du manuel (Vigour, 2005
et Paugam et Van de Velde, 2010), force est de constater que les contributions
récentes les plus marquantes viennent de l’extérieur de la discipline (Detienne, 2000)
ou de sa marge (Werner, Zimmermann, 2003). Partant de ce constat, nous avons
organisé avec Linda Haapajärvi et Aurélie Picot, deux collègues de l’Équipe de
Recherche sur les Inégalités Sociales, des journées d’étude intitulées : « L'enquête
qualitative et les perspectives comparatives : spécificité, apports, limites ». Cette
contribution s’inspire notamment des discussions tenues lors de ces journées. Elle
emprunte également un certain nombre d'idée à l'histoire croisée en vue de résoudre
quelques aspects problématiques relatifs à la construction d'un objet comparatif.
Dans une première partie, nous reviendrons sur trois erreurs-pièges qu'il
convient d'éviter. Dans une deuxième partie, nous verrons comment ses erreurs
peuvent être évitées à travers une reconstruction inductive qui nécessite de rompre
avec deux préjugés sur l'analyse comparative. Enfin une troisième partie permettra
d'illustrer comment ses solutions ont été appliquées concrètement dans le cadre d'une
enquête sur les « travailleurs pauvres assistés » en France et en Allemagne.
Contourner les trois pièges d'élaboration du comparable
La recherche comparative tend de nombreux pièges à ceux qui s'y aventurent.
Il en est trois lors de la construction de l'objet, qui bien que différents, relèvent d'une
même négligence à l'égard du caractère historiquement situé de l'objet, négligence
qui découle de l'entêtement à construire des objets similaires dans différents
2

contextes. Le premier, le biais, universaliste, sous couvert d'indicateur standardisé nie
simplement le caractère histoirique de l'objet. Le second, que l'on peut nommer biais
d'équivalence sémantique, passe à côté de différences en raison de traductions trop
rapidement jugées équivalentes. Enfin, le dernier piège, que l'on peut qualifier de
biais d'équivalence fonctionnelle consiste à considérer comme similaires des
catégories construites en tenant compte du contexte.
Le piège universaliste
En sociologie comparée, l'erreur la plus évidente consiste à construire un objet
anhistorique extrait de tout contexte. C’est ce que Barbier nomme l’universalisme
particulariste et Zimmermann le comparatisme logique. Il s’agit d’un comparatisme
anhistorique qui construit des indicateurs chiffrés standardisés. Elle permet de faire à
peu de frais de belles comparaisons terme à terme sans interroger la pertinence des
catégories ainsi construites dans la diversité des contextes étudiés. Il présente
l’avantage de prendre des allures scientifiques calquées sur le modèle des sciences
expérimentales.
Souvent, ce type de comparatisme est utilisé dans l’évaluation des politiques
publiques et par les institutions internationales. Deux exemples simples permettent
d’illustrer l’ineptie consistant à ignorer le contexte historique. La mesure du chômage
au sens du BIT implique ne pas avoir travaillé durant la semaine de référence et être
immédiatement disponible pour l’emploi. De fait, dans certains pays cette mesure
exclue… des chômeurs participant à des mesures dites d’activation. Elle ne tient pas
compte du chômage partiel, ni des dispositifs d’indemnisation du chômage et encore
moins des différences que recouvre la notion d'emploi. Les taux de pauvreté, mesurés
comme les revenus au-dessous de 60% du revenu médian posent le même type de
problèmes. Ils ne permettent pas de prendre en compte le contexte sociohistorique
dans lequel ces données s’inscrivent et postulent abusivement l’équivalence
sociologique des indicateurs produits. Le problème de ces analyses réside dans le fait
3

qu'elles produisent des entités dont la comparaison n’a pas de sens sociologique. Il ne
s’agit évidemment pas ici de critiquer les méthodes quantitatives mais certaines
utilisations inconsidérées de données standardisées. Les enquêtes de type qualitatives
ne sont pas nécessairement à l’abri de ce genre d’erreur. Une enquête par entretiens
semi-directifs qui mettrait en évidence des différences les resituer dans leur contexte
produirait le même type d’erreur. La première vigilance de la démarche comparative
consiste donc à historiciser son objet.
Cette première remarque constitue un rappel formel. En tant que
sociologue, nous sommes en principe aguerris contre la tentation d’extraire son
objet de son histoire. Nous connaissons les particularités du raisonnement
sociologique, au sens de Passeron (1991) et nous savons que les sciences sociales
ne peuvent pas se comporter selon les modèles des sciences anhistoriques. Le
monde social ne peut être appréhendé que dans un espace non-poppérien de
l’argumentation.
Le piège de l'équivalence sémantique
Pourtant, la deuxième erreur qui relève d'une même négligence du contexte
historique est beaucoup plus répandue. Elle consiste à établir des équivalents
sémantiques sur la base de traductions faussement évidentes. En effet, les mots, eux
aussi, sont pris dans un système de significations historiques. La traduction peut donc
cacher des différences fondamentales. Dans le cas de mon enquête, les politiques
d’activation en sont un exemple grossier. Barbier (2009) a bien montré comment ce
terme aisément traduisible dans toutes les langues européennes cache en réalité des
mesures différentes appliquées dans des contextes institutionnels eux aussi différents.
Il existe toutefois des cas plus pernicieux. Vassy (2003) par exemple a montré dans
une étude sur l’organisation hospitalière qu'il n’est pas correct de considérer les
infirmières, les « nurse » et les « Krankenschwester » comme des activités
équivalentes. Et même dans des domaines qui peuvent paraître hautement
4

standardisés et formalisés comme celui de la médecine, Woollven a montré lors des
journées d’étude que nous avons organisées que la dyslexie ne recouvrait pas la
même réalité des deux côtés de la Manche. Dans tous ces cas, le risque est d’être
abusé par des effets de langage qui, en cachant les différences, conduisent à voir de
l’identique partout. Afin de lutter contre ces fausses équivalences sémantiques,
Barbier (2002) propose de construire un « troisième langage », celui de la recherche,
qui permet de se dégager des sens indigènes et de pouvoir ainsi les analyser
distinctement.
Le piège de l'équivalence fonctionnelle
La troisième erreur découle de la construction inconsciente de ce que l’on
pourrait appeler des équivalents fonctionnels. Il s’agit dans ce cas de construire des
entités contextualisés mais néanmoins considérées équivalentes. Cette erreur se laisse
moins facilement saisir dans la mesure où elle implique de déconstruire les habitudes
mentales formées dans un cadre national. En effet, suivant Les règles de la méthode
sociologique, le sociologue cherche à se donner une définition précise qui rompt avec
le sens commun en évitant l’ethnocentrisme afin, justement, d’échapper à une vision
anhistorique du phénomène. Souvent, cette définition, bien que détachée du contexte
national particulier, reste imprégnée des schèmes de pensée propre à son contexte de
production, ne serait-ce que parce qu’elle est formulée dans une langue spécifique.
Dans le cadre de l’enquête que j’ai menée, par exemple, avant de pouvoir traiter la
question des « travailleurs pauvres », il me fallait une définition de la pauvreté. La
définition de Simmel, selon laquelle les personnes pauvres dans une société donnée
sont les personnes auxquelles la société vient en aide en raison de ce manque de
moyens, permettait a priori d’éviter la vision ethnocentrique de la pauvreté. Dans le
cas de la définition de la pauvreté par le dispositif d’assistance, le danger consiste
alors à rassembler sous la même catégorie de « pauvre » les allocataires du RSA et
ceux du Hatz IV (« l’équivalent » allemand). Les systèmes de protection sociale, bien
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%