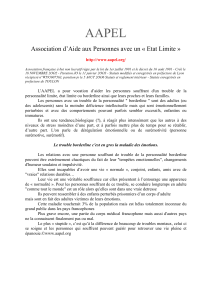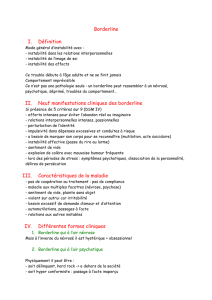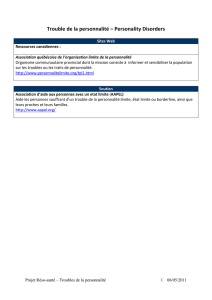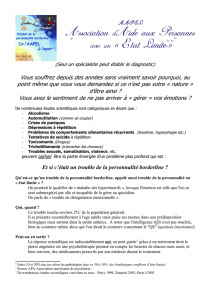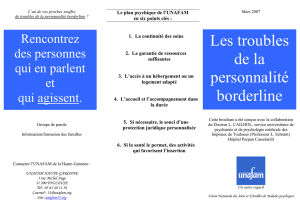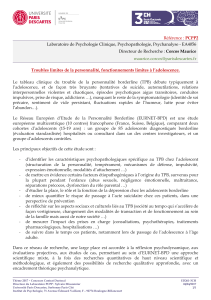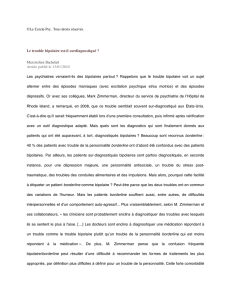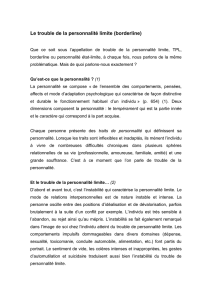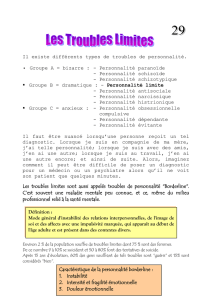NOUVELLES VOIES DU TRAITEMENT DE LA CRISE SUICIDAIRE

http://hdl.handle.net/10401/5950/ Avances en Salud Mental Relacional
Advances in Relational Mental Health
ISSN 1579-3516 - Vol. 11 - Núm. 2 - Julio 2012
Órgano de expresión de la Fundación OMIE y AMSA Avances Médicos
Revista Internacional On-line / An Internacional On-line Journal
© 2012 CORE Academic, Instituto de Psicoterapia -1-
NOUVELLES VOIES DU TRAITEMENT DE LA CRISE SUICIDAIRE
BORDERLINE
A. Andreoli
En collaboration avec A. Venturini, Y. Burnand, S. Lorillard, A. Berrino, G. Hourton, L. Frambati, P.
Ohlendorf
Adresse des Auteurs : Antonio Andreoli, 23, Bd des philosophes 1205 Genève, Suisse Tel. 0041 22
3214610, Fax 0041 22 3214614, e-mail: antonio.andr[email protected]
RESUMÉ
Le trouble de la personnalité borderline est une construction diagnostic de plus en plus controversée
mais ne rejoint pas moins un enjeu majeur de santé mentale en matière de comportement suicidaire.
Dans ce domaine, des nouvelles formes de psychothérapie ont fait preuve d’efficacité et d’efficience,
mais n’ont pas été encore testées chez des patients borderline admis aux urgences pour tentative de
suicide. Nos travaux se sont proposes de combler cette lacune en investiguant un nouveau modèle de
soins qui met l’accent sur la réaction traumatique a l’abandon au cours d’une relation amoureuse. Cet
événement de vie est un corrélat fréquent de la crise suicidaire borderline et se prolonge d’un deuil
pathologique qui est au centre des vicissitudes cliniques de cette dernière. A partir de ce constat, nous
avons formule l’hypothèse que la psychothérapie analytique serait susceptible d’optimiser le traitement
psychiatrique du borderline suicidaire: a) par la neutralisation des effets déroutants du retour du trauma
infantile chez ces sujets, b) par la facilitation du deuil via l’escamotage des effets des processus primitifs
d’idéalisation et d’identification réactivés, chez ces sujets, par la perte. Apres avoir résume ce modèle,
nous décrirons son application au niveau d’un dispositif cohérent de soins incluant l’urgence,
l’hospitalisation de crise et le traitement ambulatoire a trois mois. Les résultats de nos études
confirment que les programmes étudiés sont efficaces et économiques, en comparaison d’un traitement
usuel de bonne qualité, et ont un impact significatif sur la gestion des services appelles a se faire charge
de la crise suicidaire borderline.
Mots clef: Trouble de la personnalité borderline. Tentative de suicide. Psychothérapie. Psychanalyse.
Urgence. Crise. Traitement aigu. Essai clinique contrôlé. Services psychiatriques.

http://hdl.handle.net/10401/5950
ASMR. 2012 - Vol. 11 - Núm. 2 -2-
SUMMARY
An increasingly controversial diagnostic construct, borderline personality disorder yet encompasses a
major clinical problem with significant relevance to mental health in the area of suicidal behavior. Over
the last years psychotherapy made impressive progress showing significant effect on the self-damaging
conducts. Few studies were performed among borderline patients referred to emergency room with
suicide attempt and this issue deserves treatment innovation and research. To begin to respond this
need, we investigated an original psychotherapy model focusing on traumatic reaction to abandonment
from a romantic partner and the stormy mourning process of borderline patients confronting loss after
falling in love. Based upon such an assumption, psychoanalytic psychotherapy was expected to optimize
psychiatric treatment among these patients: a) neutralizing traumatic reaction to loss of a romantic
partner and the corresponding realm of unbearable infantile experiences, b) facilitating mourning
process working-out those primitive idealization/identification processes elicited from traumatic loss.
This psychotherapy model was operated in various formats adapted to provide comprehensive acute
treatment, including emergency care, short crisis hospitalization and 3 month ambulatory combined
treatment. The results of several controlled studies aimed to assess each step of the program confirmed
that, compared to valuable treatment as usual, these is cost-effective treatment choice with significant
impact on service management of the borderline suicidal crisis.
Key words: Borderline personality disorder. Suicide attempt. Psychotherapy. Psychoanalysis. Emergency.
Crisis intervention. Acute treatment. Controlled studies. Psychiatric services.

http://hdl.handle.net/10401/5950
ASMR. 2012 - Vol. 11 - Núm. 2 -3-
INTRODUCTION
Nous nous proposons de discuter un aspect peu étudie’ de la psychopathologie et du traitement du
trouble de la personnalité borderline. Il s’agit rapport qui s’établi, parmi ces sujets, entre impulsion
suicidaire et vicissitudes de la vie amoureuse. Nous discuterons, ce problème tout en montrant
comment, et avec quels effets, il nous a été possible de développer, a partir de cette réflexion, un
modèle de soins et de recherche clinique qui n’est pas démuni d’intérêt pour innover le traitement
hospitalier et ambulatoire du comportement suicidaire.
LE DÉBAT ACTUEL SUR LA NOTION DE TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ BORDERLINE
Le trouble de la personnalité limite est une construction diagnostic controverse. Autrefois décrit comme
une entité a mi chemin entre la névrose et la psychose (Kernberg, 1989), puis comme une frontière
entre la dépression et la personnalité (Gunderson, 2001), ce désordre est vu actuellement, par une
majorité d’experts comme une dérégulation du développement affectif et du contrôle émotionnel par
l’action conjointe de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux aussi distincts que discontinus
(Paris, 2008). Le patient borderline est, en somme, l’exemple même d’une difficulté de concilier la
complexité de l’objet clinique et la rigueur de la méthode scientifique qui est typique de la psychiatrie.
Des lors, on ne se surprendra guère que, mus par le désir de plier la nosographie des affections
mentales aux exigences de la recherche neurobiologique (Hyman, 2012), on souhaite évacuer des
classifications internationales ce sympathique empêcheur de tourner en rond de nos contradictions
epistemologique. Il n’en a pas été autrement lorsque les psychanalystes avaient fait du patient
borderline la victime de la seule psychogenèse. Nombreux sont heureusement ceux qui signalent le
risque de sacrifier les exigences de la clinique à l’espoir récurrent de progrès a venir. A remarquer que le
trouble de la personnalité borderline n’est pas moins heterogene que la schizophrénie, les troubles de
l’humeur ou les troubles anxieux et que, malgré tout, des progrès très significatifs ont été accomplis au
niveau de l’investigation des bases psycho biologiques de ce désordre. Plus important encore, le trouble
de la personnalité borderline rejoint un problème clinique excessivement fréquent dont on ne saurait
ignorer le relief sans entraîner des graves conséquences pour notre pratique. La question cruciale
poséée par ce désordre est celle du « distinct taste » de tant de dépressions doublées d’une agressivité
et d’une suicidalité qui rendent l’accès du patient très ardu et nécessitent, qu’on le veuille ou pas, une
approche thérapeutique de nature psycho biologique. D’aborder la question borderline sous cet angle a
bien d’avantages: la dépression et plus en particulier la dépression résistante au traitement étant une
priorité de santé mentale et ne peut prétendre de l’évacuer au nom de considérations nosographiques.
PROGRÈS RÉCENTS DU TRAITEMENT DES PATIENTS BORDERLINE ET POLITIQUE DE SANTÉ POUR LE
PATIENT SUICIDAIRE
Par chance, le construct diagnostic borderline et celui de comportement suicidaire grave et répétitif se
superposent quasi parfaitement. Cela nous permet, si non de nous désintéresser du débat
nosographique esquisse plus haut, de nous accorder tout ou moins sur l’idée que, envisage-t-on la
question du point de vue de la structure de la personnalité ou de la dimension comportementale, on
risque bien de tomber en fin de compte sur le même patient et sur la même difficulté, qui est celle des

http://hdl.handle.net/10401/5950
ASMR. 2012 - Vol. 11 - Núm. 2 -4-
dilemmes dramatiques et des coûts considérables associes a la prise en charge du patient suicidaire. Les
services psychiatriques rencontrent notamment des grandes difficultés avec ces sujets et des nouveaux
traitements ambulatoires sont nécessaires pour relever ce défi.
Nous allons prendre ici notre départ en pressntant, à partir d’une brève discussion de la littérature, une
analyse des défis du traitement du patient suicidaire et notamment de la crise suicidaire borderline
(Chap. 1). Dans le deuxième chapitre nous donnerons un aperçu des bases epidemiologiques e
psychopathologiques de notre lecture de la crise suicidaire borderline. Dans le troisième et quatrième
chapitre nous présenterons des exemples d’applications hospitalière et ambulatoire du modèle de soins
dérive de ce nouveau point de vue.
CHAP. 1. IMPORTANCE DE LA TENTATIVE DE SUICIDE ET EFFICACITÉ DES MÉTHODES DE PRÉVENTION
ET TRAITMENT A SON ENCONTRE
Des nombreuses études suggèrent que les crises suicidaires, et les tentatives de suicide qui en
découlent, méritent plus d’attention (pour revue, voir : Paris, 2008, Lorillard, 2010 a et b). Le taux de
tentatives de suicide, toute gravite confondue, a été estimée, pour la durée de vie, autour de 4.5% de la
population générale avec une remarquable stabilité des observations effectuées par les différentes
estimations accomplies (ibidem). Une enquête conduite par nos soins indique d’autre part les sujets
admis pour des raisons psychiatriques aux urgences de l’Hôpital cantonal de Genève pressentent, pour
une moitie, une idéation suicidaire modérée a grave sur l’item correspondant de l’échelle de
Montgomery et que cette idéation était le facteur plus important dans la demande urgente de soins.
Lorsqu’on considère exclusivement les tentatives suicide assez graves pour entraîner une admission aux
urgences médicales, les fréquences se réduisent a environ un dixième mais marquent toujours un
problème très significatif de santé mentale, compte tenu de la difficulté des processus de décision, de la
fréquence des hospitalisations psychiatriques et des coûts directs de santé de ces patients.
REVUE DE LA LITTÉRATURE
En accord avec ces données, un insert accru a été donc porte, au cours des dernières années, aux
méthodes de prévention et de traitement de ces sujets, notamment auprès des populations vues en
urgence. S. Lorillard (2010a) a analysé récemment le riche data basis qui est résulte de ces
investigations en montrant que les résultats observes changent de tout au tout selon que les collectifs
examines portent sur le tout venant des admission aux urgences pour geste suicidaire ou sur des sou
groupes des patients marques par un risque accru de récidive. Les observations de S. Lorillard et coll.
indiquent notamment que si on considère l’ensemble des suicidants vus aux urgences: a) le taux de
récidive est globalement modeste; b) des interventions simples a but préventif ou de fidélisation au suivi
diminuent le risque de récidive; c) en comparaison des dites méthodes, des intervention
psychothérapeutiques ou psychosociales structures ne pressentent pas d’avantage significatif et ont des
coûts supérieurs. Il n’en va autrement lorsque les études portent sur des collectifs de sujets pressentant
un risque accru de récidive. Ainsi, chez les patients avec une histoire de tentatives de suicide repesées
ou les patients borderline les taux de récidive sont très élevés et avoisinent ou dépassent le 50%. Seules
les interventions psychothérapeutiques ou psychosociales structures diminuent ici la fréquence de

http://hdl.handle.net/10401/5950
ASMR. 2012 - Vol. 11 - Núm. 2 -5-
récidive, et les effets observes sont souvent impressionnant. En conclusion, cette revue indique qu’il
faudrait améliorer les méthodes d’évaluation des patients suicidaires aux urgences, afin de mettre en
place des processus de décisions efficientes, mais aussi, idéalement, apprêter une panoplie
d’interventions adaptées à prendre en compte la complexité des enjeux en présence.
IMPORTANCE CLINIQUE ET THÉRAPEUTIQUE DE LA CRISE SUICIDAIRE BORDERLINE
Une enquête conduite aux urgences de l’hôpital cantonale de Genève indique que 61% des patients
admis pour un geste auto dommageable remplissent les critères pour troubles de la personnalité
borderline. Il en va de même pour moitie des dépressions majeures qui constituent la première raison
d’hospitalisation aux urgences et pour ¾ des patients caractérisent par une idéation suicidaire
significative. Une analyse diagnostic plus fine indique la présence de deux petits sou groupes sou
groupes de suicidants, l’un caractérise par une absence de diagnostic psychiatrique structure, l’autre par
la présence d’un trouble nécessitent une hospitalisation psychiatrique classique (crises dépressives
bipolaires, troubles dépressifs avec symptômes psychotiques, trouble psychotique, dépendances
graves). Un groupe de patients dépressifs sans comorbidite significative sur l’Axe deux constitue une
minorité plus significative. En termes de décision clinique, ces groupes sont relativement moins
importants que le groupe borderline (avec et sans dépression associe) car les processus de décision sont
généralement faciles en ce qui concerne ces sujets. Il en va autrement pour les patients borderline :
absence d’évaluation diagnostic valable, décision clinique incongrue tantôt par expulsion trop rapide
des urgences, tantôt par sur hospitalisation alors que ce choix s’avère souvent désastreux, dilemmes
thérapeutiques et médicaux légaux dramatiques, fréquence élevée de rechute et risque de mort par
suicide très important, font de ces patients le group de loin plus significatif parmi l’ensemble des
suicidant de tout service d’urgence. Or, des nouvelles thérapies psychologiques ont été mises au point
au cours des dernières années, qui ont donne des résultats encourageants sur le plan d’un contrôle
efficace du comportement suicidaire du patient borderline (Linehan 1991 et 2006, Bateman et al. 2001
et 2006, Giesen-Bloo et al., 2006), mais le nombre d’études contrôlés demeure modeste et leur
résultats soumis a des limitations. La plus grave étant que ces avancées n’ont pas été du tout testées ou
adaptées a la prise en charge des patients ordinaires adresses aux urgences des grands hôpitaux (le
groupe plus nombreux et plus difficilement accessible sur le plan de la recherche), si bien que les
nouvelles techniques ont fait pour l’heure leur preuves par rapport a la suicida lite du patient borderline
en général et non pas par rapport a la prise en charge de la crise suicidaire de ce dernier. Cela nous
amante à conclure que le suicidant borderline constitue une priorité significative pour l’innovation et la
recherche dans le domaine du comportement suicidaire.
CHAP. 2. LE TRAUMA DE LA DÉCEPTION D’AMOUR, UNE NOUVELLE LECTURE DE LA CRISI SUICIDAIRE
BORDERLINE
Un afflux grandissant de crises de vie multiplie la demande de soins psychiatriques au niveau des
urgences des grands hôpitaux et l’ampleur de ce phénomène nous interroge par son étrange commerce
avec la mort. Cela est d’autant plus troublant que le suicide accompli est, par contre à la baisse à l’instar
des facteurs classiques dont on invoque l’influence sur la volonté de mourir. La dépression est mieux
soignée, et les situations de détresse sociale ou de privation de soins qui soutenant habituellement la
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%